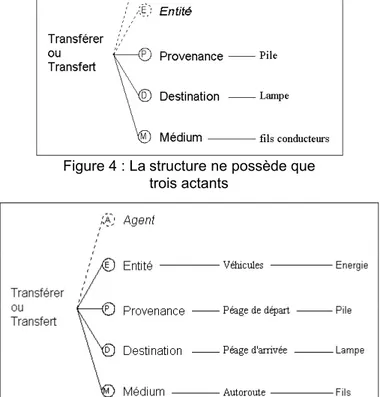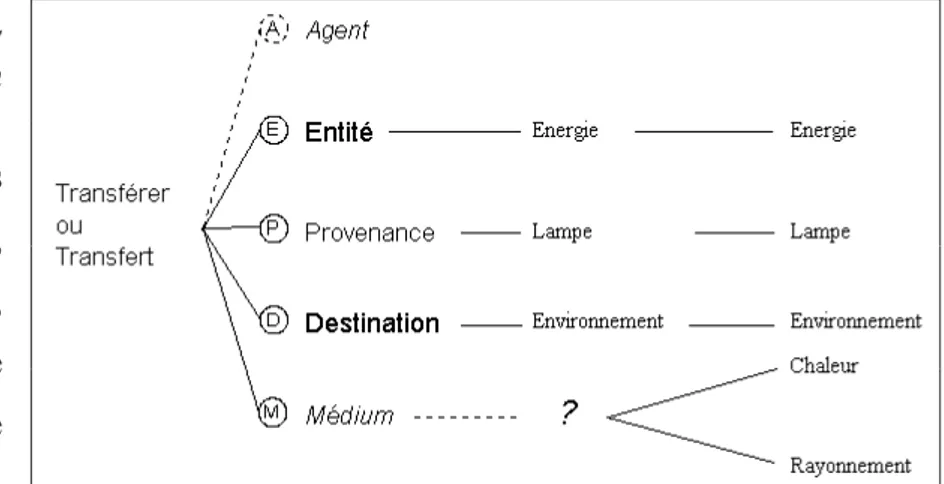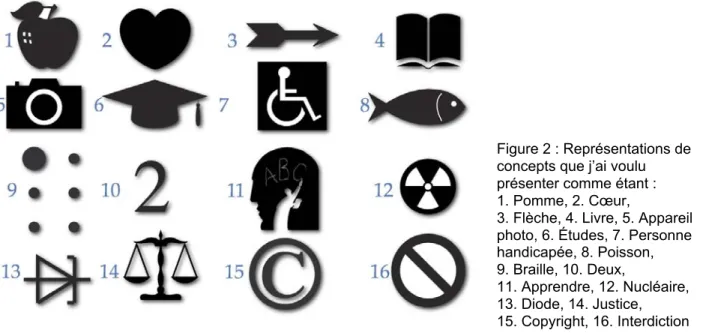A. GIORDAN, J.-L. MARTINAND et D. RAICHVARG, Actes JIES XXVII, 2005
PAR LES MOTS ET PAR LES CHOSES
INTRODUCTION
André GIORDAN Président des JIES
« Karcher », « racaille », « délinquant », « voyou », « sauvageons », « émeutes », « couvre-feu », « état d’exception », « guérilla »1
En France, mettre en avant la question des mots est de pleine actualité. Récemment, on a testé grandeur nature le poids des mots et l’impact des « choses » lancées. Pour vous, participants non-français qui avez pris le risque de nous rejoindre pour ces Journées, je me permets de vous demander : « comment allez-vous dans ce pays à feux et à sang ? »2 Mais peut-être ne connaissez-vous pas l’origine de l’expression « comment allez-connaissez-vous ? ». C’est une interrogation familière que l'on répète souvent, notamment lorsque l'on rencontre une personne connue… Mais l'employons-nous à bon escient ?
Cette expression populaire date en fait du XVIIe siècle ; c’était une époque où les repas chez les grands de ce monde étaient si copieux qu'on leur attribuait bien des maux. Pour y remédier, les médecins préconisaient deux types de remèdes : la saignée d'une part, et le clystère, d'autre part.
1 La France venait de vivre 3 semaines d’émeutes urbaines dans les banlieues. Les mots « racaille » et « nettoyé au Karcher » prononcés par le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkosy avait contribué à mettre le « feu ».
2 La France avait été présentée suite à ces évènements comme un pays à « feux et à sang » par les medias d’information extérieurs.
Et quand on se rencontrait, l’apostrophe cordiale d’un « comment allez-vous ? » n'était en fait qu'une abréviation pudique de : « comment allez-vous à la selle ? » La qualité des selles et des urines était alors extrêmement importante comme indicateurs de bonne ou de mauvaise santé… Il était donc fort poli de se soucier de la forme de son interlocuteur en lui demandant comment il, ou elle, avait « fait ses besoins » le matin !
Et si, de nos jours, nous redonnions à cette question si banale son sens d'origine ? Demain, au petit-déjeuner, essayez de répondre au collègue qui s'enquiert de votre forme : « Très bien ! J'ai fait un étron qui avait si belle allure que je l’ai pris en photo ».
Au passage, pourquoi dit-on « les urines » et non l’urine ?… Tout simplement parce qu’on supposait jusqu’au XVIIIe siècle qu’il existait deux sortes d’urines qui se mêlaient dans la vessie. En plus de l’urine rénale, il existait pour les scientifiques de l’époque une seconde urine provenant du cerveau qui passait par la moelle épinière !
1. LA TRANSPARENCE DES MOTS ?
Par le quotidien, on entre ainsi de plain-pied dans le thème de l’année, du moins a contrario. Habituellement, la rigueur scientifique et technologique semble régler d’office tout problème de vocabulaire. Celui-ci, « clair, rigoureux, univoque » et surtout « neutre », bénéficie en plus d’une définition bien précise que l’enseignant, le chercheur, le journaliste se charge de préciser en permanence… Faut-il en conclure que les mots scientifiques sont si transparents ?
Cette thèse est reprise par les linguistes qui vont jusqu’à dire qu’
« une volonté de transparence anime par excellence le langage scientifique qui, par sa rigueur, dénonce toute expression qui ne convoierait aucune information qui ne soit communicable »3.
Pour confirmer cette prétention, prenons un mot évident : celui de « corps ». Il permettra de faire le lien avec les Journées précédentes. Tout le monde possède une représentation immédiate de ce qu’est un corps… le référent est bien sûr le corps humain. Mais au fait est-il aussi délimité qu’on le présuppose ?.. La tête appartient-elle habituellement au corps ? Ce n’est toutefois pas la seule et principale difficulté. Dès qu’on fait le tour des usages du mot « corps » dans les différentes branches des sciences, tout paraît s’obscurcir immédiatement…
Qu’entend-t-on par exemple par « chute des corps » en physique ? Quel lien peut-on faire avec le corps biologique ? Rien d’étonnant que les jeunes aient de telles difficultés pour en cerner les contours. Le mot ne devient-il pas plutôt masquant ?
Et que signifie « un corps chimique pur » comme le présente le tableau suivant ?. Les précédents n’étaient-ils pas purs !
Et un corps en mathématique ? Comment s’en faire facilement une représentation ? Le principal obstacle dans l’apprentissage des mathématiques ne provient-il pas du vocabulaire usité ? Ne parle-t-on pas du corps des nombres rationnels, du
corps des nombres réels, du corps des nombres complexes et du corps fini à q éléments ? N’aurait-il pas été plus aisé de prendre d’autres termes, quitte à les inventer ?
Pour ajouter à la confusion, on trouve encore une gamme de « corps célestes », de l’astéroïde à la comète. Même en technologie de l’information, on continue à user du terme de « corps d’une lettre » Et je passerai sur : « corps électoral », « corps diplomatique » ou « corps d’armée » qui ne sont pas du domaine scientifique. Il était au demeurant intéressant de les passer en revue pour donner un peu plus de « corps » aux idées !
Sans doute l’exemple était-il mal choisi ?.. Les linguistes consultés pour préparer ces Journées précisent encore sans ambages que le langage scientifique est en prise directe avec le réel.
Le corps d’une lettre Tableau des corps purs (extraits)
Une chute d’un corps bien réelle !
Car, ne serait-il qu'un concept, ou même seulement l'une des diverses relations entretenues par les concepts scientifiques, le référent du langage scientifique « existe » dans le monde des idées scientifiques en tant que « chose pensée », elle-même cependant reliée aux choses prises dans le « monde vécu »4.
Qu’en est-il avec un exemple plus simple, le vocable de « fruit » ? Tout le monde possède une définition intuitive de fruit ; elle permet de reconnaître immédiatement ce concept et les objets qu’il recouvre comme un « allant de soi ». Une corbeille de fruit peut ainsi être composée sans difficulté, du moins tout un chacun le pense.
Malheureusement la conception du botaniste sur le terme de fruit n’est pas du tout en adéquation ; pour lui, « le fruit est le résultat de la transformation de l’ovaire de la fleur (le pistil) après la fécondation ». Au passage, n’oublions pas que quand nous mangeons une tomate qui est un fruit pour
un botaniste et non pas un légume5, nous mangeons un « ovaire » transformé ! 6 Et quand nous
achetons des œufs, en réalité ce sont des « ovules » !..
Pourtant tout se complique pour les fruits dans le « monde vécu ». Par exemple, dans le plateau ci-dessus, l’ananas qui passe pour un fruit au quotidien et en technologie de la cuisine ne l’a jamais été en botanique. Il en est de même pour les fraises et pour les figues !7 et évidemment pour les « fruits de mer ». Par contre, on peut faire des salades de fruits avec les haricots verts, les poivrons, les aubergines ou les olives. À travers le regard des mots scientifiques, la salade niçoise pourrait être classée dans les desserts, en tant que salade de fruits !8
Difficile donc… de fonder le langage scientifique sur la réalité. L’exemple des fruits nous montre déjà que l’objectif est loupé. Et que dire de nombre de concepts de physique tels que « puissance », « force » ou « travail » ? Par exemple, si vous montez une masse d’une tonne au 6e étage et que vous la redescendez, tout physicien dira : « Travail = 0 ».
Au quotidien, c’est un sacré boulot !
4 Angèle Kremer Marietti, Le figuré et le littéral dans le langage scientifique in Vincent de Coorebyter, Rhétoriques de la science, Paris, PUF, 1994, pp. 133-148.
5 Donc l’idée de légume n’existe pas en botanique.
6 Pour augmenter la difficulté, « ovaire » qui est un organe féminin est un nom masculin !
7 Dans les fraises, les fruits sont les petits « grains jaunes » (appelés akènes) sur la masse charnue rouge provenant de la transformation du réceptacle d’une fleur composée. De même, pour les figues, les fruits sont à l’intérieur du réceptacle
2. DES MOTS SCIENTIFIQUES UNIVOQUES ?
Si les mots scientifiques ne sont pas fondés sur le quotidien, au moins peut-on penser qu’ils soient définis au moins de façon univoque par les scientifiques eux-mêmes. Malheureusement, sur ce plan également rien de tel ! Prenons une notion évidente pour tout le monde : « de l’eau pure ».
En chimie, une « eau pure » est une « eau qui ne contient pas de sels minéraux ». En biologie, elle peut contenir des sels minéraux, pourvu qu’elle soit dépourvue de bactéries…
En médecine, on distingue encore trois types d’eaux pures : l’eau du robinet, l’eau de source ou encore l’eau minérale…
• L’eau du robinet provient généralement d’une rivière ou d’une nappe phréatique. Elle subit tout une série de traitements physiques, biologiques et chimiques pour la purifier.
• Les eaux de source sont des eaux issues de sources souterraines. Qu’elles soient plates ou gazeuses, elles sont embouteillées sans subir de traitement purificateur puisqu’elles sont saines à la sortie de la source.
• Les eaux minérales sont, tout comme les eaux de source, issues de sources souterraines. Elles ne subissent aucun traitement et sont mises en bouteille à la source. Elles ont été reconnues d’intérêt public parce que pures et bénéfiques pour la santé par l'Académie de Médecine.
Je vous passe « l’eau gazeuse » surtout si on a travaillé sur le changement d’état au préalable ! Et l’air liquide, ce n’est pas mieux…
À ce stade, je crains que les mots me conduisent vers un dérapage incontrôlé… mais que fait d’autre un physicien quand il avance que « le mobile a dérapé de sa trajectoire » ? Et les chercheurs en biologie quand ils n’arrivent pas à se mettre d’accord pour appeler « un chat, un chat » ! Par exemple, comment nomment-ils la zone plancher du cerveau en amont de l’hypophyse ? Dans la littérature scientifique, on peut dénoter une dizaine d’appellations différentes suivant les auteurs :
- le système hypophyso-diencéphalique (Berlinger 1923),
- le complexe tubéro-hypophyso-endocrinien (Roussy et Mosinger 1933), - l’unité diencéphalo-hypophysaire (Lichwith 1936),
- l’appareil hypothalamo-pituitaire (Hermann 1944), - le système diencéphalo-hypophysaire (Bargmann 1954),
- le complexe hypothalamo-hypophysaire (Benoit et Assenmacher 1953), - le système hypothalamo-hypophysaire (Bajusz 1963),
- l’unité hypothalamo-pituitaire (Reichlin, 1963).
Pour compléter ce tableau, la volonté de précision du langage peut conduire aux délires quand la réflexion épistémologique n’est pas mise en parallèle à la recherche. Les physiologistes ont
dénommé la zone qui contrôle la régulation de l’eau du nom tout simple de : « organum cavum prelaminae terminalis » !
Et quel nom trouve-t-on pour nommer ce petit organite cellulaire ? Les cytologistes l’affublent de plusieurs noms d’origines diverses.
Ils peuvent le nommer tout autant : - centriole, - centre cellulaire, - corps basal, - axostyle, - cinétide, - cinétosome ou encore - aster,
avec de plus des nuances différentes suivant les clades étudiés. Alors quand l’apprenant est
définitivement perdu… il ne reste plus qu’à conseiller à l’étudiant, à l’élève de regarder dans le dictionnaire…
Mais à l’usage est-ce vraiment un bon conseil ?
Prenons le mot « évolution ». On trouve dans le lexique suivant :
« processus qui a mené l’apparition et la transformation des espèces vivant sur Terre (Lexique EnclycloBio, Cité des Sciences et de l’Industrie). Bien sûr, « c’est une production de la Villette ! » dirait-on… Prenons un dictionnaire alors qui fait autorité, le Robert en 10 volumes.
Le sens du mot « évolution » que lui donne actuellement l’enseignement ou la médiation scientifique est totalement à l’opposé de cette acception. Ce mot n’a d’ailleurs pris son sens actuel en Biologie qu’au XVIIIe siècle, par un glissement de sens qui s’est produit progressivement.
Sans doute faudrait-il tordre le coup dans le même mouvement au mythe pédagogique de l’étymologie.
Certes les mots scientifiques sont construits sur des racines grecques ou latines… Mais nous aident-elles vraiment à comprendre ? Pour les non-convaincus, plusieurs mots comme « atomes » ou « reproduction » sont là pour nous le confirmer.
atome [atom] n. m.
_ athome v. 1350 ; lat. atomus, gr. atomos ´ indivisible ª;
En matière de mot de la chose, « reproduction » devient une aberration quand ce terme est affublé du qualificatif de « sexuée ». La « reproduction sexuée » n’est-elle pas le processus qui favorise non pas le semblable mais la différence ! Elle opère un brassage des gènes… qui ne sont pas le contraire des antigènes ! De même que les anticorps ne sont pas l’opposé des corps, bien au contraire…
En fait, les mots ont une histoire et il est dommage que celle-ci soit toujours si peu présente à l’école ou dans la médiation. On comprend alors mieux pourquoi les pauvres élèves quand ils disent que « La physique, c’est du chinois » ou « la génétique, de l’hébreu » !
Oui certes, il importe d’apprendre des sciences à travers des mots, mais s’interroge-t-on suffisamment à leur propos ? Et dans quelle langue le fait-on ? Que d’incompréhensions sont introduites uniquement par un usage impensé de nombre de vocables scientifiques… Un « bon » nettoyage dans un délai rapide serait la moindre des « bonnes idées », du moins comme première étape.
3. DES MOTS SCIENTIFIQUES NEUTRES ?
Sans doute était-il nécessaire, pour démarrer ces travaux, de déminer quelques mines9, pour faire bonne mine… mais surtout pour réfléchir sur l’importance du sens qu’école et médias donnent… ou ne donnent pas aux mots. Il reste beaucoup à faire pour tendre vers le projet des scientifiques et des ingénieurs, à savoir promouvoir une langue « rigoureuse, transparente et univoque » et surtout support d’un apprendre aisé…
Mais est-on allé suffisamment en profondeur ? Sans doute faudrait-il regarder au-delà de l’apparence… Et pour l’illustrer, j’aimerais avancer deux « scoops », du moins pour les non-scientifiques :
D’abord, « les poissons n’existent plus » du moins pour les systématiciens ! En effet, ces spécialistes ont montré en utilisant, entre autres, les méthodes génétiques que « les poissons osseux sont plus proches des mammifères que des requins ».
Deuxièmement, « les dinosaures n’ont pas disparu »
…Voici les derniers recensés
En effet, les spécialistes des classifications ont montré, par les mêmes méthodes, que « les oiseaux sont très proches d’un groupe de petits dinosaures volants vivants au crétacé. Le Vélociraptor est considéré comme un parent plus proche des oiseaux que du Tyrannosaure … et ce dernier est plus voisin des oiseaux que du Diplodocus. Conséquence, le groupe Reptiles n’a plus de sens… il n’existe plus pour les mêmes cladiciens10…
9 de mina, mot celtique. Il est intéressant de voir comment de la mine de plomb qui permettait de dessiner, on est passé au lieu où se trouve le minerai, à la méthode pour l’extraire, puis à l’explosif pour l’extraire et à la mine de guerre…
Ainsi, les mots scientifiques n’ont rien de neutre ! Le sens, mieux la perception du monde, est modifié suivant tel ou tel usage d’un simple mot. S’il fallait encore convaincre, on pourrait ajouter : « la crainte des reptiles n’a plus de sens, puisqu’il est devenu impossible de les rencontrer… du moins en tant que groupe reconnu et donc nommé ».
Pourtant, sans se désespérer, les linguistes continuent d’avancer que la langue scientifique est « une langue plus rigoureuse, aux énoncés clairs, une langue d’ailleurs parfois largement formalisée ; une langue neutre, transparente aux vérités qu’elle professe, une langue presque sans sujet, sans affect même. »
Pour l’instant, seule la publicité a bien compris sa nature controversée ; elle mise en permanence sur l’impact favorable… Pour elle, les mots scientifiques entraînent toujours par automatisme le sérieux ou l’efficacité. Ne les utilisent-elles pas depuis longtemps pour susciter la démarche d’achat ? La réclame des années quarante faisait déjà appel :
- aux Vitamines, - à la Chlorophylle, - à l’hexachlorophène et - au fluor.
Jusqu’au moment où l’on s’aperçut que l’hexachlorophène était tératogène… Comme le fluor l’est soupçonné de nos jours. On mettait même en avant les bienfaits des eaux radioactives ! Aujourd’hui, on mettrait plutôt sur le devant de la scène :
- les oligoéléments, - les omega 3, - les anti-oxydants,
- la lutte contre les radicaux libres - ou encore le BIO…
Il faut se rendre à l’évidence. Non seulement les mots scientifiques ou techniques ne sont pas impartiaux, mais ils peuvent être mystificateurs par leur usage ou leur détournement, et pas seulement dans la publicité.
Dans l’enseignement, ils le sont par exemple quand ils masquent des inconnus ou des incompris. Prenons « gravitation », certes ce vocable balise un domaine ; certes la gravité peut être mise en formule et être à l’origine de multiples expérimentations. Mais le mot « gravitation » suscite une illusion de savoir la chose parce qu’on manie le mot chez nombre de personnes. Alors qu’on ne connaît toujours pas la nature de cette interaction.
Leur accumulation dans la presse spécialisée ou les télévisions sans aucun mot sur nos ignorances ou les limites crée une impression d’une grande maîtrise. Or, nos connaissances scientifiques actuelles portent sur d’infimes parcelles de savoirs.
Cette illusion de savoir devient encore plus scandaleuse dans les domaines où le savoir reste fragile. On n’est pas très loin du Médecin malgré lui de Molière quand la médecine avance : « Alzheimer » ou « Parkinson ». Sous ces mots sont rassemblées des pathologies multiples d’origines diverses. On touche même au grotesque sensus stricto quand on rencontre certains neurologues. Avant, ils auraient dit benoîtement : « Pépé sucre les fraises aujourd’hui », « Mémé est un peu gâteuse ». Actuellement, ils proclament somptueusement : « démence sénile ». Ce terme ne « dit » rien de plus de ce qu’on pouvait dire précédemment -les neurologues restent tout aussi incompétents sur ces pathologies- pourtant, par ces mots, la personne est stigmatisée dramatiquement.
Alors quand les mots rencontrent les choses, tout se révèle décuplé. Un cocktail détonnant peut déclencher immédiatement des réactions irrationnelles. Par exemple, je vais réaliser devant vous et en direct un « clonage ». Je prends un élément d’un être vivant, je le fragmente et je le clone immédiatement…
André Giordan prend une branche de buis, sort un sécateur… et coupe des fragments de branche qu’il plante.
Le mot « clonage » vous a alerté. Tout aurait été tout autre, si d’entrée j’avais avancé : « je vais faire un bouturage » !.… Qu’est-ce en réalité un bouturage, sinon un clonage ! Suivant l’usage de l’un ou de l’autre mot, les connotations n’ont rien d’identique, et les ressentis sont à l’extrême… Le mot clonage est porteur de significations et, par là, provoque des réactions, totalement absentes dans bouturage.
André Giordan sort ensuite une branche de maïs.
Je pourrais dire : « je montre un maïs sélectionné pour ses hautes potentialités en matière de lutte contre la faim »… Si maintenant, j’avance qu’il s’agit « d’un OGM », votre réponse sera radicalement autre !..
4. LES MOTS ET LES CHOSES DE L’APPRENDRE
Les mots sont le moteur et le vecteur de l’apprendre. Avec un simple mot, on peut créer du désir, du plaisir, de la joie, du bonheur…, avec quelques mots on peut faire passer une pensée d’une extrême sophistication et d’une efficacité certaine. Prenons conscience de la pertinence de termes comme « application », « tableur », « web », en informatique…
Dans le même temps, les mots peuvent créer des révoltes ou des frustrations, ils peuvent entraver la pensée ou exclurent. Prenons dès lors le temps de travailler les mots en classe ou dans les activités de médiation. Des implicites pourraient être contournés, des blocages dépassés. Prenons tout autant l’habitude de comprendre avant de nommer, de mettre des mots sur les choses et non l’inverse. Les mots peuvent être « fenêtres », « passage », « tremplin » ou… « obstacle ». Je dirais plutôt : « et » obstacle. Mais l’obstacle dans l’apprendre n’est pas toujours comparable à un mur ou plutôt un mur n’est pas inlassablement un arrêt dans une aventure. Bien au contraire… Le monde de l’apprendre repose sur d’autres paradigmes. L’apprenant peut prendre appui sur un mur (un obstacle) pour s’élever en grimpant ; il peut tout aussi bien appuyer une échelle pour l’enjamber, etc..
Pareillement, il importerait de prendre conscience de nos réflexes de pensée, et notamment de ceux qui lient les mots pour produire nos idées ; les plus pertinents dans un contenu, un domaine ou une époque peuvent s’avérer inopérants dans d’autres situations. Eux aussi demanderaient à être questionnés en permanence avant d’être nommés. Peut-être feront-ils partie de moment d’éducation en 2050 !
SÉANCES PLÉNIÈRES
SÉANCE PLÉNIÈRE 1
A. GIORDAN, J.-L. MARTINAND et D. RAICHVARG, Actes JIES XXVII, 2005
OBJETS PAUVRES ET INVENTEURS MÉCONNUS :
UNE AUTRE MÉMOIRE (DES RESTES, DES FANTÔMES)
Jean-Luc MATTEOLI IUFM de Bourgogne
MOTS-CLÉS : THÉÂTRE – SCIENCE – AMATEURS – BRICOLAGE – MÉMOIRE.
RÉSUMÉ : Certaines compagnies de théâtre de rue élaborent, en se fondant sur des bricolages d’objets pauvres, le destin d’artistes mécaniciens imaginaires. Quelle figure du savant se donne ainsi à lire dans cette histoire revisitée de l’art et de la science, si ce n’est celle de l’inventeur, amateur génial et populaire dont les principales qualités sont l’imagination et un sens aigu du bricolage en tant que « pratique rétrospective » ?
ABSTRACT : Some theatre companies elaborate the destiny of imaginary mecanician artists, by using basic objects. What representation of the creator is thereby given by this new history of art and science, if not the representation of an inventor, a popular amateur, a genius whose main assets are his imagination and his mastering of handywork as the technique that uses the remains of the past.
1. INTRODUCTION
Nicolas Witkowski, dans son dernier ouvrage Une Histoire sentimentale des sciences1, propose d’introduire dans les « contes de fées sans ogre » que sont devenus ces ouvrages, un peu de sentiment et de déraison : bref, pour le citer, « un peu de désordre dans le musée poussiéreux de nos certitudes sur l’élaboration des savoirs » (4e de couverture)
L’Office des Phabricants d’Univers Singuliers (OPUS), compagnie de théâtre de rue, se donne un objectif étrangement similaire : « Nous aimerions », disent-ils, « attirer l’attention […] sur tous les inspirés du bord des routes qui glissent un désordre charmant et modeste sur les idées préfabriquées »2. Bien sûr, « les inspirés du bord des routes », voilà une périphrase bien peu usitée pour désigner les savants. C’est que les André Durupt, Robert Jarry, Raoul Huet, ces héros imaginaires que l’OPUS célèbre, ces « inspirés du bord des routes » auxquels il consacre un Conservatoire, ne sont pas à proprement parler des « savants ».
Ce sont des tenants de l’art brut, c'est-à-dire des artistes qui créent dans l’inconscience de leur art, du public et du monde de la culture. Leur origine (imaginaire) est modeste, ouvrière la plupart du temps, et dans le cas de l’OPUS, rurale. Leur matériau (réel) est issu de la récupération, leur activité s’apparente au bricolage dans l’esprit du système D, leur art, enfin, est la mécanique. Ce sont des fabricants de machines : une crèche à moteur, une machine à déboucher les bouteilles de chianti, la machine à tarabuster les cailloux hypnotiques, etc3. Et de ces machines, ils tirent des attractions spectaculaires destinées à animer les dimanches de la campagne. Ils se situent donc dans une zone hybride, entre mécanique (ils fabriquent), théâtre (ils représentent) et arts plastiques (ils exposent). La nuit aurait continué de régner sur cette tératologie de l’art et de la science si certaines compagnies ne s’étaient avisées, aujourd’hui, de leur redonner du lustre, en restaurant et exposant les découvertes de ces réconciliateurs imaginaires de l’art et de la science, qui meurent tous les trois dans les années 1970, significativement.
1 Nicolas WITKOWSKI, Une histoire sentimentale des sciences. Paris : Le Seuil, Science ouverte, 2003.
2 Le Petit Cure-Yeux, magazine à tirage aléatoire et à parution épisodique , Dijon, Office des Phabricants d’Univers Singuliers (OPUS), 2003, p. 4.
3 « Machine à appeler doucement Superman parce qu’il y a un ennemi derrière la porte, machine à ouvrir le frigo pour attraper le beurre, machine à regarder les filles droit dans les yeux, machine à vivre mieux, et son corollaire : la machine à vivre moins bien, la machine qui ne sert à rien et qui le fait bien, la machine à embrasser son amoureux(euse) quant il (elle) boude, la machine à écouter les histoires que les fourmis racontent, la machine à aller à l’école à sa place, la machine qui mange ceux que l’on n’aime pas, la machine à raconter de bonnes blagues, la machine qui joue vachement
2. DE L’OBJET PAUVRE À L’INVENTEUR
2.1. Objets & obsolescence
À l’analyse, on trouve dans les travaux de ces compagnies un instantané du désir de mémoire de nos sociétés industrielles : c’est-à-dire à la fois le constat d’une tradition rompue et perdue, et celui de la nécessité d’en ressaisir pour les ordonner les principaux éléments, livrés au public dans une structure muséographique.
Ce qu’on remarque moins peut-être, c’est le rôle des objets dans cette histoire, et notamment des objets récupérés, c’est-à-dire recueillis au moment où ils allaient disparaître. Ces objets que Kantor appelait « pauvres » présentent deux visages : en tant que bricole et qu’objet ordinaire, ils contiennent deux couches temporelles (le passé qui s’efface, le présent du quotidien). Ces deux registres temporels constituent la résultante de cette « crise de l’avenir », selon le mot de l’historien François Hartog, que les désillusions de l’après-Mai 1968, ainsi que la rupture mémorielle de la fin des années 1970, ont rendue patente. En fait, la crise de l’idée de Progrès même, aux termes de laquelle, dans un monde toujours en mouvement vers davantage de lumières, le futur est automatiquement supérieur à ce qu’il remplace, passé et présent étant constamment dévalorisés à son profit, et n’étant bon qu’à disparaître : le patrimoine industriel en sait quelque chose…
Dans ce contexte, « récupérer » l’objet pauvre (donc exclusivement passé ou à peine présent), c’est recueillir quelque chose qui, sans l’intervention du ramasseur, eût disparu, de sorte que c’est aller contre ce mouvement « naturel » de la disparition sur lequel se fonde l’idée de Progrès. La traduction de ce phénomène dans le domaine économique, c’est l’obsolescence, ce principe de vieillissement instantané et radical qui affecte les objets du quotidien avant même que leur terme soit venu, simplement parce qu’apparaissent des objets plus nouveaux, donc, croit-on, plus performants. Articulée sur l’avenir en effet, l’offre marchande ne doit-elle pas faire oublier ce qui précède par le produit nouveau qu’elle propose à la consommation ? On fait donc disparaître ce qui pourrait encore faire de l’usage : « mais ce n’est pas grave, ce n’est qu’un objet ordinaire, inerte, sans réelle valeur marchande, ni même esthétique… ». De la simple matière dont on s’est rendu « comme maître et possesseur »4.
Or la question est là : pour que la récupération (geste aujourd’hui quasiment oublié dans nos sociétés de consommation, et propre aux plus démunis) ait pris une telle importance, pour que l’objet pauvre soit le matériau à la fois des compagnies de rue dont nous parlons, mais aussi de compagnies de marionnettes, d’objet, et de théâtre d’acteurs (comme le Radeau ou Deschamps-Makeïeff), sans parler des arts plastiques, c’est que l’objet n’est peut-être pas, contrairement à ce
que le mécanisme de l’obsolescence laisse penser, de la simple matière. Si le mot qui revient le plus souvent pour le nommer, dans ce théâtre, est « partenaire » (ce qui fait de l’objet un égal) voire « objet-acteur » pour Macha Makeïeff (donc un humain lui aussi), c’est qu’il est vivant5. L’objet pauvre est en effet du temps passé, mais aussi du présent (voire du présent qui devient passé), donc du vécu. Car, par une étrange alchimie psychologique, c’est dans ces petits riens de la vie quotidienne que se niche l’essence de l’existence, tout objet étant une métonymie de l’espace dans lequel il évolue, du temps où l’on en use, de ceux qui l’approchent et de leurs sentiments, au point que Gérard Wajcman a pu parler de l’objet comme d’une « éponge à mémoire », voire à histoires. Récupérer cette sorte d’objets, c’est donc sauver un passé apparemment ordinaire de l’oubli total, et faire pièces au récit officiel.
2.2. Objets & mémoire
Faire disparaître pour laisser (de la) place au futur : c’est (ou c’était) là une règle, presque un dogme de nos sociétés occidentales rationnelles et industrielles, règle que les entreprises de travaux publics et les musées entérinent de manière complémentaire. Or, l’avenir ne peut que s’alourdir de tous les disparus (hommes, villes, objets) dont on a pavé son chemin - les tragédies grecques, depuis vingt-cinq siècles, le disent assez. À l’ignorer, on s’expose à ce que les fantômes reviennent. Or, ils sont nombreux : combien de paysages (voire de pays), d’idées (voire d’idéologies), d’activités (voire de métiers), et, pour finir, d’êtres humains, ont disparu de manière indue (voire violente), avant que leur terme ne soit venu, en ce siècle qui vient de s’achever, avec l’aide d’une science rendue complice, et pour préparer un avenir qui aurait pu durer « mille ans » ? L’objet le plus humble devient alors le témoin de ce qui a disparu, comme à l’ouverture des canadas dans les camps de la mort ces monceaux d’objets triés : des témoins muets, des fantômes mutiques… Sarah Kofman débute ainsi le récit qu’elle consacre à son père, mort en déportation :
De lui, il me reste seulement le stylo. Je l’ai pris un jour dans le sac de ma mère où elle le gardait avec d’autres souvenirs de mon père. Un stylo comme l’on n’en fait plus, et qu’il fallait remplir avec de l’encre. Je me, suis servie pendant toute ma scolarité. Il m’a “lâchée” avant que je puisse me décider à l’abandonner. Je le possède toujours, rafistolé avec du scotch, il est devant mes yeux sur ma table de travail et il me contraint à écrire, écrire6.
5 Tadeusz Kantor définissait ainsi l’objet pauvre : « Un objet misérable, PAUVRE, incapable de servir dans la vie, bon à jeter aux ordures. / Débarrassé de sa fonction vitale, protectrice / nu, désintéressé, artistique ! / Appelant la pitié et L’EMOTION ! » (Tadeusz KANTOR, Leçons de Milan, traduit du polonais par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, Arles,
Dans les pratiques artistiques, l’objet pauvre constitue le signe que tout avenir se construit avec du passé (on se souvient que pour Claude Lévi-Strauss, le bricolage est une pratique rétrospective), que toute création s’effectue désormais avec le seul mode de transmission d’une tradition qui ne soit pas figée par les commémorations, c’est-à-dire du reste : du déchet, du décrié, du cassé, du sali. Dans un monde en mouvement, le plus stable, finalement, ce sont les objets de rien qui nous entourent – et pas les pays, et pas les villes, et pas les métiers.
Et si l’on venait tous de quelques choses, d’une poignée d’objets de terreur et de désir, fragments, merveilles ou débris, tenaces ou fragiles, insistants toujours, qui seraient nos traces, repères, ancrage, nous définiraient, cailloux blancs sur le chemin7.
L’objet pauvre, que façonnent les constructeurs de certaines compagnies de rue aujourd’hui, dit donc combien il est nécessaire de rétablir l’inventeur, figure réconciliatrice du savant et de l’artiste sous les auspices du libre amateur. L’inventeur, guidé par l’ingéniosité et l’imagination, œuvre, comme un bricoleur, avec des restes qui le pré-contraignent : le hasard est donc toujours son partenaire. Savant et artiste en effet sont soumis aux caprices de la sérendipité, hasard heureux auquel Jean Jacques a consacré le chapitre d’un livre et qui, si l’on y réfléchit, est le contraire de la manière dont la technoscience se présente à nous, par exemple dans la publicité – un problème/une solution. « Attelé à la charrue du hasard » (comme le dit Dubuffet de l’artiste contemporain), constamment en éveil, l’inventeur est en effet celui qui peut délaisser le chemin tracé pour en emprunter un autre, s’il paraît soudain plus séduisant : preuve que, loin de toute certitude, il est celui qui cherche. Il parcourt d’ailleurs en tous sens l’histoire des sciences, reprenant, ici, là, tel terme d’un problème ou d’une solution pour en conduire ailleurs les conclusions, fidèle en cela à l’étymologie de son activité de bricoleur. Des restes, il tire, par l’exercice de l’imagination, matière à contes et à spectacles, comme furent des hommes de spectacle le physicien aéronaute Robertson (1763-1837) ou Pilâtre du Rozier en 1783 : et tant qu’à faire spectacle, autant faire spectacle vivant.
3. CONCLUSION
Vivent donc la science aux applications spectaculaires (dans la rue) et le retour des mécaniciens : vivent les machines sans autre utilité que poétique, vive la science populaire. L’inventeur bricoleur d’objets démodés et de fragments, collectionneur à ses heures, est, à n’en pas douter, l’une des figures théâtrales des temps postmodernes.
Le siège Chauffant de M. Durupt (Cie O.P.U)
BIBLIOGRAPHIE
DIDI-HUBERMAN G. (2002). Ninfa moderna. Paris : Gallimard, Col. Art et artistes. FARGE A. (2000). La Chambre à deux lits et le cordonnier de Tel-Aviv. Paris : Le Seuil. HARENDT A. (1974) Vies politiques. Paris : Gallimard, Col. Tel.
HARTOG F. (2003). Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps. Paris : le Seuil, Col. La Librairie du XXIe siècle.
MAKEÏEFF M. (2001). Poétique du désastre. Arles : Actes Sud. MAKEÏEFF M. (2000). Beaux-Restes. Arles : Actes Sud.
Le Grand Répertoire, machines de spectacle. Arles : Actes Sud, 2003.
Le Musée cannibale, textes réunis et édités par Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaehr, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, 2002.
A. GIORDAN, J.-L. MARTINAND et D. RAICHVARG, Actes JIES XXVII, 2005
DES MOTS ET DES CHOSES DANS QUELQUES POÉTIQUES
MODERNES ET CONTEMPORAINES
Dominique RINCE École Polytechnique
Dans le cadre forcément limité de cette communication en plénière, j’avancerai ici une hypothèse un peu provocante concernant notre poésie moderne. Je prends « moderne » au sens baudelairien du terme, c’est-à-dire de la poésie qui, après le romantisme et à partir des années 1860, prend en charge, en vers ou en prose, la représentation d’une modernité elle-même traversée par le débordement et la fragmentation de la science et de ses applications techniques.
Je formulerai donc brutalement, pour la discuter, mon hypothèse comme ceci : au moment même où le roman – réaliste ou naturaliste, flaubertien ou zolien – se complaît, jusqu’à s’en « gaver », dans la représentation mimétique des choses, des objets, y compris de la science et de la technique (et parfois même aussi pour les déconstruire de manière spectaculaire : je pense à la description de la casquette de Charles en ouverture de Madame Bovary), au même moment, donc, la poésie décide de leur tourner le dos à ces choses, voire de leur « claquer la porte » de ses mots dans un espace langagier de plus en plus soucieux d’autoréférentialité et de moins en moins de représentation objectale. Autrement dit encore, la poésie moderne post-baudelairienne serait, durablement et probablement jusqu’au surréalisme compris, le plus sûr moyen de ne pas aimer les choses en aimant trop les mots…
Ponge et son Parti pris des choses nous montrera, lui, la voie d’un dépassement possible mais difficile qui constituerait en un retournement paradoxal de la problématique : retrouver l’amour des choses – en préservant le « compte tenu des mots » - et en admettant finalement que, si les mots sont bien des choses, comme on le sait depuis longtemps, Platon et son Cratyle, les choses elles-mêmes sont sans doute des mots !
La critique n’a sans doute pas assez souligné combien, à partir de Baudelaire et ses successeurs de la première génération moderne, les objets se font rares dans le poème, à l’exception, j’y reviendrai, de l’inclassable Lautréamont, grand amateur de dictionnaires et d’encyclopédies avant Ponge et dans la « brocante » duquel on peut croiser à chaque page « couteau américain à 12 lames », « croisette cuirassée à tourelles » et assemblages fameux de « choses » comme cette insolite alliance qui plaira tant à Reverdy et aux surréalistes d’« un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection » !
Mais déjà, chez Baudelaire lui-même, les choses se faisaient rares si l’on excepte ici ou là une « pipe », une « cloche fêlée », une « corde » ou encore une « fenêtre », encore que ce dernier objet désigne précisément davantage ce qui fait signe et sens pour l’auteur du Spleen de Paris : un cadre spatial et/ou temporel de représentation plutôt que la chose elle-même. Et que dire de Rimbaud, l’« absolument moderne », dont tout le monde a oublié « le balai » ou la « pissotière d’auberge » au profit de spectaculaires échappées et « illuminations » sur des trajectoires de dromomane qui conduisent inévitablement ce premier des artistes d’avant-garde au désert ou au silence…
Dans ce contexte, tout l’intérêt de Mallarmé sur lequel je vais m’attarder un instant, est de systématiser et radicaliser dans les années 1880 cette grande option de la modernité poétique en la fondant sur une véritable réflexion philosophique et linguistique. Dans ces mêmes années où le peintre Paul Cézanne, dans une lettre superbe, écrit avec effarement : « Tout disparaît. Il faut se dépêcher (de peindre) si l’on veut encore voir quelque chose… », Mallarmé, lui, fait de l’effacement des choses dans les signes du poème l’objet même de sa poétique. Deux citations de Crise de vers exemplaires à cet égard :
1) sur la capacité de déréification du vers : « Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole (…) en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans une neuve atmosphère. »
2) sur la double fonction « assassine » et simultanément libératrice des mots proférés en lieu et place des choses : « Je dis une fleur ! et, hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente
Mais le coup de génie, terrorisant, de Mallarmé, est d’aller au bout de sa logique en considérant à juste raison que le mot poétique lui-même, puisqu’il est phonème et graphe, est une chose et, à ce titre, à son tour, dans l’acte de l’énonciation poétique, passible de la procédure d’effacement et de déréification, comme le suggère ce dernier extrait de Crise de vers : « Naturellement, le seul mot n’est que l’amorce du glissement, puisque, par la signification, il rend à nouveau présent l’objet signifié dont il écarte la réalité matérielle. Il est donc nécessaire, si l’absence doit se maintenir, qu’au mot se substitue un autre mot qui l’éloigne, et à celui-ci un autre qui le fuit, et à ce dernier le mouvement même de la fuite. »
Conséquence directe, vérifiable évidemment dans la production mallarméenne, l’idéal du poème serait finalement le poème qui ne montre, ne dit, ne représente rien, ni choses ni mots… « Idéal le poème, tu, aux blancs », s’exclame encore Mallarmé, assignant par là à la poésie une utopie qui devance de 30 ans celle de la peinture moderne puisque ce n’est qu’en 1918 que Malevitch peindra son fameux Carré blanc sur fond blanc !
Il serait évidemment tentant, à ce moment, d’opposer à cette disparition des choses dans le poème symboliste mallarméen, le retour fracassant des objets dans l’esthétique surréaliste de la première moitié du XXe siècle.
Inspirés des ready-made que Marcel Duchamp présente à partir de 1914 (l’urinoir, le porte-bouteilles, etc) et sommés par A. Breton dès 1924, dans son Introduction au discours sur le peu de réalité, de s’approprier, je cite, « certains objets qu’on n’approche qu’en rêve », les artistes surréalistes se lancent en effet avec ardeur dans un détournement subversif des fonctions utilitaires et techniques de l’objet, requalifié esthétiquement sur le double mode de l’étrangeté et/ou du cocasse. Ainsi naîtront la « cuiller/soulier » dans Nadja de Breton, le « téléphone/homard » de Dali ou les objets dits « modifiés » ou « introuvables » de Man Ray et de Carelman.
Cela est bien connu mais, à mon sens, ne constitue sans doute pas une « révolution » dans notre problématique poétique du mot et de l’objet. Car, j’oserai dire, toujours pour provoquer ensuite notre discussion, que le surréalisme, dans la continuité de la modernité poétique post-baudelairienne, continue, malgré tout, à asseoir une sorte de primat ontologique du mot sur la chose – aussi spectaculaire soit-elle – en ce que c’est bien le mot qui, dans cette démarche, fonde la poéticité ou l’esthéticité plastique de la chose. Je m’explique : c’est bien parce que Duchamp nomme « fountain » son urinoir que l’objet devient art ; c’est bien parce que Man Ray baptise « le cadeau » en 1921 son fer à repasser hérissé de pointes qu’il opère le chargement sémantique de son objet ; c’est bien encore parce que, sous sa pipe admirablement figurée, Magritte écrit « ceci n’est
pas une pipe », qu’il ouvre – avec son paratexte provocateur – le vertige d’une méditation sur la crise de la représentation en des termes, j’oserai le dire toujours avec un peu de provocation, quasi mallarméens !
En réalité, quelle que soit l’authenticité de leurs passions pour les choses, les surréalistes, y compris les peintres, dont la peinture est à mon sens l’une des plus « verbales » qui soient, n’auront eu de cesse de donner la primauté aux mots à une exception peut-être, sur laquelle je reviendrai volontiers dans la discussion, qui est celle des bien méconnus poèmes-objets (1) dont Breton proposa la pratique en 1935 dans une conférence praguoise intitulée « Situation surréaliste de l’objet ; situation de l’objet surréaliste ».
En voici d’ailleurs deux exemples :
• en 1934, il installe, en le ficelant, un canif sur une feuille de carton et lui associe un poème de trois vers : « Le torrent automobile de sucre candi/Prend en écharpe un long frisson végétal/Étrillant des débris de style corinthien ».
• en 1936, il propose cette fois un paquet de cigarettes qui porte en inscription ces 4 « vers » : « l’Océan glacial/jeune fille aux yeux bleus/dont les cheveux/étaient déjà blancs » ; l’image d’une hermine est par ailleurs collée sur le fond du paquet.
Mais contentons-nous pour l’instant de demeurer un peu provocateur en affirmant qu’après la déréification mallarméenne, le dépaysement ou le détournement verbal des objets par les mots chez les surréalistes, tout cela n’arrange guère les affaires des « choses » !
Enfin Francis Ponge vint…, me direz-vous, en s’arrachant précisément lui-même à l’emprise surréaliste pour s’efforcer de prendre résolument, avec son recueil de 1942, le « parti pris des choses ». Regardons-y pourtant d’un peu plus près dans ce qui apparaît sans doute hâtivement comme une révolution dans notre poésie contemporaine, comme si soudain les choses tenaient leur revanche sur les mots ! Voire… Certes, les choses sont bien là chez Ponge, offertes j’allais dire et j’y reviendrai dans la discussion, comme dans un « inventaire à la Prévert » : cageot, bougie, cigarette, pain, galet, savon, cruche, etc. etc.
Certes donc elles sont bien « là » avec une corporéité ou une concrétude non métaphorique, inédite dans notre poésie ; avec encore tout un horizon d’apparition, tout un référentiel philosophique courant du matérialisme de Lucrèce à celui de Marx qui ne pouvait que susciter les gloses admiratives des phénoménologistes des années cinquante comme Sartre. Certes encore, Ponge, dans son Parti pris des choses, conjuguant ses deux profils de lexicologue et de naturaliste, va même
complaisant, avec les outils de la langue, à peser, mesurer, qualifier, disséquer ses galets, mollusques ou autres « choses » du monde…
Mais au bout du compte, la naïveté serait grande de croire ou de faire croire que, par là, le poète serait ce savant Cosinus ou, mieux, Lexicus qui rendrait, comme on l’a dit parfois, la parole aux choses… L’ont-elles jamais eue ? L’ont-elles jamais demandée ?
Ponge lui-même d’ailleurs s’est toujours défié des interprétations qui feraient de lui le porte-parole ou le « traducteur des choses »… S’il a une réelle passion pour le monde muet des choses, un monde qui résiste d’ailleurs à ses mots, qui le met parfois au bord de l’aphasie ou de la paralysie de la main, c’est que ce silence naturel des choses le met au défi de ce qu’il appelle lui-même « la rage de l’expression », pour transformer les objets en objeux et sa détresse en objoie.
Ponge sait bien qu’entre les mots et les choses, il y a du « jeu », ce jeu en lequel s’ancre l’acte même de profération poétique ; mais il sait aussi que dans les choses muettes, il y a le vertige ontologique des écarts entre absence et présence. Dans un récent ouvrage collectif intitulé Objet Ponge (Ed. L’Improviste, 2004), Christiane Vollaire, tout en commentant le matérialisme pongien, d’abord « élémentariste » et « atomistique », dans la continuité de ses lectures d’Epictète et de Leibniz, souligne à juste titre « la révolution copernicienne » qui s’opère dans la conscience l’écrivain dans les années soixante. Ponge découvre alors, par la fréquentation de la physique moderne et de la mécanique quantique qui contredit l’élémentarité de l’atome, comment la matière devient un lieu de vertige abyssal ; comment encore cet éclatement du socle ontologique de la matière explique les apories du matérialisme et induit des procédés heuristiques nouveaux dont le maître-mot sera celui d’inachèvement.
Tout cela pour dire que le Ponge qui m’intéresse en ce sens est moins celui du Parti pris des choses que celui des textes ultérieurs comme La Rage de l’expression (1952), Le Grand Recueil (1961) ou La Fabrique du pré (1971). La théorisation qu’il développe alors de ses objeux (notamment dans « Le Soleil placé en abîme ») en fait des objets-textes ou pré-textes en état d’inachèvement perpétuel, soumis à un inlassable work in progress et offerts dans une sorte de configuration enchevêtrée et prismatique, presque fractale parfois, au sens mandelbrotien du terme.
Autrement dit, en proposant l’objeu comme une espèce d’expansion indéfiniment plurielle de la matière dans le langage, j’oserai dire, en renversant les termes de notre hypothèse de départ, que pour ce Ponge là ce sont tout simplement les choses qui sont des mots ! Les choses sont des mots, et peut-être rien que des mots car elles n’existent que pour autant qu’il existe des bibliothèques et des dictionnaires ! des livres et des poèmes ! que pour autant qu’il y a des mots pour les dire et pour les lire ! des hommes pour s’inquiéter ou se délecter de leur saveur dans les bulles, les aspérités ou les accrocs de la langue. Dès 1943 d’ailleurs, et ce sera ma conclusion provisoire, dans un beau texte de
ses Pages bis, Ponge écrivait : « Il semblerait que je dusse préférer encore (à La Fontaine, Rameau, Chardin, etc.) un caillou, un brin d’herbe, etc. Eh bien ! oui et non ! Et plutôt non ! Pourquoi ? Par amour-propre humain. Par fierté humaine, prométhéenne. J’aime mieux un objet, fait de l’homme (le poème, la création métalogique), qu’un objet sans mérite de la nature (…) ».Fin de citation.
A. GIORDAN, J.-L. MARTINAND et D. RAICHVARG, Actes JIES XXVII, 2005 1
L'OBÉISSANCE DES MOTS ET DES CHOSES À L’ART
Raluca ARSENIE-ZAMFIR Université de Bourgogne, Dijon
MOTS-CLÉS : MÉTAMORPHOSES DES MOTS ET DES CHOSES – ART – VIE – PEINTURE – VAN GOGH
RÉSUMÉ : Nous démontrons par le biais de la peinture de Van Gogh comment les choses et les mots changent de rôle habituel au profit d'une signification renouvelée dans le contexte artistique, conçu comme monde authentique et sans faille, qui exprime le patrimoine vital de l'être humain. Notre but est d'exposer comment l'art constitue un repère fondamental de la formation humaine, afin de pouvoir retourner le regard vers l'essence de l'humanité, représentée par la capacité d'invention et d'expérimentation créative.
ABSTRACT : We show by the means of Van Gogh painting how things and words change their usual meaning in the profit of a renewed significance in the artistic context, conceived like an authentic world without fault, which expresses the vital inheritance of human being. Our purpose is to expose how art constitutes a basic reference of the human development, in order to return to the essence of the humanity represented by the capacity of invention and creative experimentation.
1. INTRODUCTION
L'art est une modalité privilégiée par laquelle la pensée se met en œuvre, pour que l'être humain puisse mieux se manifester, souvent grâce à des formes inhabituelles au langage quotidien ou à la disposition ordinaire des choses dans la nature. Nous avons choisi un moyen artistique spécifique, à savoir la peinture, pour démontrer comment les choses et les mots changent de rôle usuel au profit d'une signification renouvelée dans le contexte artistique.
Tout comme les sciences et les techniques, la peinture (à comprendre l'art en général) soumet et assujettit les mots et les choses, afin d'ouvrir les horizons d'un monde authentique et sans faille, à l'intérieur duquel l'humanité retrouve son patrimoine vital oublié à cause d'une existence trop mécanisée et trop aliénante. Notre but serait donc de montrer comment l'art constitue un repère fondamental de la formation humaine pour que nous puissions retourner le regard vers ce qui constitue l'essence de l'humanité, c'est-à-dire la capacité d'invention et d'expérimentation créatrice. Nous observons qu'il y a plusieurs manières de décrire ce que le monde nous montre : la science formalise la connaissance à l'aide des formules, la philosophie écrase les choses dans des mots à significations multiples, tandis que l'art s'exprime par d'innombrables moyens, que ce soient les mots dans la littérature ou les choses, comme le bois, la pierre, les couleurs et les huiles dans la sculpture et la peinture. À chaque fois, le signifié reste presque pareil, puisqu'il s'agit toujours de notre existence, mais c'est le signifiant qui diffère dans des contextes réflexifs différents.
Ce qui change est précisément le but pour lequel la pensée se met en œuvre : si les techniques essaient de schématiser rigoureusement et conceptuellement la vie, ce n'est que l'art qui saurait affirmer l'affectivité humaine et sa relation individuellement modulable à l'existence1. C'est pour cette raison que nous emploierons des termes comme « sensation », « métamorphose » ou « torture de la nature » pour rendre compte de la spécificité de l'art en rapport avec la science, sans ignorer le rôle important de celle-ci, qui reste un des moyens réflexifs d'exprimer le monde, fût-il par le biais des mots ou par celui des choses.
2. L'ÉTUDE DES CONCEPTIONS
Nous nous demandons, dès le début, si la peinture joue avec des mots ou si elle se sert exclusivement des choses pour manifester le monde. Notre hypothèse pose que les mots s'y retrouvent toujours, bien qu'occultés, se cachant derrière les choses qui s'écoulent dans des formes
3
picturales, qui se transforment pour affirmer ce qui a priori est inexprimable, c'est-à-dire l'intensité d'un affect.
La première question qui intervient, donc, dans notre démarche concerne la définition de l'art pictural. Selon les philosophes contemporains, l'art est une modalité exceptionnelle de s'éprouver soi-même en tant qu'affectivité : cette idée reste un lieu commun de la philosophie, quelle que soit son orientation, allant de l'empirisme métaphysique jusqu'à la phénoménologie radicale2. Autrement dit, « on peint, on sculpte, on compose, on écrit avec des sensations »3. Ce qui constitue la spécificité de la peinture en tant qu'art qui métamorphose les choses, est la sensation par laquelle nous essayons d'ébaucher le mondain.
Nous comprenons par sensation non pas des sentiments éphémères ou des perceptions douteuses, mais le pouvoir et le fondement affectif de la vie, sa manière pathétique de se rendre visible. Dans ce contexte, le mondain représente une « section » du monde dans laquelle se projette l'individu pour en choisir son espace de déploiement, qu'il range et qu'il ordonne selon ses propres disponibilités affectives, perceptives ou réflexives. En d'autres termes, le mondain équivaut au monde que chacun s'approprie par l'intermédiaire de sa pensée et qu'il tente d'exprimer de manière spécifique et personnelle. Ainsi l'être humain pratique-t-il son éthique de vie selon sa propre sensibilité et sa propre créativité, de façon que chacun manifeste le monde par le biais de son affectivité, donc de manière intensive et non-contingente.
Effectivement, la sensation que la philosophie contemporaine considère comme noyau de toute création artistique, n'est pas du tout la même chose que le matériau perçu sur la toile. Quelle est alors la différence entre les deux, comment une matière ordinaire peut-elle devenir expression artistique et sensation ? En dehors de la contingence du matériau, y compris sa visibilité et sa périssabilité, il faut y avoir quelque chose d'autre dans une peinture pour que celle-ci soit appelée comme telle et incluse dans le contexte artistique.
La différence qui rend possible l'existence de l'art est précisément le pouvoir que le créateur a d'investir les mots et les choses. Par la suite, le matériau qui participe à l'échafaudage d'une toile n'est plus une chose quelconque, mais une chose investie et soumise à la volonté de créer.
La sensation et l'affection créatrice pénètrent à tel point le matériau à manipuler que nous arrivons à peine à distinguer entre les composants. C'est en ce sens que Deleuze et Guattari disaient que « La sensation ne se réalise pas dans le matériau sans que le matériau ne passe entièrement dans la sensation, dans le percept ou l'affect. Toute matière devient expressive »4.
Pour mieux argumenter notre démarche qui soutient la métamorphose des mots et des choses, y compris la torture de la nature par une reconstitution artistique de celle-ci, nous nous appuyons sur des exemples concrets extraits de l'œuvre de Van Gogh. Le peintre ne fabrique pas une imitation ou
une représentation du monde réel, mais une transfiguration des choses qu'il touche et qui le touchent de façon à entrelacer le mondain avec la vie affective de son être.
Si, dans l'expérience scientifique, les choses sont manipulées pour rendre compte d'un état physique de la nature, dans le cadre de la peinture, le monde est renversé par une « hystérie créative » dans laquelle le peintre se jette pour épanouir sa sensibilité dans une multiplicité incessante des perspectives et des sens d'une même vie unitaire5. La relation entre le peintre et les couleurs qu'il utilise est tout à fait distincte de ce que la pensée traditionnelle dit : « Ce ne sont pas les couleurs qui se rangent sur la toile selon une représentation ébauchée de la réalité environnante, mais c'est l'impression affective qui colore la toile ».
La sensation, appelée aussi « impression affective », demeure au plus profond de la vie et de soi-même, mais c'est elle qui fait qu'une telle couleur soit à un endroit précis du cadre pictural pour rendre compte d'un monde potentiel6. C'est la raison pour laquelle on ressent une sensation profonde et vibrante lorsqu'on regarde le tournesol de Van Gogh qui, bien que figé dans une « toile fixe », exprime la vie « de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé », de façon à rendre « l'eau de la peinture à la nature », comme disait Artaud7.
Vincent Van Gogh – Les Tournesols
En outre, ce que le spectateur doit faire devant une œuvre picturale est d'arracher l'affectivité aux perceptions d'objet et aux états de son individualité, pour en extraire les sensations par lesquelles le peintre a investi sa création. Le plus important n'est pas de placer une création dans un contexte historique, mais de se l'approprier de façon individuelle en tant que coparticipant à son échafaudage, de s'y placer en tant que sensibilité et force créative, au côté du peintre qui supervise, d'une certaine manière, le jeu artistique. Devant une œuvre d'art, il ne faut plus rester contraint aux
5
apprentissage spécial par l'intermédiaire duquel il est possible d'expérimenter le fondement intensif de l'existence.
À travers le matériau tangible de la toile, le spectateur se transfigure au point de ressentir les sensations du peintre, au point de vibrer en même temps que le monde imagé. La métamorphose picturale joue donc, un rôle très important dans l'apprentissage spécial que nécessite l'art. Il ne s'agit plus d'utiliser les mots et les choses comme outils d'une éducation conceptuelle et scientifique, mais, tout au contraire, de les transgresser, de passer au-delà des apparences et de la contingence, de chercher en profondeur de la vie pour y récupérer l'essence oubliée de l'humanité.
À plus forte raison, dans l'odyssée artistique nous ne pouvons plus distinguer entre celui qui crée et celui qui regarde, entre le monde environnant et le monde virtuel, puisque les perspectives se joignent dans une multiplicité unitaire où il serait tout à fait hasardeux de démarquer les composants. Homme, monde, art ne
font qu'un. En conséquence, ce qui nous attire l'attention dans la peinture de Van Gogh est la façon dans laquelle le paysage pictural passe avant tout, même avant le percept, y compris avant l'individu qui perçoit (« Le Champ de blé aux corbeaux »).
Encore, des analyses plus approfondies de l'œuvre d'art nous permettent de parler d'une véritable « absence de l'homme », absence qui n'empêche pas la multiplicité unitaire de l'existence, mais qui la conditionne afin de démontrer que tout est en tout. D'ailleurs, Cézanne lui-même parlait de l'absence de l'homme qui manque du paysage tout en y imposant sa marque.
Arrêtons-nous pour mieux expliquer cette situation. La peinture présuppose la coexistence des matériaux (les couleurs, la toile, les lignes, etc.) et des sensations qui s'entrecroisent de façon qu'il est impossible que le peintre crée quoi que ce soit, puisqu'il se laisse porter par la composition elle-même. L'œuvre picturale se réclame alors d'un perspectivisme virtuel ou visionnaire, qui rend visible l'invisible, c'est-à-dire l'affectivité profonde de la vie. Dans les toiles de Van Gogh, les personnages cessent d'être des individus historiques pour se dévoiler à eux-mêmes et à nous comme réalité affective. Le manque d'historicité va de paire avec le manque de représentation, à savoir l'absence des choses objectivables, au profit d'une expression renouvelée de la sensation.
En effet, dans « La Ronde des prisonniers » il n'y a pas besoin des mots pour révéler la pesanteur de la détresse et le silence d'un désarroi anonyme, ressemblant aux visages des détenus qui continuent leur comportement machinal. Le sentiment est tellement puissant qu'on entre dans le délire de la prison sans même s'en rendre compte ; le passage du spectateur dans cette atmosphère lourde est presque imperceptible, de sorte que le mouvement en cercle reste contraint entre les murs enfermés auxquels l'éloignement du ciel accentue le caractère accablant. Tout est trop plein de vie, fût-elle en détresse, qu'il est impossible que la toile exprime un vécu historique des humains, mais plutôt un devenir incessant et spontané de celui qui la peint, de celui qui la regarde et de ceux qui en font partie.
L'« athlétisme affectif » dont parlait Gilles Deleuze dans ses analyses des peintures provient en réalité d'un excès, d'un trop-vivant difficile à éclaircir par des manières conventionnelles de la communication, ainsi que le langage naturel ou la manipulation scientifique des choses. Pourtant, il s'agit toujours d'une expérimentation, mais, cette fois, elle est essentiellement affective, c'est-à-dire invisible, mettant en jeu l'immanence de la vie et la sensation vivante. La peinture relève dès lors d'une manifestation individuelle de la sensation qui rend compte du mondain en tant que métonymie artistique de l'existence entière.
Le graphisme parfois aléatoire des peintures de Van Gogh trouve des modalités insolites pour transmettre la pulsion des paysages sensibles. La lumière et la couleur se confondent, tout en conférant aux choses une réalité plus accentuée, voire un surcroît de présence, renvoyant à ce que Marc Richir comprenait par l'excès de la vie8. Dans le contexte pictural, ce qui excède les corps, les choses, le monde, c'est toujours la vie en tant qu'affectivité à dévoiler pour que la multiplicité de l'existence s'achève dans l'unité de l'être. C'est la raison pour laquelle Van Gogh consacre aux choses une affectivité vibratoire qui renvoie le regard vers l'intériorité de l'être, vers son intensité ardente.
Par la suite, nous remarquons que ses tableaux expriment toute une palette de sentiments, aussi divers et tourmentés que la vie. Si la quiétude et la richesse ressortent de l'harmonie apollinienne du jaune et du bleu (« La Plaine de la Crau ») qui vient à la rencontre des bémols aussi choquants qu'équilibrés du noir et du vert (« L'Arlésienne »), l'angoisse aiguë se révèle par l'hystérie criante du
Vincent Van Gogh – La Ronde des prisonniers
7
sensations, au-delà des mots, des couleurs, des choses, pour recueillir du monde environnant uniquement des appuis affectifs pour rendre vivante la création.
Vincent Van Gogh – La Plaine de Crau
Vincent Van Gogh – L’Arlésiennne Vincent Van Gogh – Le Café de la nuit
Aussi pourrions-nous dire que le véritable but de l'art est d'entraîner les êtres dans des tourbillons des sensations jusqu'à ce qu'ils puissent d'eux-mêmes se retourner vers le véritable sens de l'existence, vers l'éthique de la vie, vers l'indissolubilité de la création selon des hiérarchies de sexe, de race, de nature ou de société. La peinture se situe par elle-même dans une zone d'indétermination totale qui réunit à jamais, dans une même pulsion affective, homme, matériau et sensation. En effet, on passe au-delà des mots, puisque tout est déjà exprimé par l'intermédiaire des choses, elles-mêmes métamorphosées grâce au contact qu'elles entretiennent avec le créateur et le créé.
Il est évident que le peintre part a fortiori des choses qu'il perçoit et qu'il touche pour en déterminer la consistance, mais il crée son propre monde, avec un ordre potentiel et différent du quotidien. C'est pareil pour le poète qui manipule les mots, et les mutile de sorte qu'ils acquièrent la même
9 impulsion acharnée de peindre
d'autant plus éloquente que « la haute note jaune » explose sa consistance dans plusieurs variantes des « Tournesols », au point que le créateur se confonde avec ses ébauches végétales9. Avant de souligner une dernière fois les enjeux de notre analyse, observons que les autoportraits10 de Van Gogh portent témoignage, eux aussi, de la tension immédiate de la vie qui surgit d'une composition picturale où les tons rompus se mélangent à l'inertie assourdissante d'une couleur homogène et parfois excessive, s'efforçant d'exprimer l'infini (« Autoportrait »). Le peintre
disait : « J'ai fait un portrait de moi pour Vincent (…) Le dessin en est tout à fait spécial, abstraction complète (…) La couleur est une couleur loin de la nature ; figurez-vous un vague souvenir de la poterie tordue par le grand feu. Tous les rouges, les violets, rayés par les éclats de feu comme une fournaise rayonnant aux yeux, siège des luttes de la pensée du peintre »11.
Presque tous ses derniers autoportraits le présentent le visage légèrement tourné à gauche, comme pour dire qu'il cache son oreille coupée, le regard très angoissé ou au moins si troublant que tout ce qui l'entoure se contamine de son désespoir existentiel, dévoilé par des coups de brosse impétueux donnés dans le fond.
L'importance des couleurs s'accentue à chaque fois que le peintre y touche pour donner plus d'intensité à son visage, pour mieux décrire les pulsions troublantes de sa vie. La puissance de son regard, un peu oblique, plutôt âpre, joue le rôle d'un cri perçant intimement articulé par une technique picturale unique, qui réunit impressionnisme et pointillisme à la fois, afin de parvenir à un style où les touches du fond semblent raconter le devenir d'une déchirure vitale, alors que celles du visage suggèrent la tension infernale d'une pensée inachevée.