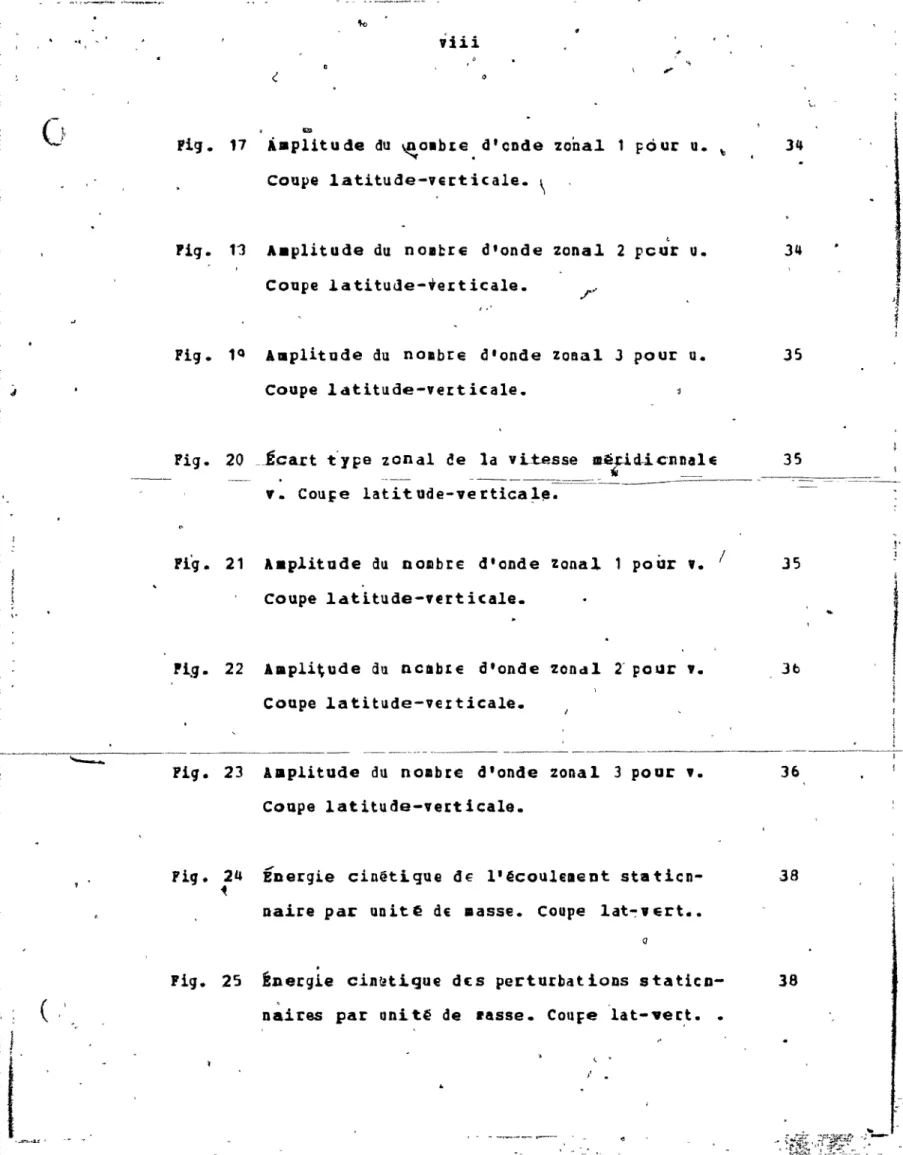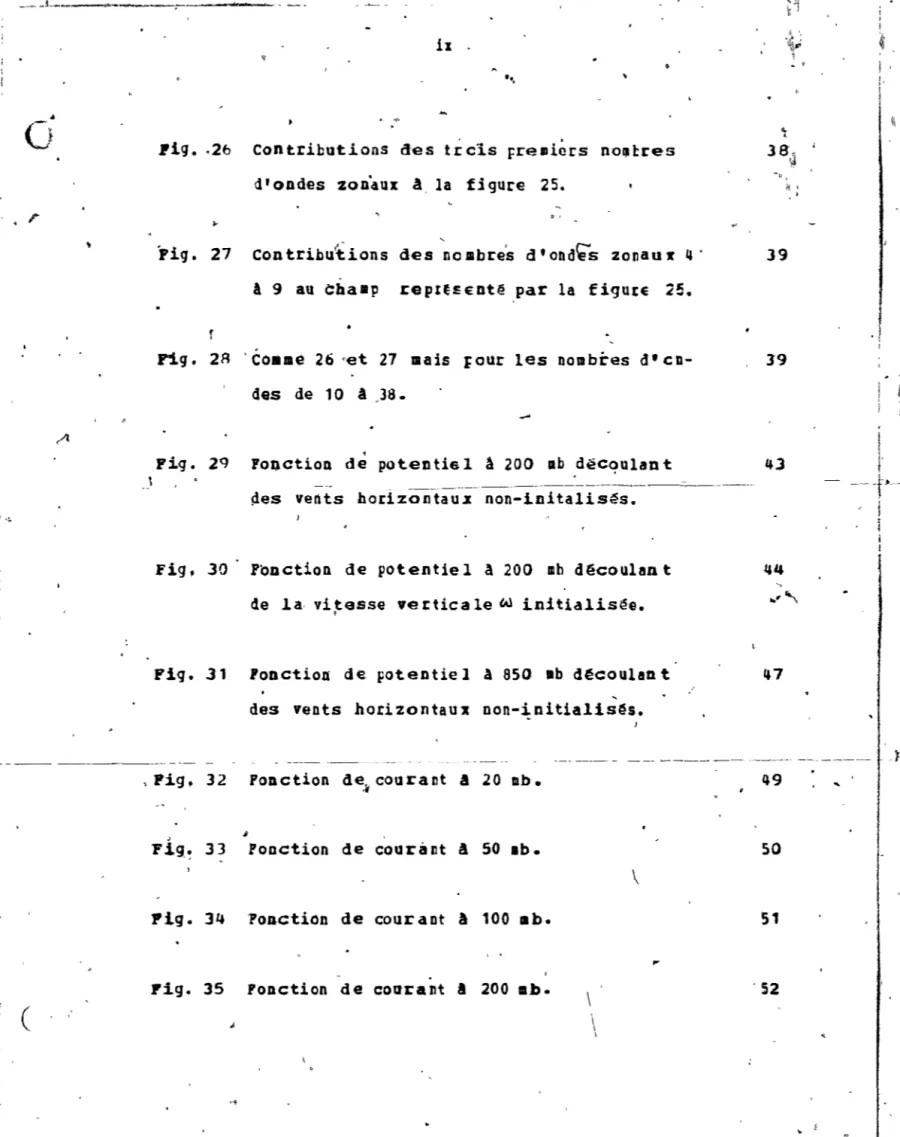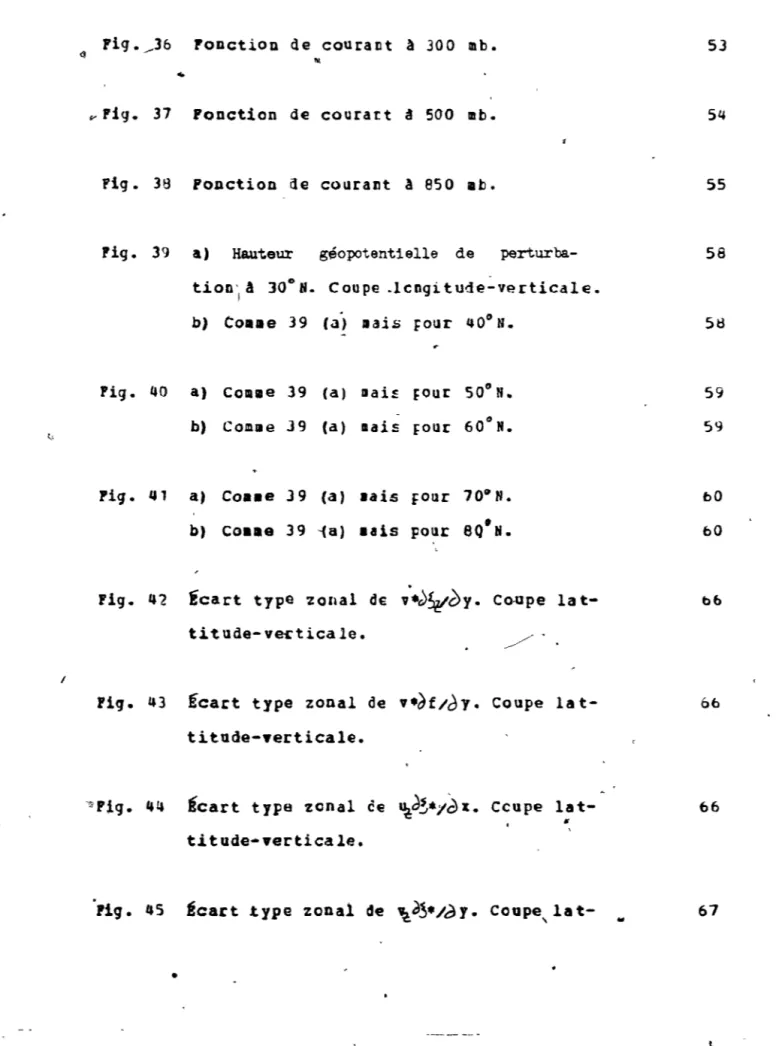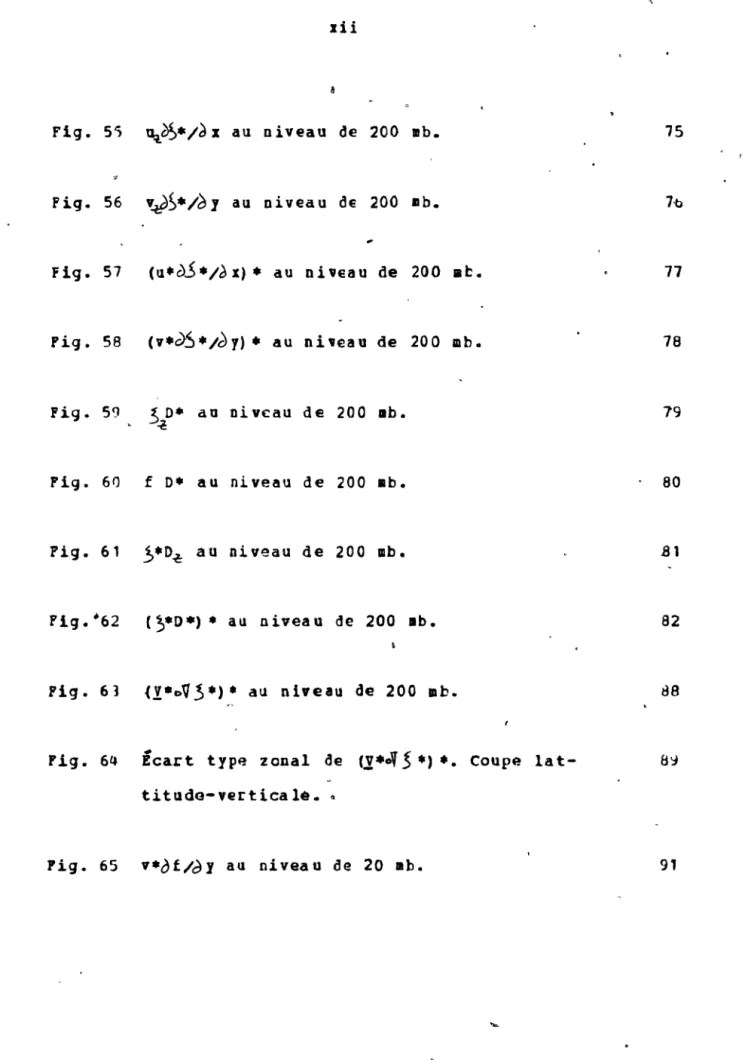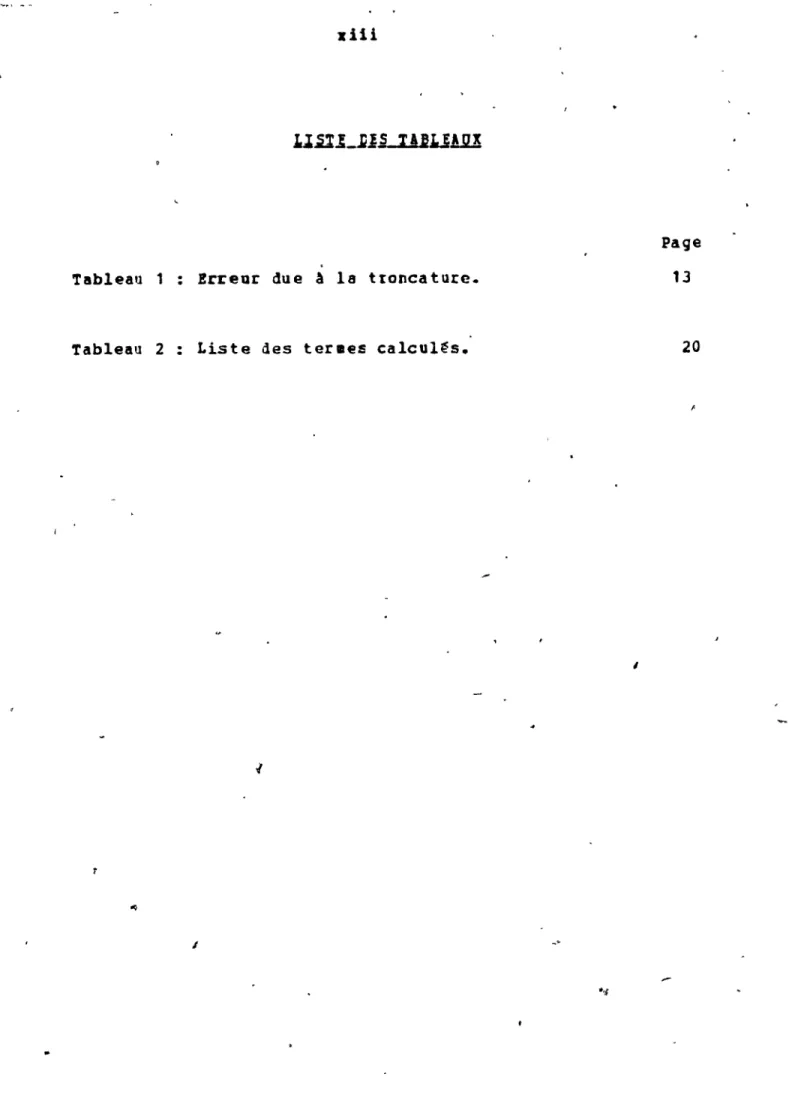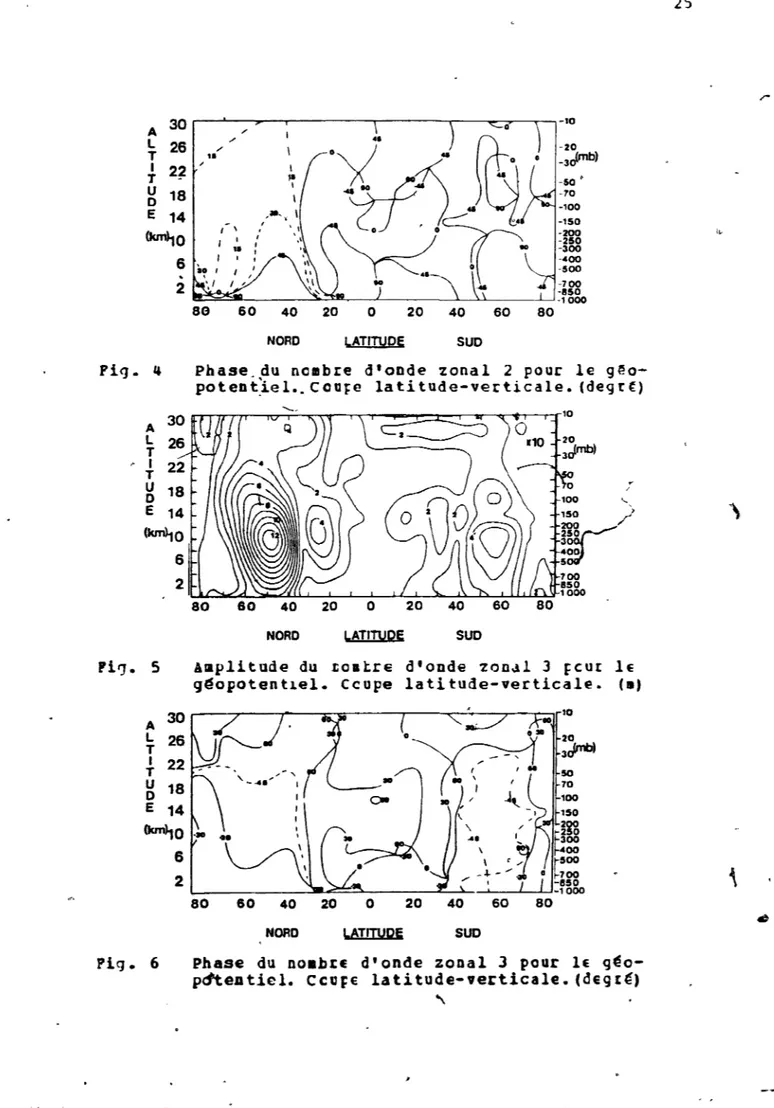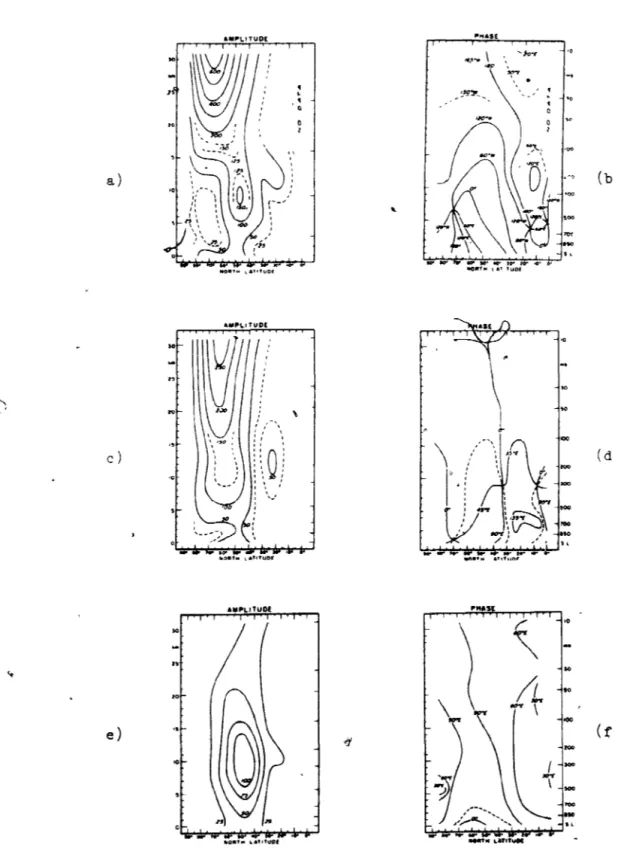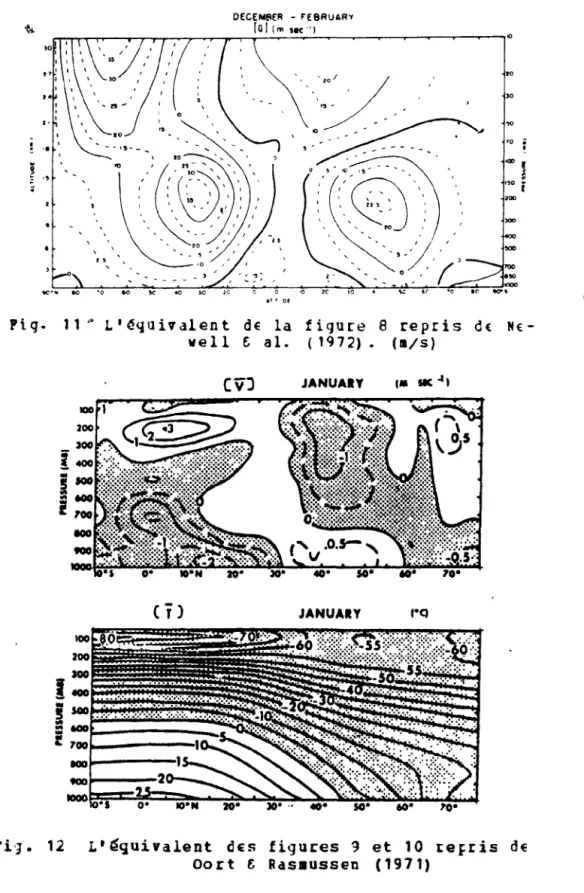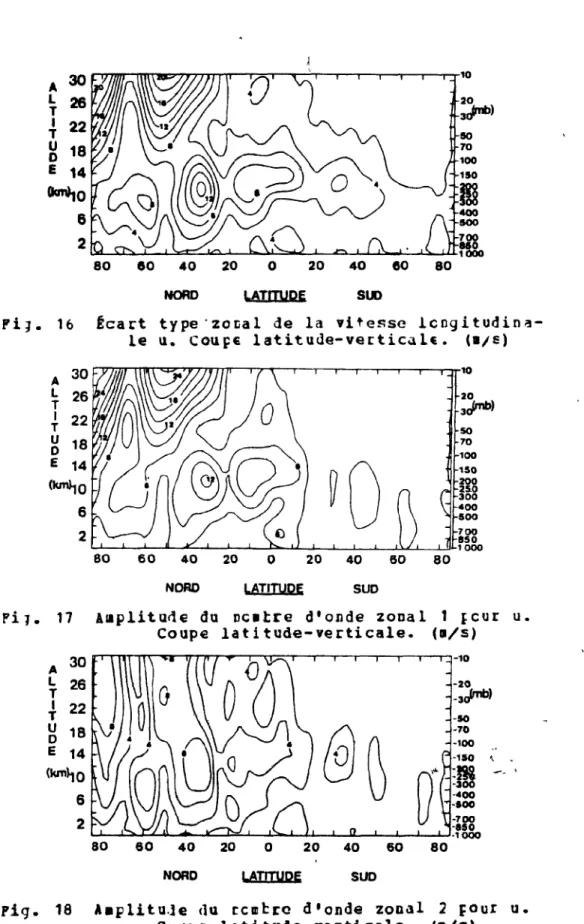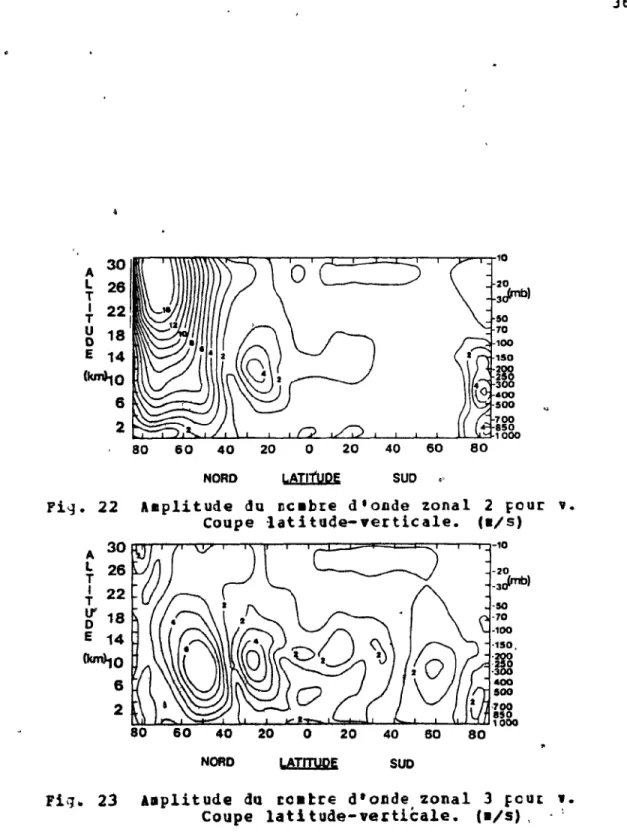r
L1
1
f..
.
---~----.
~ ,.
•Etude diagnostique de certains termes de 6.
lt~quation du tourbillon stationnaire
non-.
zonal selon les donn~es de FGGE (jan. 1979)
1
, "
par
©
Be+nard Dugas~moire présent€ à la faculte de recherche
•
et d'~tudes gradu€es en vue de l'obtention
du qrade de Maltrise en Science , • 1
,
,
t ' Oêpartement de M~t~orologie Universa.t€ Mc Gill Fevrier 19B3 Montrtéal, Québec .Q 1..
.,
,
'"
o <,
(
'. l,1
i..
,ut:ilisant les donn€es provenant de 1 texpérience FGGE
(en fait les donnties du niveau Ill-h)" nous ~valuons
l'importance de certains termes de l'~quation du tourbillon
s1: ationnaire nono-zonal . Nous npus int€ressons
aux termes résultants de
/
~.
.
\part}cu11erement p;oduits de
,champs, dit$ non-zonaux, de déviations de moyennes longi~
,.
}-tùdinale's par· rapport aux produits de champs' zonaux,
moyennés en longi,tude) ét
non-zona~
les termesnon-lin~ai-re'S et lin€aires, respectivement. Ceci es.t prédédé
fi
'une couti" 4'_4't~ analyse diagnostique des champs u, v, T et de la hauteu.r
.
gêopotentielle 't", tous moye~nés dans 'le temps sur la duree du mois de janvier. G
.
.
- - --.
,
1.,
) , .', ",
{
l1
,.
.
-.
•
',' levelterms!
1usinq
!II-b ,.
, : l.~'.;" , ... : } , "1 ii .).
' ...
A»S'l'RACT·data from the: FG,GE
"e~p8-rimeht.1'
,in. factdata,. we
e:valuate' the
~~ort:nce
ofce'r~;!in
• ~. ~ ,,~ t \
in the li
~ta.tiona.rY non:-:to~al ~orticity equatio~·.
'fie - "
'are
especially intereste4 in compai~in9 the linearan"
non':', \..
-,
" ,l , ' " ' r '
-linear ~
terms.
This is precèded by a short diaçnost.ic study".. ' 1 t
_, ' 'of the n;-e~ monthlY·,fields of u; v, T'and .' \ 'qeopotentfial
height
z.
.
..
\, ~ ... " 'f! -, , ,.
"' , ,u- - - -
--'-'_._-~---.,.----~~.'
11
"..
, "..
, , 1 } , '"
1
1'1
.,'.
i
f
. f
,0
"t
. ; / / ;{~" f
. t 1 ; !: 1..
, (J
1 1 .L_
' / ,/ o , , i i i (. ,,
~:...
Je tiens A relercier Dr
Jacquès
b .• colle '9u~.a tit~9ti_ ce.
"-.(i~oir~'. Ua' a@ae, je tiEns
a
relereier al,le 't~'Dc~...
tiDet '., ,
Carbonneau pour,. avoir rElu le lIanuscrit -. et ~n avoi't' " ' • <).
.dactylo9ra,llhi~ une importante Fartie. :
Finale.ent,
'1e
reaei:éie
le
'eonseil ~E ·a~Cit.'ÉtChe e~.,
,SCien~c et en Gêllie ainsi Ci,Ue ~ D~parte.e~t de. lIS""otol~qie
de l'uniyersitl Be Gill p~ur
leur
so~tien f16anclEt tout au, , ' long ~e aon Sfjout
a·
è:ette institution
.-L ~ .. • ~ ,.
.' ~.
-,,,"~ ,.
-'1 f .:: ---~-.
\ , , 1 " " Il , . , 11.
' 0
l'
L",: "
11:7,~-"--~""-'-'
, J./
\ .,.
.
..
, -j, ~ .. _." ... - - - ...
, rl\'
j' ',. . iv , '//
0
_,
· lL_
-""lA,au..Jël.Ll1Alilll
ES,
1r ( il(
•
•~'
Abstract •
l',..
•~
~able des aatiêres • ,
..
, l
Liste des ~~.qures • •
Li-ste des. tablea
Ulr •
CUAt»J:Tij E l
.
"! l N'I B9'Duc
'lION:,
..
'\.
'''''''-jl; 1.1 Historique,..
t' ~1r ~ 1.2 PréSen tat,{oD • ,CHAPITRE
IL
: LES T!BftES C l.z.CO~!S.2.1
D~rivation dester.es
2.2
DêteraJ..nons 1es ter.cs 4 calculer2.3 . Approche spect.rale
2.4 Calcul du tourbillon
2.5 B8capitulation •
•
..
C81Pltn! III :, LES CnlrlPS tE éAS!
j
"
l
,---....:-=..-... -- '"
'~-'-~"~ " "..
~---
---·
--
.
• • •..
• • • •J
•..
• • •..
• ft •..
• , --Paqe i i i~
iv' yi xiii 1 1 J 5 5 8 9 15 19 21 --~--<f"''''.'''''''-)"!., . ,."
!l
l
1 1î
,
i ~ , ,4
..
,1 l
•
, 1.
''.
\.
y ' o..
3 .. 1
G~nêra1Ï. t'6s , ," •..
.,
• 3. 2 'Co"parai90n~ aliaatolog,iques • • 3 .. 3 ' W et la ,fonction de Foteptiel •3.4 Le cliJlat de jan~ieI: 1S79 (approche synoptiquET
3.-5-
Conclusion
de 1-4nalysE •..
•.
'CRAPtTa B
IV
: ' 1.BSB!:SOt'IA7 S
D!SCALCULS."
·
't
,
\..
4.1 Ana. lyse cl f 'cbelle •
~ q.2 Les r~sultats
..
•-,.
q.3Conclusion
••
-.".
0 -~,
CHAPITR B V • • CONCLUSION-.
~ APP EIDtCE. • • J•
&.1
Lecalcul
de User •~)
j
... 21 '2,2 40 61 62 62 ~ tl4 . 90 93 94 9q..
/
" j ,1
1 - - - . - - - c ; - ----1 ..L
1 laBIBLIOGRAPHIE
..
• • ~6 l.
t ~\
1 1",
..
1 1 .. ' , .. <'~ 0 1..
, -.' ':- ;:-~~jt:Jt;~:-:,-: ~:,
/ . . l , ! , ! ~ ' . ~ • • ,r , -:.
.
,';.
---' ... ""'..." •• _ . - - . " .. ~.~-_ ... r~".~-_' .. ~I-""''''..! - . -:... -,,- '\ù.
, ..
'.
' "'.
/ Pig. 1 . , , , ' . , " , " f i ' ,.
-
-, > ~l~f'-iJ~_rlG~~ • 1 • ~ ,-
, , "'.
" ' " .,' ,.
-" '\
pa(i~, . ',' ~4""Pl~,t ~de, dUo' no.bE~ ~ '.onde, zo~al,
"
P,~ur il~,
~ gGopot,E.ntiel. COu.;è latitude-vGtticale. ."
..
'."
Pig •. 2 ~ Phase du nom brcoe .4 'ollde
zonal
1 polir le 9~O potentiel .. Coupe latitude-ver"ticale • .Fig. 4
.
..
lllpli~ ude du nOllhtE "à 'onde zonal 2 pc~r lE,, 9êopot/ePt~el. COll,~ la'titude-;,ertièalE! c
"
. 1;
.
Phase du DOlibre d'cnde' zonal 2 po~ ,le gCt,':'
, '
, ' .
, ,
, ,
,Pige S. lllplit,ode dl.l nOlbIE (l'onde zonal 3 p'CU\F lE
24
. .'
,,.
, 24 ,2.5. ,.
, 1 ! 1:' i· i_ _ , _9l!Opot Et D
Ue
1. C oU'ie.::l;::a-=-ti:::..:;.t.;:Ud=.:e::..-~v;.,e::.:r::.t::,::t:.::''c:.::a;::.:l::.E:..:~:!..\
,
_ _ ...:...,-_ _ - > -_ _~' ~" ~'+-
, " ,'.
\
,Fiq. 6' Phase ,d,u DO-bre d'onde %(;Da-l 3 pour
le'
~io-.-
.'
25.
,
potentiel. coupe la~i\,u~e .. ,qrticale. ' . . '
t
!..
' 1 ,'
,
.
"ig~ 7 li.' ê<Jlli'Yal~at
des
figures' 1 &, ,6,_ repri.s de ' 26· ...1
(ff.,
..
Ya.n Loon '(t973),~ t~ 7
Ca)
,à l ',1
,~
,
( li.. • 1
,l19 ~ 8: '. JloyeDlu1 zona'lG d·e la. v1tes-se lonqitucliDIl:e . ·29 - ' . ~,
i ' , ,~ . .
-'
(
Fig. 10..
... '..
' 0 , ' .. ii , Il!oyebDE zonale de 11\ vitesse-·II~ridfonoale
Y. Coupe la~itqde-verticale.
1!oyeo.ne zonale de la tellpec-dture T.·Ccu.pe
. '
latitud~e-'Ier ticale.
.,
Fig. 11 L'l!quivalent de la figure 8 repris dé
Ne-well &- al. (1972)
" '
"
•
Fig •. 12 L' ~qui valent des fic'rurt?5 9/ . .7 et 10 'r~pris fE .;::;-Oort & Bas.usseu (1911)
JO
30
" figeo 11 Aaplitude du nOlldre d'onde zonal'" 1 P()UL' 14 32
teJl>pérature. COUpE latitude-ve'rticale".
__ ~_Fig •. ~, .AIIP~t~ude du no~c3'onde zonal 2. pour la 0
telllpérature. Cou'fe latitude-verticale.
Fig. 15 laplitude du n'oabrE d'onde lonal 3 peur la
te.p~ratllre. ~o'upe latitude-vErticale.
Pig., 16
!cart
type zonal d~ la '., i tasse long itUdiaa-le
u.
C'oupe latitcde-verticale.i.
..
'.
" 32 34 j 1 . l' i1
î1
1
, t
viii
(I,
DPi9. 11 implitude du ~o.bte. d' cnde 'Zona.l 1 pour
u. "
34coupe latitude-vErt i cale.
,
<
Piq. 1'3 A.plitude du nOlt:re d'onde zona.l 2 peur
u.
34Coupe la ti tude-l'el: t icale.
.r'
Fig. 1Q Allplitude du nO.bIe d'onde 'lo8al J pour u. 35
Coupe latitllde-ver:ticale.
Fig.
20
_--fcart t'ype zonal dela
v i.-tP.sse ~d-i.c'nDalE 35
-~---~----Y. Cou~e latit ude-ve ttica;L~.
j'
Pi'q. 21 A.plitude dll nombre d'onde zonal pour t. ! 35 1
1
1r
Coupe latitude-vert icale.
i
~ li
\ .
..
1
Pi,q. 22 Aaplitude du nCl'lbIE d'onde 'Zond l 2' pour Y. lb !
i
Coupe la ti tilde-vu t icale.
- - -
-~---.
----
Pi<]. 23 Aaplitude du noabrE d'onde zonal 3 pourv.
36Coupe latitude-verticale.
11q. 24 Énergie cinétique dE l'êcouluent staticn- 38
~
Daire par unite! dE aasse. Coupe lat~"Ert ••
C)
.
F1q. 25 Énergie cin~t.i9ue d€:s perturbations staticn- 38
(
\naires par uni tê de .asse. Coufe lat-vert.
,
"j ,~
, r
(
",
",
1'1g • . 26 con tribut ions lies t r cls fralliers noratres
d' oodes zoo'aux A la fi gure 25.
Fig. 27 COD tribu'tions des no IIbre's d' ondt;'s zOl'lau r 4'
à 9 au èhamp J:epItEEotê par la figUtE
f
F'19'.
2R 'co.lle 26 <et 27 liais ~our les nombresd'CD-des de 10 à )8.
.
-
,39
39
Fig. 2<} Ponction de potentiel â 200 lib décC?ulant 43
"J - - - , - - - - : c -_ _ _ _
!les vents horizofltau.x non-initalis~s.
Fig. 30 Fonction de potentie l c\ 200 lib dêcouhn t
de la, vitesse , verticale lAl initialis~e.
Fig. 31 PODction de potentiel c\ 850 ab découlant 47
...
des vents horizontaux non-initialis~s.
l ' , 1 1
.
1r
1\--t
L --ji
i 1 ~ -- ----
- - -- ---" ---- - - -,
-,Pig.32 Ponction de~couraflt 4 20 lib. "9 , ...
> ~
FJ.g. 33 l'onction de couràflt â 50 lb.
"
so
\
1'1g. 34 'Pollction de courant â 100 lib.
51
,.
Pige 35 Ponction de courant A 200 Il.b. '52
,/, \ \
\
b '-:~ ~:i\'~~ J'
_---()
4"
, f l t•
1(
Fig • ~36 Fonction de courant à 300 IIlb.
..
•
.,Fig. 37 Ponction de courart ;! 500 IIlb.
Fig. 3B Ponction île courallt à 850 lib.
Fig. 39 a) Hauteur géopotentielle de perturba-tion '1 à 300 H. Cou pe .lcngi t ude~vertical E.
b) Co •• e 39 la) lais four 400 N.
Pige 40 Pig. 1.11 Fig. 1.1'2 P1g. 43 Fig. 45
•
a) COllllle 39 (al lIai~ ~our 500 N.
b) Comlle 39 (a) lais ~our 600 N.
a. Co •• e 39 Ca) • ais four 70" PI •
b,
Co •• e 39 -(a) • ais pour 8Q'N •icart type 'Zonal de
;.))~~y.
Co.upelat-titude-ve~ticale. / "
Écart type zonal de
v·df/d
T. Coupe lat-titude-verticale.
icart type 'Zonal èe
~d~.td:t.
Ccupelat-#<
,
titude-verticale.
icart t.ype 'Zonal de ,\~~./~y. coupe,
lat-53 1 ,
,
~ 54 ~1
• , 55 58 58 59 59 bO bO 1t
.
bbl
t ; l,
ôb b6 i!
671
..
(
titude-verticale.
Fig. 46 !cart type zonal de (U.oS./~X)~. Coupe latitude-verticalE.
Fig. 47
latitude-verticale.
Pige 4q Écart type zonal de S~D
•.
Coupe latitu-de-verticale.Fig. 49 Écart t'Fe zcnal de
fe-.
coupe latitudE-verticale.Fig. Sr) Écart type zcnal de ~.D~. Coupé' latitu-de-verticale.
'§
Fig. 51 Écart type zon~l dE (S.O.)
*.
Coape lati-tude-vertica le.Fig. 52 tcart type zonal de la somœe des dix
der-niers termes. COUfE latitude-verticalE.
Fig. 51 V*D.3a.~,
aU
niveau de 200~ ab.fig. 54 V.dt/~y au niveau de 200 .b~
'-67 . 67 68 6b 60 69 69 7] 1 !
!
1
,,
i
1
l_"
(
Iii
fig. 5'; ~~*/d li: au niveau de 200 lib.
Fig. 56
Fig. 57
Fig. 59
v.JS*/~ 1 au niveau dE 200
(U.O..s*/d x). au ni vea u de
~O. an niveau de 200 lib.
~
Fig. 60 f 0* au niveau de 200 ab.
Pige 61 3.D~ au niveau de 200 mb. ab.
200
Fig.#62 (~.D*). au niveau de 200 lib.
.b.
Fig. 6]
{!*DV.3.).
au niveau de 200 lib.F 1'1. 64 Éca.rt type zonal de
(!*oV
5
*) •• COUpé lat-ti tlldo- vert ica lé ••
Pige 6S v.c:HldJ au niveau de 20 lib.
: 1 15 1 1 7'b
1
F , 77 78 19 80 .81 82de
91()
Page
Tableau 1
·
Erreur due à la ttOllcature. 13·
•1
Tableau 2
·
Liste des ter.es calcul~s. 20 1·
1 1J
1
,
(
L
..
, l
\
(
'.
1 1 .. 1 Historil;4ua.
\l'€tude des états ~tatioDnairES de l'atlosphêtE D'est
pas chose r\cente en .~t~orolo9ie. cette ~tude s~ fit (et se
fait encore) . selcn trois La prelière,
diagnostique, se Odse sur des s~rlES d'otservdtions de
cha.ps tels les vitesses .~ridicDnales et lODqitudinales, la
teœpèrature, l'huaidit{ et le y'OtoteDt~~l peur idEn~if~er
les ondes stationnaires ~r'stintes et d~terœiner leur
~.portanc:e ,par exell~l(l, van Loon (1973». EncorE: ddns le
Ccidre de ctltte allproc:he, d'clutres utilisent ces données four
calculer certclins teLwes des ~uations qcuvernaot les
lIOuvements atllospb~rigues statioDnaires
Saltzman fi Sankar-Rao (19bJ), Sdsallori fi YouDljblut (1980) et
Lau (1919». Enfin, d'autres encore, tel Holo~aineD (H70),
uti~iseDt ces dOnDtl~S !Jo ut faire des calculs
transformations êner9~ti~ues
d'un
étatA
u~ autre.Il
estclair que les r~sultats ainsi obtenus d~pendEnt lnorm~meDt
1
de la ~ualit~ des dcnn~e!.
La SEconde at-!oroche ccndste
a
ut.1liser des lodlllesst a t iODDciires, lJên~ra~elleDt ëans
la
d~terminatioD d~s caract~r~sti~ues ~ea ~tats stationnaires.
'\, ,
Les travaux de CharnEy
&
EliasseD (1~4S), Saagc,inski (19~3,j
1
f
f
t
1.
et Wiin-Nielsen &' Detoae (1911) sont dE ce ,type. On };-rcblême St! {-osa.Dt alors est de,\-savoiJ; ~uels t~r.es ign~tEr Et quels
termes cc~serVEr dans l'ensemble
Il
sérait iotèressant de CODoattre l'ia};-oItance relativé
pour les résultats de éette simplification.
La dernitre apFrocbe tient A l'utilisation de .où~les
de cil."cullition g(fD~rdle (Gl:M), int~graJ!t nUI~.til.:juEalEnt alios
le teml-s .les ~~uatiots utilb.ant
ditf~reJ!tes ~atamêtrisations peur Ie~r{senter les ~b(r.oIOoes
\
de peti tes échelles. A~nEi ces GClts pa'rvi€oor:n t
a
si œuler l~climat et llcn peut alors detei.iner les ccm~osdntLs
stat~onnaircs de cc climat s~lul~ et les ~tudier. Cn aura
ainsi corriy~ 10 Frobl~.e du mangu~, de dcnn~es de la
premi~re clpr-roche. ~clr contre, i i Le sera pas toujours clair
81. ·l'on nt~tudl.e ~as plutet la cli/llcltologie d(s dittêreutes
trOJ!Cdtures si l'on ut1.1ise une méthode SiEctrclle, dCb
di 11 ~r entes rCsol.u tlcns 51. l'en u tillse un • (tnode, de
~rilles, des diftérent~s para.~trl.Satl.CDS etc • • Kdsahdra
&
,
al. (1973) et"'uayasll1. & Gplder (1917) ont rtê\llis( cc type
d'étude.
tn ce ':a.ui concerne le lr(lEcnt travail, nous nous
propo5~ns essentiellement de t~al1.scr une étude du ~rell.er
ty~e, c'est-&-dide dia9Dostl.gue, et de s'adresser au
problême de ,l'importancE
,
relativ~-Jlon-luléclires dclDS l.' ~~ucltioD du tourbillcD statiOnQàir~
tels Lclu et YoUnyblut &
." 1
1
•
f
i
,
t
1
1
-~--_.- ~_ ...._---(
/
, f o J,
Sasa.ori se sont inUcE!ss'S A ce ~~oblême. fiais, nous aV'ODS
i
~ujou4d'bui l'avantage
do~n~es de grande 9Udlit~; lee aonn~ee du niveau ~II(t) de
IGGE (ritst Garp GlolJal Experime.llt), uu anse.tlc globrll de
ha ute .dLEolution dane le t'e"~s ct l '$s"ace.
Hos r~sultats devraient nota.ment n~us dCDnÈc une id~e
de la valeur de l'approche linêa~re utilieee dans les
aodêles stationnaires fr@-citts et ,de l'orientation future
de la reCÀercbe dans ce domaiae, i.e. vers l'incc~Eo~dtion
de ter .es Don-J.iné'al.ces s'a v€ran t re lat1 ve.e Dt il .. ortan ts
ou, dans le cas contraire, vors une lIeiU.eure d~ter.i!&atio1i.
des "Forciny" et conditicns trcntl.êres. par exemple.
1. 2 l'r~.senta tion
les différentes ~tafes de DctLe recberche, le deuli~aa
-Chapitre donne le cadre th€origue et ~ratiyu6 nécessa~re
.
~i.e. la dGterll1nation des ter.es A calcul~r. les •• thodes de
calculs et les ~LreUtS possibles qui en découlEnt.
Le troisiême chapitre coctient une AnaJ.}Se des .chdm~s
de oase de ltiGE et (je certdins cha.Es calculE's. tels le
tourbillon et Id divErgeDce. NCUS les com~a[ons avec ce qui
est clillàtolog1gutlaent connu.
a
lEur ~ujet. Frinc;ipale.~ntPOU4 d~tec.iDer jus~u'a ~u~l point les r~sultats dES calculs
pour janvier 197~ sont repr's8ntatiLG de l'Otat "Dor.al" de
1 \ \.
1
1
1
" •
l'ataosphêre de jan vier.
Tout ceci
sU~ijoseles
donnfies de
lGGE rep~~sentEDtbien
l·at.os~h~rEdu Doi$
en question. Co •• e
DOUS
le
Y~rr~nsdpns ce chapitre,
ceD'est
~astoujours
le
cas,notaaaeDt
En ce ~ui ccncern8la
Yi tesse
verticale.
• 31
Joe CjuatJ:iêlle et dernier . chapitre .
p_rlsente
les
,résult4ts des c<.llculS -et
tent.
ara,
daDala
assure ob c'est0
>
possible, d€:
co.parer
ces r€sultats aVECce gui 'tait
e
pr'alatJ.eacnt CODnu
a
leur
sujet.•
j ;i • 1i
•
i
1.'
1
~ 1 ft
1
,..
1
j..
.
.
J
(
,
L
.
,,
\(
<\
5. .
HouS dt!finissoDs dans
1 CEchal-itrce
lES
~otatio.Ds~
utilis'es
sUbs~quea(.eD tde
.~.eglle
nous
ir(eisons les
.
.
terlles ~ui·seront eal~ul~s dans
le cadre de
la
ree tere
Ile.'2. 1 Dérivation des termes
Soit l'~~Il'ation vEctor:iElle
dll
&oa"nt en ccoJ:donnéesde pression
p:
o~
v
=V
p f ' le graditlnt hor i%o~tal;~
:: ut • •
~.l
,
la vitesss bocizontale,
W : dP/dt , la-
vitesse
verticale, ~ • yz , le ~€o~oteDtiel,5 ·
~.Vx! ,'letourbillon
relatifvort.,
1 :
fl=~~SiD~ , la cOIiEosant' ~Ertical~du tourbiloD flanCtaire.,
l.M ::
1 ,le
J:.tottelent hocizoDtal,et
(t,),J)
est la base crthonor~ale locdle.l
En considérant que
fi. •
J
+. t dltinit le tourbillonvertical
totAl ~t en prenantlé
rotatioDDel del'équation
J
J
l1
•
:j]
-, t !•
1
if
ir
i
(
l' \.
.
.
(1), ~.e. Xofij x (1), on obtient l'~yuation d'~volution du
tourbillcn. ceci nOU$ d?nne:
• ( 2 )
Sëlon l'apprcche de Saltzman t Sankax-Bac (1~o3),
l·~tape suiYant~ ~st de aoyennEc l'é~uatioD (2) dans le
temps, ~uis~~~. nous DOUS int~ressons aux
stationnaires.
Mous
d€Linis~ons ainsil'opfratEur
"molennedans le temr.s"
l
t/'1/ J.~ (to ) ::: 1jT l (t') dt' ,
tO''1/2
( 3
ùe
telle sorteyue
~=
1
+ j'... 1
Lu d~pendaoce de X sur t~ , le cEntre de la ~étiode ob
l'on ette~t~e ~ moyenne est r€~~l~: on n'ottiEndrd p4S le
•
.>
iOme r~sultat en jaDv~er yU'eD juillet si Itoo prend X
=
T,-la
teap.fra
ture,
t'ar exe.ple. CEe i xait. yueT
Cto) ;T
(t. -) ;mais la ditf4reoce n'est fas siyuiticative dan~ notre cas et
l ' OD peu t SUppOSEl: rj ue ~ ==
X.
si l'OD d~pli~ue l'o~ératEur (3) l l ' {guatioB (2) , on
obtient l'~yuat~on du tourbillcc staticnnaire;
·
~~Jt"
t) }l·VC~"
t)+W~~\+
f)=
~
(I ..
f)VoJ -
IoVO;x#'
( q ) .-,.
.
, «..
.
(
"" ... __ ", ... __ ..:- ..., .. _.-...<,..., ... ~ I l . ,. -'-" 7 cDaos
'4) , 00 -cl utilia' le fait ~Qe. )
_ f
x'f(
--
r-:z::"-XX
•
( 1 t Y' + 'l') • 1 Y+l'Y
+ 1Y'+
X'y'.. LQS guatre deJ:ni~rs texlles de (4) soat des
~.t,ansitoi'S.'
'EO'ir des ra.isonsd'ord-Ç~
pratiquetermes
te
lle.
ladur
(!e du fro,je~, cester.es
"on t ~t~ nfgli9~S. POUtle reste
l '
de ce ch.pitre. la SCIlle
de ces
c;.uatre
termes(sera
nct~e A ~ (, Butin, puisque l'on • y~ut,
attenit
l' ~'!Jua tiondt'volution du tourbillcn st~tiOQnaire no~"'zcnal, 4' i l no~
faut
soustraire de~(4) les
-ter_escoiresfcodants
a
l~.o1e nne . zonâle.
l 'fious l'~F'rateur
5. )
de telle sorte que 1
(r
"~)=
[Xl (if) -+ . X.(A
.~).
oft,1et ~ sÔAt'~respectiYe.en~ léi longitud.e et la latitude en
radian. COJl.ttaitelÈot
,ci.
l ' op€ratear (3)·, i ' cp(rateur (5)"rifie
.-{{X}] • [X} et [11] .. [Il Ct] + [X. Y *] .•
# '
Pour
dfterlinet
l'~~u4t1QAd€air'e,
i l nous taut et soustraire lE r€sultat de .\ "-lh
.i j j l '1
t
li
-ù
e'.
(
,
..
(4). OD c.bti&.rit liloJ:'&"
.. l ' ~,
a-r
~
{ •• :+l·ttV~i..+
lè-
V..~
*
,+u:
·.qS·). •
·W.~rzi
tw-!
Ô5 -
+d"P"
.
TI .
, 1 " ,,'w
*.
~
3 -)
*
= -
yt~
V
D1* -
J
~
V
D~
••(5·
Vtt
1·)'-
+A-, O"P'
'
~ •. t[(~~'XV<i)·).
•
~ ~~,.V"'*
•
H·XV~'
fI:'J
,- 6 )~. 2' D'~t erlllioons les ter les A calculer
.
Il uisgue tous les' terlll~S ~ \le l' 011 Ydrde son t
.0
yth!n~~ddns le temps, ,n<?us omettrons doréna:~ant de ,1~ noter;. t('
plus,'- four des· t:aisolls -jui' !ie1:~nt'
..
êclairéies dans le1
~roèhai.n Chap~t1:e,
lES'~erlle,s iIlFli'J~~llt
W etdlJE
dans (6).
-ne &&1:00t ~as considlir~s .. t1lf~n, ~têlnt d,onné tcus
les-
termes négligl!s jusyu-' 4 pres~nt, lti. 'caJ.cul du teraE de tt'ott~.ell·t loVxl~ n'est pas..
effect~~•
Les
donne'es
ù tili.séessont
d,u .oi.s -de janv lEt et onf ' '
-les a ainsi .oye~nêes sut
tout
le .oiE.~n 8U~pOSE qu~pour
cette p€:.riode ~/dt est 1l~<Jligeable. - LE:ls terles de ( 6) qui
nous restent s'ont; 'alcl:s:
8 1:
••
~JI:.v.
d~
..
u-ii-
+Vt:#.' .'
(u.~).•
n-
n
'11 T2 'IJ '14 '15 ,l (v*~
,.) - ..JëD.
(S'.
t.)*.
(7 )
+,t
D-
•
~" ~ + Tf-'t6( 't1 18 T9 T 10C.ilS
eUx
tt.raes ,.son t les SE:luJ.s # f:~Cepti-cD.
taite des c _ _ _~ _ _ ~'. _ _ ' _ . _ - : : : - ' _ , " o ',,-- ~'1..
.
..
,,
. 11
Jf
1 ii'
1' f i - , ,-, " , '-
.
J_'"""\", _ _ _ _ _ _ .. _._. _ • ...,,_ ... _ •• ,~ ... _ _ ... ~_",,--.. ~ _ _ , ' , ' 1 , ', . r "
~ ,~ ".
l i . >1-" 9 ·"..
-.
~~ ~ .. :;..
t~~.es' traDsitoirës, ~ui
devraient
~Yoi[ua.
quelconque
i.portance selon le~ analyses.
d
"chelles aceè ,t~esfour
.leslatitudes
.oyennes,
et les ~ch~.Ù.esplanC!taires',
co ... e
on fellt s'en al-erce!C'irdans
le tI:oisl.~.ecba~itre
de
Haltiner&
Willia*s(1~80), si 1'00 cODsi~~rcleur aodtle aoyenoG
d~ns leconsid~rations lors de la
t~.~s. Nou~ reviendrons
sur
ces ~\" ,
~ • .IIi '
aiscllssic:n }olcrtall t' su.r les
r~sultat~,
dans
le dELnler chaFitrè.Nous
noterons CES dix (10) terles Tl' l '110res~ectiveJllent, selon- l ' ordre Fr Cs eot € dans l ' fgua
tioo
(7).2. J Ai'IlJ:oche sl-ectrale
\.
i:'uisgue
nos dcnll(eE ~taiE:ut 91ohalEs, il nous a sea,blGDaturel d'utiliser
Sfectral~'au
rrobl~m~d'analyse, en ce
sens gue
nous'
a'Q~s travaill~ avec le~repr~senta~ions
seus
torlle
de sph~J:J.'jU~S des challll?s de' base ..transformation ~ ell cocfticients
erreur
~Uis'1u' i l nou~SOlllllles
d'narlloniquGs
Il
est
clair ~ue laSptctLaUJ apporte
une
faut troD':I uet
le
d~Yeloppe.eut harmonique- 'juelque part. !lar
contJ:o,
lesd~r i ,,~es
de
peuvEDts'Elfectuer
'.
eX4cte.€ut'eu"
utilisa~t dos rê~l()Sde
rCcure~ce, ~li.inantainsi le
besoin defair€
4~pel ~ des -dffférenc~s finiespour
'"a1uet les 'Haut
les
coapOs8Dtes la
---
... ~ ~~ .... ~~ , .... --..-
-
"
. l,
Cr'
- ! • lU
J ,> , 0 ! 'v(
'.
1
~ f !.I.
10ütt sont.
pas de
vrais scalaires Et pÊ~Yent.Qtre
discontinus aux' pOl~15
(u et v chéLUgeolnt
sutitelEDt d'E signes, '
En tta~etsant
les ptles).
ceci peu\ causerdÈs
pro~l~mesdu
type
phêDo.loe
deGibbs,
i.e. lIauvaise reprCsEbt~tioDdes
dl ••
ps,
non
s~ulellEDt aux point~ de discODtilluit€s , '1Iai$partout sur la
surtaceet
ce,guelgué
soitle
Do.bre
de~,
,
Pout
re.'dier àcela,
on utilise les Vants ilaJ8s U et
yi qui eUI soht cOJltinus aJx
,pOles,
ljuEl'lu8 soit u et VOt ,CeS'1ents'soot d~f'inis de
la
façon suivantE:• (J =:
II
cos
~,
V • vces
cp_
Dans
lerestant
decette sectiGD,
nous'disc~terons plus, sp~ciÎ-fiqu,ellent, cett.üns sujets ayant
trait
a
lei.'"
$pect:rale.
a)
HaraoniguEs s~h€tiques- (de,urtace)
I.es J:aaraooiques sfh.€J:iljuQS de
surfacE
d' crdee Il et def onctions "ro~re'S
du
Laplaci'~n rdege~ D, sont
les
hoçizont'al en cooJ:daont!es sl'h~_ti'J~es. teci signifie gue
oC
-n CD + 1}iL
Y~
,f
~(
cos~d
J •
a"eos'1
~01
,a
est
lerayoA
terrestre.
,1.e a est
tixf'
ddnsles
,
-~t'or91o':liql1es t ~ a. Plus ~r'ciscaent,
.,
. ---;--- ./ t .a )
ets.i
~
• ,
".in~.
Î '..
1
-41P~. 5_11
...
"'
l'expresioD 9~D~rale poux les Y
n
est:Y"" n
=
e "'~ tl~ m (51.0,) 'tOs )
~
2 œ/2 n+1 D13: (sin~) ={(20 • 1) (0 - .)
'E
(1 7'"1.) d ~:; 1}l
2 (n + Il) ï 2W! niLes
P:
sont les pelynOaes de Legendre associ~5 de lapre.i~rE! eSilke. 00 voit, sElon (9)'~ ~ue la !Epr~SE.Dtatlco
lon9itud~nale d'un d~v€lo~~e.ent en série d'bar.on1.~ues
sp~r1gues est une s~r1.~ de Four1er et que sa IeFreseotation
latitud~nalE est uoe somm~ de folYDOmes. L'UDJ.C.l.té du
W1
t ,u t que l ' e Il S eDIt l f: des 'il'!
est une tasE ortbo_ncrl~e ( i.e. les
t;.
sont crthcgonaux et"
de norle 1 ) sur l'EsiJace des tonct.l.otS contillues complexes
sur la sphùe.l IUlIi de la norae L et du prcduit scal.ure
< •
>,
définis de la façon suivante:<
f • 9 } • lin-f:
dA
1-:
'7-
f.lt<
'Î
1
9"1'\Y
1
1/2
L ( f ) = « f
, f »
( 1 0 )
If! W)' ;; (
Av~c
cesd~finit1.ons,
on cl~ue
<YVI,Y~
)=~""d"'(f'II1
d'oft L( y;)
=
1 pour teus n et 1 enti€rs, 1-1' nb) Troncature utilis~e
J
La troncature utilis~e pour ~tudiEr les Chcl.~S ~e ~ase
<1:)
,
1
1
•
Est une T-38 ce ~ui veut dire ~UE n
=
tI, 1, 2, ••• ,JE et• =
-n,
-D+l, ••• , 0, , n-l, fi l-0ur tout n ent.l.cr.~ar dét1nitions des polynOae s de
Lt!gendre. c~tte troncdture nous dontE UDe
"
r EtJr€St;ntà tian ad~quate. En etLet, sU~f~OSODE ~ue l'CL cOLDaisse un
chawl-sca~aire l sur une certaine gr111e latitude-longitude, sur
Wle. surtace de fressioll S. A t-ar tir de X, 0 D d€te run e Sei
pro jectioll sur l'enselllle des
,
.l.€. OD calcule sare~réseDtat~oü eu termes d'bdlmOLi'iues s}-b'ciques (US).
Cette frC)€ctiou X' est
"-Jd lJ
L
L
lY1 WI 1. '=
Xf1 y~ n=() 11=- n 11 ) ~ , '4,m> • lWl =<
X.,
UDf' e .u t d 1 0 r s .. d~ la tà~on sU1vdntE, d~terlline[
l'ecreur comll1se cu tron~uant le dlvelcf~ellent:
Is
(le - X ')2.. dS'E(
x,
3d) = ( 12 )Le tableau SUlvant douoe les' valeuts du ça~cul (1~)
~our dift~rents challfs à dittéren~ niveaUK de pression,
•
13
(
est une abréviation de triangulaire.
---~---1 Il l "-1 Il U(500 Eb) 1 8.33" 1 1-18 1 1 1 1 V (50 Q Il!)) • ~O • 6 " 1 1 1
1
11 ---1
1 1 10 lib 50 C ab •- 1
1
I---~---1 1 1 1 1z
1 • 123 j • 2 ~7 ~ • T-2B 1 1 1 1 U 1 3.4i 7 1 2. 98 ~ 1 • 1 l' v
1 17. 5 , 9. 35 " 1 ., 1 1 "---1 Il , 1 T-3B Il U(500 lit) 1 1.59" 1 Il 11
-Idblecl'U 1 : Erreur dUE A la trollCatur~
'.
L'erreur ~ut
u
avec T-)ü Étant de l'ordrE dE grandeur de l'errEur d'obs€rvat~cL, c'est cette troncature yui a ét~retenue. De plus, en co.parant u(SOOab) FOUI 't-H, 1-26 et 1-38, 11 ne se.nlErait pdS 'ju'augmEnter l'ordre de la
t
troncature au-delc1 cl~ T-3ü soit rentaLlE pUiS<jIJE ceci
1.lIpli';iue beaucoup plus de calcul !Jcur uo fEU ~lus de
pr~Cl.SiOD. Si l'on enlêve le tel:.e "aeyeoue de surtace" au
gêopatentiel Z, l'etreur sur CE terat. est rtlativElient du
aê.e ordre
de grandeut
qUEPCut U
•
.
~.C) D~riv€es ~ar ra{Jport 1 la latitude et la 10ngi tude
"
Supposons ~ue l ' 011 ai t un chaD" C d 'fini su rune
(
surface de pres,sJ.on donUEe. Si C est c:cnnu en tant que s~rie ,d'har.oni~ues spectrales, les d'Liv€es de C ~at raFfort à la
j
...
(
latitud'=l et la loD-1.ltud€ pourront ~tL~ ~valu€Es Exactellent.
En effet, si
c
=
Z
c~ l~
, 0,11 alors:: Z
imcV: yw:'
,i. e. n,Ill VVIet ce, .. aL: d~.tinitioD de C ~t des y~ •
...,
i l c~ , ( 13 ,
De plus, si l'on trav4.l11e avec uoe trcDcature T-3d,
cos~o C/o~ sera repI:~sent~(! par ur.a T-39. En Effet, si l'on
d '1 u
e.r
=
S.lnf '
ccsf.j
C~
=
ccs~dC
r
( 1 If ) ! ais,/
c0.rcr
d
X: •
(nJ
l)é; X-'i. -';1\ n Et\4'1. m Yn.-1 l'WI 4V
Y" =t
0.1- -Ill.)
1/2. 00 t:"4îF-
1 ( 15 ) I.·€~uatl.OD (114) devient dCllc 39 nt donc,cosf
àc
~
L2
EV. 11-0.--0'
ft=
( 16 ) d(
15
00 u' = m~[ ( D , 3d )
YI\ .nI
-(II + 2 JE:Y'fI+i L YIIO+i 1 si 0=111)
et Brr. Il = (n +
2JE.~
C~,-
(u-
l)éV'lC"-' \'11 \'11 Cs i n~. €t n <J 6)YI\ l'YI
- (0
-
1 )E.f1 C"_I Isi n=38,39)Pour connaltre "C/o~
,
il sutfira donc d' ~valuer surune gr i11e latitude-longitude cos<:v
d C/,,~
,dcnnêl'équ~tioll (16), et àe diviser le r~~ultat par ccs,? • Sur
cette IJrillE, le r~sultat sera alo~s eJact.
Par elemple, le tcurbillcn relatif est, en terlle dE:S
~
vents iœages, donné far la forlule:
Les deux terll~S dans Id ~dIenth~se sont €valu~s ~dns l~ doaa iDe spectrlll (1. €. espace dES f 0 n ct i C ilS S ~ h ê r i ~ u es) et la di,vîslon par cos~ Feut se tal.re, soit sur une grl.lle latl.tude-louyitude, soit en cOllsidérant unE apfIOliliaticn lill'airE de l ' oi-eratioD l/COS'L<f cOl1ae le su~yère baer
(1981) IV01.I AH>endi,ce 1 ~Qur ~lus de d~tails ~UI Ct:=th:
lIl~t hode). Bella J:':j uons gue pOUI
J '
p
la dErnière approche a ~t~ rl!tenue , tllndis ~UE l..,s ter Iles L, 'I " • ••
•
'110 furent calculés selon Id t' l E liê te a H.[ocoe.Pour en SaYOII plus long sur la lI€caniq UE de
aétnode"spectrale, pous SU':l'llLOLS au lecteur d.e 'coDsu1ter le teltE de B~laDd (l'jt:lO).
\
2.ij Calcul du toorDilloD c ,
(
1
(
\-(
16
Co,.e nous l'avoDs Il'entionn~ dans lei derDiêrE St;ct1on, le tourbillon a êtti ccilculé selon la lI€thode CitE "dE Baer" et dans certains cas il tut cCIII~ar{ avec celui ctter.u avec l'autre aéthode de calcul. ReœaI~uoDs ~relliêre.ent ~u'~ la lod9ue, la méthode de Baer s'avêrerait Flus ~conoIl1~ue puisyu' el~e conSl.ste essEnt ielle lit:: nt cl éV al uet un E sêr le de lIatrices inverses, toujours les .Cacs, et d' e ttectuer ens'{1l.te UJlt:l serie siaple d'op(i[c1tl..ons al~~tri9UEs, le tout
dans le dOllaine spectral; deulitlaelllent, la ditt~rence entre les deUJ tourbillcns s'dvère Htc glogalement dE!
a
10%,pro l'os de u et v.
1
Nous savous d~Jc! que le résultàt du calcul d'une dérivée sur uDe grllle latitude-lcn91.tude SEra eXdct (section 3c~) liais ~aI ecntre, la fco")ectl.on dans le dOlldine:! spectral dE cette tefiction ne le seca ~as n€~essai[elllent
(par exe.pl~, si Id fantion 'est discol:tinue aUl ~~lEs).
ce sens, les d~ux tourtillons sont aussi 1-r~cis 1'IU1 ~ue
l'autre i.e. ~1o d'erreur relat.lve. Quand cl sayoir fcur~uoi la fonet ion seral.. t ~iscont in ue aux "Oles, i l sU ft i t de
(OV/~-CQsz.~JlJ/~) ne tEne pas ~ zero
aussi rtifidelllent ~ue cos'l..6f en s'aa-1-rochant de 900
1cttitude, c'est ce ~ue nous aurons; c'est En tait ce qui seable se
f
pclsser. cdei n'est FolS trop surp!: eDolDt "uis 9UE U Et V sa Dt
des représentations 1~R~~§ de cbaDfs ottEnus Fa~ des aêthodes d'iu.terf.oldticlls objectl.vQs sur un EnsEable de
,
17
,
points de donn€es caract~ris(! notd.llent ~ar sa rareté daDs les régicns l-olaiJ:es.
Le céal.cul du tourtillon avec les chalEs nOD tron~U~5
(donc,
les
données de base) en uulisant des diffêcencesfiaies du deuxième ordre, nous illustre encore pl us
claire.eut ce comportement quasi-aiscottinu l'rès des pOles,
co •• e nous a.vons pu nous en rEndre cOI~te lors d'une s~['i€
de calculs (non ~r~5EDt~S).
Mt.e si l'enSEmblE des lJ0l.nts de dODDIES i1vdit et~
eDcor~ flu$ dens~, il '1 durclit encore eu l'Erreur induite
l'ar la troncature sur U et V. Pour yeir pourquo.1.,
donSid~rons
la po.lrtie non-diveI:gente du VEnt iaagE, (U"D' VtII) )sur une certaine surface de 1-ressien. Alcrs,Dous savons
C;ju'il elist€ une fonticD de courant
i
telle guel/c0St9 (U riO , V"p :=
r
xV1f
-1/ (acos~
,(-CoS~
0"1'
~~ ( 17 ), -
) o~c)A
d'o~ cl (U "0 ,V~ ) ::,-cos~"~
,d~
).
.
d;""
c\
~r
·V~·
De pllls, le tour1:11.1.on CEla. t i f 'est tEl qUE
j
Cette dun jt!re re lati 011 e,st si.plit~Cle dans UD c.ldre
-spectra 1. Si l'on a que
,
.
,/
alors on aura gue
tels et a fUll). Vrp ) que
u:=[-
(n+2)(:;~,
1'::.
(D- 1)f:
1~-1
,~.
ia1': .
!f'""Si "aI contre, on a qUE
(O~ "~
)!~
( 19 )(si n= 1 _1 ) •
(si n> tlll)
l
, i.E. une tLoncature I-H,
le développeaeot de a Uns> sera cAaD<J~ pour les cOEfficients n=N, lf+l.
Dans ce dernier cas,
"
Dans ltOS deux CclS (18)- C19) et (.20), "uisguE
soot des
.-
bar.aniques, l'É~uclticn,;. V
IlU~~)
•j ·
v'1JJ
( 20 )
Vtl
les Y",
( i l )
telle 9 ua
.5~.
-n Pl + 1)/a.'1o~:
est vérifi le far (17).~dl.S
dans la prati,,=! ue, CE n' est l'as ce yue nous ef tec tuons. NousDe trOIl'1UODS pilS le
d~YE~O~pe.ent
de3
ou deiJ
.ais plutOtcelui de U et V. SUilPosons que la troncaturE de U"o est 1- (M+ 1). Co • • e 011 le yci t da DS (19), U
""
~ d IFend alors de"'\>:t.
sais oncore selCD(1~), ~e
1>:z..-
ct€erai.t un19
T-(H+l). Pusque UnD est de ta~t tronque avec t-(Ji+1), 11
felut Ijue la relatien (lS) ne soit pas exacte.ent veriLi,ae.
Ce gen~~ de tac.tl.que aboutit dene à UD autre type d'erreur
(celle-ci ètant d'ordre th'oriquE nE peut CltrE CU(IiD~e) • OD
tJeut s·eD sorti!: en tronquaot Ut., à 1- (11.1), d~ter.iner
ensuite
J
et de l~1,
en tronquant leur dêvEloppe.ent respectif à T-I et fiodlEJIeut, conserver U:u" dC!tErliD~ ~ar.olJJ
(20). L.a dift~rence Entre 0110 et 0':' est ~etitE CQE l'ordre d~ 1% globalement) liais elle assure la v(dficatioD de (20) et
(oi 1), eontrai~ Emeut " la' situa tion d~critc pluai belut.
Be.arguons que tuut ce ~ui Vit!Dt d'CtrE .ectloDD€ dU .sUjet de
J
et delfJ ost aulsl. éll-pliquallle liour ladivery~ncc
D et la focction de l-otentiE~
y,
elle-.ê.e rEliéea
la di.vergence p.u: l'{:yu<ltl.onDar:tJ'
saut yll' i l faudra alors lIodl.tier le vent llla~E divergent' lI(ridionnal VI) •2. 5 R~ca fi tula tion
1110 us terill.oons ct:! ebCliJ Hr e par UD
rêcapi tulatit Ut!S dix teUes ljue l ' CD re tient dans
l ' ;;guatiou du tOl1rtilloD stat~cllDaire non-zonal. NOliS les
(.
(
,,---_....---.,.---
....---1 1
•
CAB'ItSlEN S Hi !",l~UE V liTS IMAGES
1
Ij---~----~~---, 1 ., 1 . \. S 1 1v·l"
o~~/d~ 1 1 1 1 '1' 1 Il 1 • &1 1 j J - - - -... - - - .... ---.-,- ---- ... --- ... ---~---I j 1 1 1•
1•
1•
1•
1•
1•
1•
1•
1 1 1 1•
•
1•
1,
•
1 1•
1 1 '1'2 T3 T4 '1'5 '1'6 '1'7Te
'1'9 Il Il Il ~v·
d
t/d Y 1 1 . 1 1 j - - - -j Il 1 1 Il j,---_.-._---1
Il 1 1 1 l'-è~5·1
J
y vè/ ad.s
./~~
1V~
la.d
S
./~
1 1 1 I I I' J j - - - ----1
Il 1 1 1 Il (Utd3
t/d
x)· 1 ( u·G>S*/.à,.,q·,(
U·dl./J).).'
Il 1 accscp 1 acos*'~ 1 11---1 Il J 1 Il , J _ . . -Il Il Il l.dee 1 J 1 i d4:! Il Jj---Il l , Il t Dt
,
1 1 j , - - - - - . - - - - ... - ., • ..:.__. -Il j j Il ide. 1 1 1 a j - - - ... - - - -.. - - - -... --- ... --1 , 1 T 10 Il Il( .5.
Dt)*
idee 1 1•
idee,
1,
1--- ---1
"', \
(
cl
.21 • 3. 1 Gêné.t41i t~s~tilis4ES pou.t nos calculs proveDa~ent de l'exf€rience IGGE,
plus prèciséaent, les d()Dnée~ du niveau III(b) de FGGE. Tous
les chalEs sont d~fini~ sur guinze 9I111es .tectan~uldires
latitude-Ion9itude ayant une s~paration horlzontale unlior~e
de 1.815 de~r~s. Les quinze 9 rill.es corresponJent a lU
yuinze surfacEs de fression
,
hs~ uellesap~roxilativeaent dlstribuées un.1.tor.~.eDt ' en altitude
gC!Qpotentielle,
a
tous les ~euJ k.ilo.Ures, si l'on se fieaux donn~es du
u.s.
Standart AtmospherE (1976). c~s niveaux,de pression sont: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 1!O, {CO, 250,
300, liOO, 500, 7QO, E~O et 1000 lb.
Si l'on consulte la note htcbniguE du ECIU'F (EuIOk'ecUl
Centre for ftediUJI range Wea theI i orecasts) sur le syst~lIe
d'o~s~~vations et d'analyses guotidiennes durant FGGE, i l
est c.lair 'tue les dcn,,€es ont subies une certaine torlle
d'interfolation-anallse objeative; ED fait, c'est une
aethode dite "d'intelpolatioD optimum".
pe plus, certains cha.ps du niveau III(t) n' d~couleDt
pas directe.eut
d'cbservatiot~ mais ~lutOtd'un
proc~d€d'iDitialisation dite "pat .odes norlaux" EftEctu~ suc un
(
i
L
'C' Est le cas peur la vi tesse
telDpCirature T et l'huœiait~ rElative ~ •
22
vert~calE u) , la
PuiSliuE
0\
'D'estpas utilisé dans les calculs, lieus' n' en FarlEIous r1us. Les
au tres chalps gue nous avons' reçus, 9ui I l ' on t suti 9u' une
.l.nterpolation objective, ::;ont u, v et
lé
g~opotentielz •.
3.2 Com~aI:aisoos cli.dtolo9i~uEs
AVliO t dl Effectuer les calculs de T l ! Tl 0 a VE;C ces
ùonnét:!s, nous les avons d' atloL'd ~tud i(es d'un poin t dt! vue
cli.atolc~~~ue pour s'assurer ~u~, aans la IEsurE o~ le~
donn~es cliaatologigues du Illois de janier SOlt cennues, le
lIOis de janvier 1~1Y D'~taient pas trcF anoJ:lI1al cu si c'est le cas, COmm€D t l' ~tdit-l..l? De ~lu.s.. cet te cOlpaJ:aiscD DOUS
fou.rnissait une certainE forle de test sur la valid.l.tt;l de
l'analyse spectrale, luisgue l'on 1 a de fait utilis~ l~s
cha'FS aDdlys~s.
Les ense.bles c:li.atO.1.ogiyues I1t.ilis~s oot (!t~ ceux de
Nevell & al. (197~), van Loon & al. (1973) et Oort et
Bas.usseD (1971). Nous pr~seDtons dans le reste de cette
s~c tioD les résulta ts de ct::t te com~ar aisoD.
sais tout d'abord, une note sur lES I1raJ:-hiques
prOseDt~s. Si l'OD COUDait UIl( cha-E, C sous la torae de ,,~,
'j.
soa.es d' harllOllil,jues srh€rigues, on p eut aSSEZ fac HElleDt le
.<
"
c(,\,~.pJ ~ ç.,(~,P)
J
\
( 22 )
Dans (~2),
c.
COtreSfond à C>i, • CC] et las C'/'II(<9.,,) et ~"" sont resl'E:tcti vell~nt les ilJl.,litudes etcorrespondants au QÇla.bre d' oode a du d'velo ppellen t e.n s~rie
de_ FouriEr de cC cl la .Latitude
cf
et l'rEssioD p. Ainsi, nous pr:~sentoDs oota .... nt les -3capb.i!:iUes des allplitudES Et despa4ses, •
=
1. 2, 3, de certains challJ::s. NotOlls de t'lus (jue~~. ~ositi.t vers l'est, nous .lcn.ne la i-0siticn du a4ÜIIUIJ ùe l'oode ayaDt \ollore d'onde l i .
Si 1'00 se r:'J:êre ;1 Yan l.ooll(figure 7) ·on y
trouve-) .
*
\
ra les graphiques de
1"
~et ~d.l.JlSi I;iUE les EbasEs iui .1.eutssont associitts, ad ic~ la notatio" E!:t en accord avec les
~quivale.Dts àlour FGGE SCQt' UfI,odui t~ da.Jls les ErochaiuEs pal,:i t!S) •
ilre.i~re.Qn t, les donn~es de va Il Loon se
Cl limitent
a
l'a •• ispblre lIord. Dëln~ les r~9.ions cb 14 cClipa raison .est
'iX>ssible" aD a' .J.!,&l:çuJ. t tQU t d' ciuord gue lt::ls aar l i tudes de
lGG.e ont.LES .th~s sttuctu1:QS de base: Feur.l:,e nOllbre
-ù'onde 1 Ifigl1re 1) 1 un tr êz' f 0 J; t _axiaulD d"DS 101
lta d '<Altitude; tJour 2.~ nOllbre ô'(Judl! ~ (ti9urE 2) r un fort
lIIaXJ.IIua ~ ~O BD, bS"~ IIIt !,lD 110 xi ... lia, seconda.u:e dans la
t6gion yui , on loe Hirra,~.ç9rr:'Eapouù au •• ui.QI- du jet
. \ 1
.'i
,11
,
1
11
1
(
~, A 30 L 26 T J 22 T-u
18 0 li 14 ~O 6 ':1 2.NORD LA~ SUD_
Fig." l.plit.ude du
J:cltre
d,·o~de zonal t'feur
le 9~o~otelltiel. Ccupe lat!: tude-yertiealt. ,a),,",-, -
--A3Ct
L 26 ., T l 22 T , U 18 1 D 1 E 14,
(~O 40 20NORD LAT!TUQ~ SUD
Fi~. 2 Phase dll no.bu dt onde ''lona,l 1 pour h gC'o-potentiEl 1. C<;'U,E la~i tude-.erticale. (dEg tf)
A L T 1 T u 18 D E 14
(kln"'o
Pi",_ 3 6 2 80 60 40 20o
20 NORD SUDAlpl.itude du
Do.,t:t'e
d'onde %QDal.a,
-lOIr leg~opotentJ,._el. çca~e la,tltude-vertic:alt •. , (a)
'. 1 , ;' 1 1 ~ l -1 <
Fig. " A 30 L 26 T , 1 22 T U 18 0 E 14 (~O 6 2 P'i'J. 5 A 30 L 26 T 1 22 T U 18 0 E 14 ~o 6 2 Pig. 6 r - - - - ' - - - y - - - r - - - r - - - - , - - - . - - ; : r - - , - - , - I O -50 • -70 -100 -150 -200 -250 -300 -400 -500 -700 ~~~ ... _ _ _ _ _ ~~ __ --~----__ ~~~ ____ ~·850 -1000 80
Phase.ftu nombre d'oode zonal 2 pour le g~o
poteot.iel.. Ccul=e latitude-verticale. (degrl)
' - .
~
/
'-20 40
NORD I.ATID.!QE SUD
Amplitude du J;oatre d'oode zOD.!l 3 feu[ lE
9~opoten hel. Ccupe latitude-verticale. (a,
10 20
3Jrrbl
50 70 100 150~m
300 400 ,500 t~gg ~1000 80 60 40 20 0 20 40 60 80NORD I.AT!nlI2~ SUD
Phase du
no.brE
d'ondezonal
3peur
lE g~opdteAtiel.
CCUfElatitude-verticale.
(dE9I~)"
25
,
\
(
---(
... LIT\JOf " , a)..
MOI" .. lAlO'UOf ICI \ c) JO JO e) '0 '-MAIt '"J~ \ '10 .. .'" 'f"".
,,~J!1~_ .... ~;\\,
'6~
1-"1~
\ '00 '00 ""...
.00...
110 L:: ... ~_H ... ,.,_:!=-t: ... ,., ... ~ ... :'": ... ~ ... ,o.,i .. ~" "" . . . f,1"n' l'"A5(
"\
r '0IL
'0\
...
- \ 000 100 1-....
\ -(b (d (~Fig. 7 L.~yuivalent des figures 1 â 6 [Epris de
l
•
(
,fI
27
zonal, c'est-A-d~ro 2UO mL, l~oU. Pour l~ nOlteE J'oDd~~ j
(fl.gut:t! 5), le IIIcuiliUIII <:.3t au nLvedU du courant jet IIcl~.3 A
mar~uê. iour
ce
dernier nOlllbre a'onde, van Loon ne SEmbleprat~quement pas illustrer ce llaXl.lIIUIi secondau:e. c::'
-~
s'a~erçoit qu'elles scnt plus 9tdndes four FGGE, notamment
le .ax ilium pour
.,1,
qui e.-;; t de pl us de t:JOO ID,cOllpdrative.ent
a
plus de &00 Il ~out: van ~oon. Ce qui est le"lUS rellar'iuable dans l~ doux cas, c'est la FrOpd~atloll
déccoissdote
a~s
ondEs~s
le hdUt, flus leno~Lt~
d'oude'est êleyC, ce gU.l est Dorllal, les' nomeres d 'ondes '.lev~s
~tant
coinc's
sous ld troEoFa~.-;;e (~barney&
trazin, 19b1).Si l'GD se J:Ciitre aux yrapüyues (,lE
fi
et ~t J eour van J..oon(figures 711,7e). f:!t EGGE (fi~ures 1. et Il), ~n !'apErçoit '::IliE:
les aaxilluas yenchellt vers l'ouest en .cntant en altl.tude au
nivedU d.-s latituu_e:::s IiOY~IHH!li.c:eqUiCorr4:is kond justement A
des
ondes se i'rCiidgeallt'V.rs
le haut.-- - 'C'ans CEtte 1I~ler~gion, et eu fa!t ~ feu ~rês
l
toutES les lat~tuùQS, lesf
lignes ue ~.3(fiJure b) sont pr"t~yU4l;!Ileot vertlc.l.lEs, d~ b ~ 22 kil, un phéooaênt!
eXrli~u' da.u~
H.1rota (1911) Et Cb.arllliry &1
Dra~iD..Dne
caract~risti~ueint:ressante
est le Gaximuilsecondaire que
l'ODtie.ble
t,cuvet ~ourZ,
auniveau
del"qU4teur
a
prêsde
JCJkm d
'clltitudt L.a raret~ desodODn~es
J
-JI'aphigue. Par contre, llusieuI'f autrE-f> cba.p~ tels Z~ et
la variance dé v (figure lO), sont car~c~ri5~s par uu
1
aali.ua secoudaire dans cettE r~gion, .ais là Encore la
re.ar~ue SUI la raretf dES donn~es pOUILait s'ap~li~uer.
Finalement, si l'cn regarde l'ht.isph~re Sud, lion
sl aperço1t ~ue les nomtr~s d'ondes 1 et 3 ,ossê~Ent des
,
250 . t ,10 kA). Les.alimUIIS sont €vide~ment flus ta~~les ~ue c~ux reDcontr~s
dans l'h~mis~Q~re Nord, fu~syue l'on se retrouve en ~t~ dU
sulY et ~ue l€: contraste ùe telltJ~Iaturt NOld-Sud 'i. e,st
fortellent r~du~t. D€ ~lus, l€s ~bases nous disent gUd les
00 des b'E se pC0l-agcnt la vetticale dans
?ollllle tout\:! l€ 9~opot~ll h e l DE IGGE ilE fEaole tJas
.:t
trop eh ùGsaccord dvec ceux de van Leon, dont les données
sont une IIIcyeDue de ~ ann~es ùalls la troposl-hêre et de 5
annees ùans la strc1 tosphêrE.
Si l'OD se r€t~re lIaintenant
l
Nevell& al.,
pour~tudier u~ (les graphi~ues corr~s~ondants four ceux-ci et
fGGE sont
resvective.ent
lesfigures
11 et 8). laéncorc
onre.a.ryue lJue le .axillum contenu dcins lES donD'IS dE iGGE est
un flOU plus ~lIportant, &ais d'uil .ontant peu inquiétant. Le
aaxiau. du courant jEt 4 ~OO at et lO·~ est de q2 _/5 ~our
~ lGGE et de 38 II/S pou~ .~v~ll , al • • lar CODt~E. si l'on se
(
L
A L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 -20 -3Jr'tb) -50 -70 -100 -150 ~O~i
6 2 p'iq _a
A 30 L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 40 2Q 0 20 40 60 \NORD LATITUDE • SUD
-.00
-500
"oyenne zonale d@ la vitesse lODgitudiodle u. CouFe latitude-verticale. 'mIs)
-50 0 -70 -'00 ( \ -'50 (~O 0
l'
.J :~g -300 Pig_ 9 A L T 1 T U D E 6 : 2 L~.L-.JL...~...o...4.<.o:âii1ili;W~~oe;;;~.a:aiiiliiidtd.~3-8$0 400 -'000 80 60 40 20 o 20 40 60 80 30 26 22 18 J4NORD LATITUOE SUD
~oyenDe 20cale de la vitesse .~ridicnDale v. Coupp latitude-verticale. (m/s)
•
r10 -20 -3J!nb) -50 -70 -100 -150 (~o=m
6 2 Pige 10 ·.00 -500 -TOO -8S0 -1000 Ba 60 40 20 0 20 40 60 80NORD LAIIlYIilE 'SUD
!oyenne zonale de la teaperature ~. Ccupe
latitude·~E[ticale. (de9r~ Kelvin)
..
<.
(
1
.'
-.
! '.~
".
.,
, \ 10 ...'Q'-' ,
" "0--"
1 1 l " , 1 • L \ \ ,..
, l ,~ _ " " \ 1 , ' , ... .. ~ - ' 1 , , ~ ?O 1 30 '0 .-• oOD r $ I~C i ZOO 1C." 10 ~O .0 lJ.c '0 2e '0 AT y 0 'Fig. 11'' L'(!quivalent dE la figure 8 repris d( Ne-vell f: al. (1912). (a/s)
CV'J JANUAIT
,M
_~Ici)
JANUAIYL'~quiv~lent dES figures 9 et 10 te~ris dE
t
(
J 1
rc;fê.re '~ Oort t B<lSlIusson, on S'àtlel:çoit 'iue CEttE valeur de
courant jet de l'h~misphêre Sud sestle plus 1.~ortaDt,
c'est-l-dire 32 mIs vs ~J a/s Wà~S ceci pourrait @tre tout
siaple.ent da au fait qu~ pr~alavlement les ëODn~ei VeU<lDt
de l'h~mis~hêre sud ~taient encore plus SUjEttES à ca~tion
que dans le cas de fGGE. Enfin? ld ZCDe de VEnt d'Est yue
l'on retrouve dans la ~tratosph~[e au Sud de l'tquateur
sel~le tt.re moins intensE dans les donn~es de fbGf ~ue pour
Mewell ~ al.. Ede ~ontrE, ~l D~ seœbl~ pas y aVOlr de ZODe
de vents d'Est au O~VEau 200 mt, autour de l'é~uateur,
contrairement
a
ce ~ue l'on ret[ouv~ oans Oort ~ ~dSm~S$enet Melfell & dl • •
Si l'cn ~X4.1ne maintenant les termes,~ Et Tè d~
•
FGGi: (ti9ures 9 et 10) en les cOllfarant aVEC les resu..Ltats
.
de oort
&
Nasausscn (ti~ure 12), on ne se surprend pa5 dettQUYer un assez ùon a ecot d. Coalle CD pEU t -lE VO lI, les cellules de c~.rculaticn de Hddley et de fErrEl scnt ~ien
aises en evidEnce. Le vent VErs le nCEcl
a
10· li et 1500 latsea~l~ ieut-~tre un peu fait!E ààDS fGGE: 1. ~ mIs iJar
rapport à J a/s • • dis tout le rest~ est ~n acccrd.
Exaainons aaintendllt TI.
tz.
et '1'., ,fi~uLes 13, ,,,, et15). on s*aperçoit, cOlœe DOUS DOUS y attEDdicDS, 9u'A part
(
(
A 30 L 26 T 1 22 T u 18 D E 14 (~O 6 2 Pi r, • 13 A 30 L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 (turo,O 6 -20-3ri"b'
o
80 80 40 20o
20 40NORD tATIIUDE SUD
Aaplitode
du toadre d'onde ZODdl 1{cur
late.p~rature. (cure latitude-verticale. (oJl{)
-50 70 -100 -150 :~2g -350 -.00 -500 -700 nJ~iîiiii~~~~a:::::=:L.-L.-.I...--L.-...I_I...-..L-....l-.LiL:§-e50 '-1 -1000 SO 60 40 20
o
20 40 60 80NORO LATITUDE SUD
Pige 1"
AaplituJe
du nc.tce d'onde 20nal 2 ~cu[ la tellpOr4ture. (oufe latitude-verticalE. (OK)A l. T 1 T
M
18 E 14 ~O Plg. 15 6 2 50 70 100 150ID
.00 ·500 -700 a-.:;;,.,...J.U/Cj:tL..II::;::....J...::::l.-.:::z:::;;:t... ... ~~:::::::L.L..JL...-::r...L:..t>::t:n80 80 60 40 20o
20 40 80 80,
NORD LATITUDE SUDl.plito~.
du no.bre
d'ondezondl l fCQ[ la
(
(
33
dLsoius sont
a
Id su~fac~; œ~me pou~ m-l, cn d <lIlSS i lJ Il~elat~ve.Ent illportantf (surtcut pour .=1) au civeau de
l'lntarcti~ue, ce ~u~ co~rEs~oDdra~t p-e u t -t t r e à un
échauffellEnt da aux m€rs de Boss et ~eddell pendant l'~t~
.lustral. Par contre, uoe 9rand~ partie des surfdces de
press~oD de 70C A l(.Où lib à ces latitudes soot sous terre.
Ces aa xiaulls pour r a ier. t donc tau t aussi bi E 0 0 te E d us A,
l'eztens~oD ues donD~es sous la surtdCE. EnflD, les
.az~.u.s secoDda~Les A 200 ab que l'cn retrouve de ~OQS ~
70-S pour m=2 Et 3 sont aussi ~Dtéressants 1 DetEr.
Nous p~~sentooE aussi deux gcaphiquts ~11ustr4nt
l'i.portancE dE la circulation nOD-azisy.Ctrigue.
a
savoit,l'écart type de u (tl.yu~e 16) et l'~cart typE de v (figure
~.
lu niveau 200 ob, u I-osstde deS(ladOUOS seccndairesa
600 N.35-1II, 10-1i ct JOIJS taDd~s quey en possèdE
a
55°N.u., (figures 17, 18 et 1~), on cetrouVE les illiES steuctuces
ayant des valeurs du m@ae ordre de grandeur. lES 114ZiIlUIS
plus dU sud vrovienbent des noau:es d'ondEs }.lus aiEY~S et
la structur~ stratosph€[i~ue eemble rcesque easêntielleœeDt
\ \
"'--(
U 18 70 0 100 E 14 150 ~O18
6 400 5()() 2 728fMo
80 00 40 20 0 20 40 80 80NORD ,"ATlllU2~ SUD
fil. 16 Éca~t type·zo~al de la vite~se
lcogitudina-le u. COUF€ latitude-vertic.;llE. 'IlS)
10 A L 20 T 1 22 T
3Jmb1
50 U 18 0 E 14 ~o 6 2~o
70 100 150fiS
300 400 500 700 1150 1000 80 60 40 20 0 20 40 60 80NORD L6TII!.!Qt; SUD
Fi 1. 17 Allplitune du nCltre d'onde zonal 1 leur u. Coupe lat i tude-verticale. (II/S)
A 30 L 26 T 1 22 T -20
-3J.mbJ
U 1B D E 14 (I~m~O 80 60 40 20o
NORD L6T1TUQE SUD
fig. 18 AaplituJe du rcmtrc d'onde zonal 2 ~Qur
coupe lat! tude-verticale. ,a/s)