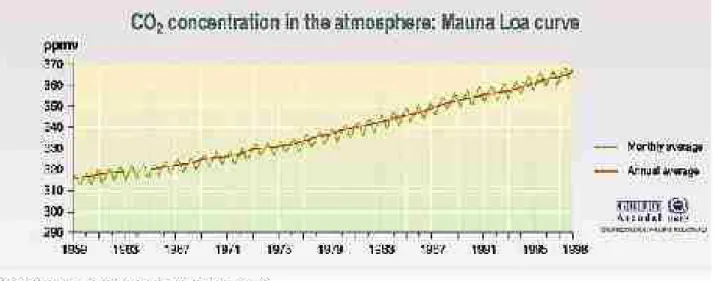HAL Id: tel-00957797
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957797
Submitted on 13 Mar 2014HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
En quoi la crise environnementale contribue-telle à
renouveler la question de la justice ? Le cas du
changement climatique
Fabrice Flipo
To cite this version:
Fabrice Flipo. En quoi la crise environnementale contribue-telle à renouveler la question de la justice ? Le cas du changement climatique. Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences. Université de Technologie de Compiègne, 2002. Français. �tel-00957797�
Université de Technologie de Compiègne
T H E S E
pour obtenir le grade de
Docteur de l'Université de Technologie de Compiègne
Discipline : Philosophie des Sciences et Techniques
présentée et soutenue publiquement
par
Fabrice FLIPO
Le 22 / 11 / 2002
T i t r e
:
En quoi la crise environnementale
contribue-t-elle à renouveler la question de la justice ?
Le cas du changement climatique
D i r e c t e u r d e t h è s e :
Mme Catherine Larrère, Professeur
J U R Y
M. Dominique Boullier, Professeur de sociologie M. Dominique Bourg, Professeur de philosophie M. Jean-Paul Deléage, Professeur d'Histoire des Sciences
Mme Catherine Larrère, Professeur de philosophie M. John Stewart, Epistémologue
Remerciements
Je tiens à remercier tout spécialement : Mme Catherine Larrère, M. Dominique Bourg,
M. Gilles Le Cardinal et le laboratoire Costech, Le RACF,
Mme Sophie Rousseau,
Mon pays et mes concitoyens, qui ont financé cette recherche et qui tireront, je l'espère, les conclusions de ce travail.
« Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sans cela
nous périrons ensemble comme des imbéciles »
Martin Luther King
« Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre »
Mahatma Gandhi
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa
Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations suivantes »
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en préambule de la Constitution de l'An I
Sommaire
Sommaire
7
Introduction générale
12
1. Exposition et justification du sujet
... 12 2. Aspects méthodologiques
... 22
I. La construction sociale du problème
33
1. Le changement climatique
: état des lieux
...
35
1. Le forçage anthropique de l'effet de serre
... 35 2. Le changement climatique
: un défi majeur pour toutes les sociétés ... 44
2. Le problème climatique dans la crise environnementale - aurore
...
65
1. Filiations
... 65 2. De Fourier à Arrhénius, le contexte du XIXe siècle
... 81 3. Le XXe siècle entre continuités et ruptures
... 94
3. De Stockholm à Rio
: l’émergence de la «
crise environnementale
»
...
100
1. Des relations internationales en évolution rapide
... 102 2. L'apparition de nouveaux risques
... 117 3. L'institution du souci écologique
... 129 4. La protection du climat
... 136
4. La conférence de Rio
: avancée cruciale ou simple ballet diplomatique
?
...
144
1. Le Développement Durable ... 144 2. La Convention-Cadre sur le Changement Climatique
... 149
5. L'après-Rio
...
154
1. Des tensions croissantes
... 154 2. Les difficultés croissantes d'un modèle de développement
... 161 3. La ronde des CdP
... 173
6. Conclusion
...
181
II. Caractéristiques et limites de la question de la justice dans les
théories
185
1. L'anarchie des Etats
...
189
1. Contours
... 189 2. Apports et limites
... 199
2. L'éthique du droit naturel
...
207
1. Contours ... 208 2. Apports et limites ... 224
3. Le cosmopolitisme néo-libéral
...
229
1. Economie générale des théories
... 230 2. Le cas du changement climatique
... 243 3. Apports et limites
... 254
4. Conclusions
...
271
III. L'ordre juste
277
1. Repenser le concept de nature
...
281
1. Comment une connaissance de la nature est-elle possible
? ... 281 2. Qu'est-ce que la nature
? ... 287
2. Y a-t-il des limites à l'activité humaine dans la nature
?
...
305
1. L'activité humaine est-elle maîtrisable
? ... 305 2. L'éthique de la nature
... 322 3. Conclusion
: vers un nouveau naturalisme ... 337
3. La vie bonne dans des institutions justes
...
339
1. La vie bonne
: repenser les principes fondamentaux du développement ... 341 2. Les institutions justes
... 355
Conclusion générale
381
1. Quel est le problème
? ... 381 2. Un nouveau cadre d'analyse
... 389 3. Perspectives
: quelle justice pour l’espace international ? ... 395 4. Apports, insuffisances et regrets
... 415
Acronymes
417
Bibliographie
421
Thème 1 : Généralités ... 421 Thème 2 : Philosophie ... 424 Thème 3 : Justice ... 431 Thème 4 : Développement durable ... 436 Thème 5 : Changement climatique ... 445ANNEXES
453
Table des matières
513
Introduction générale
1. Exposition et justification du sujet
Aborder la question de la justice dans la crise environnementale exige tout d’abord de savoir ce qu’est cette crise, et s’il y a bien lieu de parler de « crise », pour qui et pourquoi.
En Occident au XIXe siècle s'établit un modèle de société qui au cours du XXe siècle s'étend à la planète entière, et qui rencontre un certain nombre de problèmes. Il fallait donc revenir sur les causes et les raisons qui ont provoqué et motivé cette expansion, de manière à arriver à établir un diagnostic quant à la situation actuelle. Environnement, justice, communauté, relations internationales, science etc. sont des concepts qui ont eux aussi évolué au cours de cette histoire, véhiculant des références différentes et étant amenés à appréhender des choses elles-mêmes en continue transformation. Suivre ces évolutions était un préalable indispensable pour essayer de comprendre le sens des mots dont nous serons amenés à nous servir, et pour délimiter les choses qu’ils tentent de désigner.
i- Naissance et expansion du paradigme industriel
L’Occident puise ses racines dans le monde grec et le monde chrétien. Il est tentant de faire remonter les origines du développement et de la crise environnementale à cette époque, et de la considérer comme l’époque de l’enfance, ou l’ancêtre, de la situation actuelle.
Mais si les Grecs et les Chrétiens s'intéressent peu à l'innovation technique, ce n'est pas parce qu'ils sont irrationnels ou primitifs : c'est parce qu'ils considèrent cette activité comme étant de second ou de troisième rang. Les Grecs leur préfèrent l'activité politique, autour de la discussion des lois de la Cité, de la communauté politique, tandis que les Chrétiens se préoccupent du salut de leur âme et s'attachent à mener une vie dénuée de péché. Il ne va pas de soi que la poursuite et le développement de l’innovation technique dédiée à l’accroissement de la production et la consommation ait été un but de l’humanité de toute éternité, qu’ils aient été comme inscrits dans une nature humaine invariable. Il ne va pas de soi non plus que la science actuelle soit la seule forme de connaissance possible. La Renaissance ne voit pas émerger la science en général, pas plus que le siècle des Lumières ne voit la découverte de l'économie. A chaque fois, ce sont des activités qui existaient depuis fort longtemps, mais l'on avait coutume soit de les négliger par rapport à d'autres sujets, soit de les envisager d'une autre manière. Lorsqu'on ne porte guère d'intérêt à une activité, elle n'est pas auscultée ni disséquée dans ses moindres détails, et elle ne se développe pas.
A partir de la Renaissance, un critère de science bien particulier prend de l'importance. Il s'agit d'un savoir qui fonde sa légitimité sur la capacité à manipuler les éléments étudiés. La science qui émerge est instrumentale, expérimentale. Désormais, ce qui est bien connu est ce qui peut être manipulé à volonté, c'est-à-dire dont le comportement peut être adéquatement anticipé. On s'intéresse moins à la description, à l'observation contemplative qu'à la transformation, à la manipulation d'éléments qui peut être répétée parce qu'on a mis en évidence une loi de comportement.
Ce critère rend obligatoire le recours à l'empirie, à l'expérience sensible personnelle, à la raison naturelle, tant en matière de morale qu'en matière de causes naturelles. L’une des vertus de ce recours à l'expérience personnelle est de permettre la contestation de la science et de l'autorité de l'Eglise catholique. Si l’expérience personnelle suffit, alors le recours aux experts n'était plus obligatoire. La Réforme, théorisant une relation personnelle avec Dieu, n'est pas étrangère à l'émergence de cette nouvelle manière de faire. Si le vrai savoir de Dieu est un contact personnel avec le divin, issu de l’introspection, alors nul besoin des spécialistes du clergé pour nous expliquer comment nous devons nous conduire.
Mais la contestation ne s'en tient pas là. C'est l'existence du Dieu de la Bible elle-même qui est finalement remise en question. Si Dieu qui est vraiment puissant, vraiment omnipotent, alors pourquoi a-t-il besoin d’un clergé pour exprimer ses volontés ? Ne peut-il pas directement communiquer avec la personne ? Le clergé n’a pas pu réfuter un tel argument sans jeter le doute sur la puissance de Dieu. De ce fait, comme personne ne pouvait réduire le pouvoir de Dieu, il fut au contraire étendu jusqu'à l'infini, jusqu'à devenir infiniment parfait, infaillible, c'est-à-dire finalement de nécessaire, d'immanent, de plein. Le monde supralunaire et le monde sublunaire se sont alors trouvés unifiés dans un même cadre conceptuel : le mécanisme, systématisé par Newton. Au cours de la Renaissance, Dieu devient ainsi peu à peu la nature, débarrassé de toute intervention divine irrégulière de type miracle, qui ne peuvent jamais être répétés empiriquement. Et avec la disparition des grâces, c'est le pouvoir du clergé sur leur interprétation qui s'éteint. Le nouveau critère, c’est le jugement personnel. Et du même coup, la personne se retrouve chargée d’une responsabilité accrue sur son propre devenir.
Aidés par ces évolutions issues de la Réforme, les Lumières réhabilitent la raison naturelle personnelle dans sa capacité de compétence en matière de jugement moral. La pensée des droits de l'homme vient contester deux hiérarchies, l'inégalité du côté de la pureté spirituelle et l'inégalité dans la parenté, le sang. Le socle des raisons permettant aux clercs et aux seigneurs de justifier leur compétence en matière de Bien Commun fut encore un peu plus affaibli par la poussée des marchands et leur insistance à vouloir redéfinir le concept de richesse, vers une définition plus économique.
L'idée qu'il existait un ordre naturel de la société et que les seigneurs ou la scolastique avaient la capacité d'interpréter cet ordre était donc contestée. Au nom de la raison naturelle et de la nature humaine, cette idée fut dénoncée et ce qui avait été présenté comme naturel apparut comme n'étant en réalité que traditionnel. La tradition étant toujours davantage assimilée à l’obscurantisme, on jugea qu’il était nécessaire de la changer. Ce qu’on appelait alors la « communauté naturelle » disparut sous le poids des critiques issues des théories du contrat, qui démontraient que la société était finalement une construction des êtres humains et qu'en conséquence une bonne société ne saurait être autre chose qu'une société arrangée par la raison humaine, et non par des textes sacrés ou des liens de parenté.
Ce mouvement eut deux conséquences majeures et inattendues. La première est que la question du Bien Commun se trouvait réouverte. En effet, si les droits fondamentaux donnent un ensemble de normes minimales que tout ordre social doit respecter, ils ne permettent pas pour autant de répondre à la question du bien commun. Les Lumières vont tenter de combler cette vacance politique de la question du Bien Commun par l'idée de perfectibilité morale des personnes et de la société, basée sur la raison naturelle. C’est donc une nouvelle référence à la nature qui se fait jour, très différente des théories de la communauté naturelle et du droit naturel divin qui avaient été vigoureusement critiquées. Au-delà des droits fondamentaux, la définition du bien commun reste donc suspendue à la révélation de la volonté générale, permise entre autres par l'éducation populaire et le vote.
Mais les Lumières n’ont pas réussi à donner à ce projet un poids politique tel qu’il soit approprié par les citoyens eux-mêmes. Condorcet s'en tient encore à une perfectibilité morale tirée entièrement de la volonté et de la critique des individus, bénéficiant par cumul et éducation à l'ensemble de la société. Mais la référence à la raison naturelle cède rapidement à un nouveau naturalisme, entendu comme une nouvelle théorie de la communauté humaine et de son évolution. Kant reprend ainsi l'idée pascalienne ou même augustinienne d'un progrès naturel de l'espèce, qui aurait lieu à l'insu des individus eux-mêmes. Ceci suppose que la définition du progrès est isolable, évaluable de manière objective par des responsables compétents. Dès lors, le débat n'est plus nécessaire, il suffit d'élaborer des indicateurs. Réapproprié par les bourgeois, favorisés par la déroute des clercs et des seigneurs, le concept de progrès est peu à peu réduit à un sens purement économique : celui de l'accroissement de la production et de la consommation. Et bientôt ce sont des indicateurs économiques qui vont traduire un progrès dont la définition aura été considérablement infléchie et réduite.
Seconde conséquence inattendue : le mécanisme implique une nouvelle conception du milieu naturel qui pose de nombreux problèmes. Le vivant, tout d'abord, est devenu problématique. La physis d'origine grecque est amputée d'une partie de son sens. Dans un cosmos mécanique, tout est nécessaire et par conséquent il n'y a plus de finalité. Dès lors, la vie devient inexplicable. La connaissance de la vie est donc elle-même discréditée, au profit de réductionnismes mécanistes. Second problème : si tout est mécanique, alors tout est manipulable sans conséquences. Le milieu naturel peut être réduit sans perte à un ensemble de briques qui se prêtent à l'activité humaine. Par conséquent, on peut tout manipuler sans rien dégrader. Les anciennes conceptions de la nature comme cosmos habité par la vie inspiraient au contraire de la retenue, par égard au vivant. Il n'y a plus rien de tel avec la nouvelle conception de la nature.
Troisième problème : l'être humain est devenu radicalement étranger à la nature entendue comme environnement biophysique concret. Si la nature est mécanique, alors pour que l'être humain reste libre l'esprit doit être hors nature. On pose deux niveaux d'être séparés, matière mécanique et âme incorporelle. L'être humain n’est plus vivant, et n'habite plus cette nature qui n'a d'existence qu'en tant que matérialisation des actes de l'esprit. L'esprit modèle la nature, et en la modelant il se modèle lui-même. La révolution copernicienne est oubliée : l’être humain est à nouveau le centre du monde, la mesure de toutes choses. La nature ne parle plus, ne propose aucune orientation. L’être humain se déplace dans un environnement mécanique muet. L'être humain devient étranger à cette nature, mais il n'en est pas encore l'ennemi.
Le XIXe et le XXe siècles vont voir la naissance et l'épanouissement de l'industrialisme. La nature
naturelle, c'est-à-dire saisie comme ne portant pas l'empreinte de l'intention humaine, de l'artificiel, du travail humain, cesse d'être cette terre fertile et source de richesses du Moyen-âge pour devenir le signe de l'impuissance humaine. Là où l'on voyait autrefois la générosité naturelle, on se met à voir l'ingratitude de la terre et les stigmates de la Chute hors de l'Eden d'abondance. La Réforme n’est pas sans lien avec cette interprétation de la vie humaine dans les termes d'une Rédemption dont la terre est le lieu. Issu de cette conception, l'industrialisme est basé sur l'idée que l'ensemble des maux humains sont dus à la rareté et au manque de pouvoir sur cette nature, milieu à dompter et à réorganiser. De productive et nourricière, la nature devient source principale du mal, dont l'irruption a été provoquée par l'ancien péché. Alors que le Moyen-âge et les mystiques voulaient échapper au péché par l'extinction du désir et l'ascétisme, avec l'industrialisme on va au contraire défendre l'idée inverse selon laquelle l'extinction du péché et du désir ne peut être accompli que par la réalisation matérielle de l'abondance. Dans ce but unique, deux méthodes reposant sur deux visions de la société et de la démocratie vont s'affronter : la vision marxiste de la lutte de classe et de la planification centralisée, et la vision néo-libérale de la démocratie de marché.
Si le mal vient de l'impuissance à réordonner la nature, alors tout accroissement de pouvoir humain se présente comme un bien. La croissance économique est le moyen de la démultiplication de ce pouvoir humain. Elle permet d'opérer une véritable ingénierie sociale et technique, qui transforme le milieu de manière à le façonner et à l'humaniser. Cette activité engendre des déterminismes techniques (infrastructures etc.) et sociaux (spécialisation) extrêmement lourds, dotés d'inerties telles qu'on peut dans une certaine mesure parler d'irrévocabilités à l'échelle d'une vie humaine. Cette irrévocabilité est envisagée comme la matérialisation du progrès lui-même : c'est l'artificialisation du milieu naturel qui est la voie, et elle ne peut être que bénéfique. Cette évolution coïncide avec une deuxième phase d'expansion européenne dans le monde, en particulier vers les Etats-Unis, et avec l'utilisation croissante d'une nouvelle énergie : le pétrole. Energie très concentrée, manipulable et transportable, elle va permettre de démultiplier considérablement la puissance de travail disponible pour la production. Les machines dès lors vont s'efforcer d'utiliser toujours davantage ce travail issu des ressources naturelles, transformant une société largement agraire, reposant sur le travail du vivant (animal ou humain), en véritable civilisation thermo-industrielle, pour reprendre les mots de J. Grinevald1.
1 J. Grinevald, L’effet de serre de la biosphère - De la révolution thermo-industrielle à l'écologie
Au cours du XXe siècle, ce modèle va être massivement exporté dans le monde entier. D'abord sous la
forme de la civilisation, puis, comme le symbolise le discours de Truman en 1945, comme développement. Il s'agit alors essentiellement de promouvoir la croissance économique, vue comme étant la clef unique de la réussite. Les sociétés sont désormais évaluées sur une même échelle, divisées en sociétés « développées » et sociétés « sous-développées ». Qu'il s'agisse de la croissance infinie ou du développement des forces productives, la vision est la même : l'avenir de l'humanité, c'est sans nul doute le développement de l'économie, qui permet la rédemption et un retour à l'Eden d'abondance.
L'industrialisme n'est sans doute pas réductible à cette utopie du retour dans le jardin d'Eden et à cette volonté forcenée d'artificialisation qui refuse d'évaluer ses conséquences réelles à long terme, étant trop assurée des représentations abstraites qu'elle se fait de sa destinée. D'autres facteurs ont joué : rapports de force sociaux, enjeux financiers etc. Mais c'est bien cette dimension qui est cruciale pour notre sujet. Il nous a semblé mettre à jour ici une dimension fondamentale de l'imaginaire social occidental.
ii- La crise environnementale
L'industrialisme avait pensé mettre au jour les lois éternelles de l'évolution naturelle de l'humanité en tant qu'espèce. La crise environnementale est venue en contester la vérité, obligeant les théoriciens de l'avenir radieux à envisager la nature et l'être humain sous un nouveau jour.
La crise environnementale va commencer lorsqu'il va s'avérer que l'artificialisation peut provoquer des maux, et qu'elle n'est donc plus synonyme de progrès automatique. Cette prise de conscience, qui reste inégale et marginale, naît aux environs de la deuxième moitié du XXe siècle. La conférence de Stockholm
sur l'environnement humain peut être un bon repère. Cette prise de conscience va apparaître sous deux formes très différentes. D'une part, et c’est ici la parution du rapport du MIT au Club de Rome qui le symbolise2, il naît un souci quant aux tendances lourdes mises en place dans les pays industrialisés. La
boulimie de ressources naturelles mène rapidement à la dégradation et à l'épuisement des ressources, l'inconnue ne porte finalement que sur l'échéance. Et d'autre part l'apparition de risques nouveaux, consécutifs à l'occurrence d'accidents d'une gravité et d'une ampleur sans précédent, comme peuvent le symboliser Bhopal et Tchernobyl. Le rapport du MIT fit grand bruit mais eut peu de conséquences. Les risques par contre, peut-être parce qu'ils étaient plus facilement médiatisables et parce qu’ils font de victimes identifiables, donnent naissance à un souci social grandissant. Les anciens risques étaient locaux, probabilisables, confinables et réversibles. Les nouveaux risques sont globaux, non probabilisables, non confinables et irréversibles. C'est Hans Jonas qui montre toute la nouveauté de ces risques qui peuvent mettre en cause jusqu'à l'existence de l'être humain sur terre3, par exemple à travers le risque nucléaire.
L'artificialisme se voit contesté. On parle d'une autonomie de la technique, d'un manque de maîtrise dont on cherche les causes. Ces dégradations ont parfois leurs victimes, humaines ou non : c'est le littoral breton lors de l'échouage de l'Amoco Cadiz ou du naufrage de l'Erika, les animaux englués dans le pétrole brut, l'eutrophisation des rivières, l'appauvrissement génétique des semences agricoles etc. Et ce sont aussi les vaisseaux échoués de l'ancienne mer d'Aral ou encore les coraux blanchis autour des îles paradisiaques du Pacifique. Il apparaît un mal dans le monde, un événement dont tout le monde aurait souhaité qu'il ne se produise pas, et sur les causes duquel on vient enquêter. Un ordre qui semblait jusque-là garanti et fiable se retrouve mis en cause. Mais les dégradations ne s'arrêtent pas là. Les dégâts les plus graves ne se sont pas encore produits. Pour certains d'entre eux, les victimes ne sont même pas encore nées. Le changement climatique, par exemple, ne fera pas sentir ses effets les plus dévastateurs avant plusieurs décennies. Les déchets radioactifs seront peut-être confinés sur plusieurs décennies, voire un siècle, mais nul ne peut garantir qu'au-delà de cette période ils ne referont pas surface et ne se manifesteront pas en des lieux habités 2 Limits to growth, traduit en français par : Halte à la croissance !
par des êtres vivants probablement incapables de se protéger. Les sols surexploités mettent quelques décennies à être érodés ou appauvris, et des siècles à se reconstituer. Or la désertification touche un tiers des terres fertiles dans le monde.
Il y a des artificialisations qui sont la cause de maux, et par conséquent il y a une protection des régulations naturelles qui est un bien : voilà la radicale nouveauté introduite par la crise environnementale. L'artificialisation ne mène plus vers l'Eden, mais peut-être vers l'Enfer.
Il n'est pas toujours possible d'améliorer l'environnement. Un climat stable est partout et toujours préféré à un climat instable, de même qu'une couche d'ozone intacte à une couche d'ozone poreuse et laissant passer les rayonnements ultraviolets nocifs. Tous les êtres humains sont rendus malades par les toxiques, et personne ne veut être davantage malade. Or le développement tel qu'il fut défini au XIXe ne conçoit aucune limite, aucune retenue dans le déploiement de sa logique artificialisatrice. Il affirme au contraire que toute modification ne peut être que meilleure que l'état dans lequel l'environnement a été trouvé.
Constater que l'état naturel peut être meilleur que l'état artificiel, c'est donc prendre de front un paradigme vieux de plus d'un siècle. Les tenants de l'industrialisme ont donc commencé par se défendre. Ils ont affirmé que la dégradation de l'environnement et les accidents étaient des conséquences marginales, secondaires, involontaires, dont on viendrait facilement à bout à l'aide de quelques solutions techniques. On a vite déchanté quand on a commencé à s'attaquer aux problèmes concrets. On a (re)découvert que la nature n'était pas mécanique, simple, inerte, manipulable à volonté, mais dynamique, complexe et vivante. Personne n'a réussi à démontrer que le Club de Rome avait tort, sinon sur les échéances : le problème reste entier. Parier sur les capacités humaines d'innovation peut opérer tant que la croyance dans les forces historiques menant vers l'avenir radieux se maintient, mais l'effondrement de l'empire soviétique a ébranlé durablement cette foi, et pas seulement sa version socialiste.
On s'aperçut peu à peu que toutes les solutions techniques et parcellaires trouvées pour résoudre les problèmes posés étaient elles-mêmes liées à des problèmes environnementaux. Au niveau énergétique par exemple, se passer du pétrole pour recourir au nucléaire revient à accroître une masse de déchets extrêmement toxiques dont il est impossible de se défaire. Utiliser la biomasse pose la question de l'étendue des sols consacrés à cette activité. Adopter l'hydrogène demande de savoir comment le produire. Recueillir l'énergie solaire suppose que la fabrication d'un panneau solaire consomme moins d'énergie qu'il permet d'en collecter au cours de sa vie. Et ainsi de suite... Aucune ressource ne peut être trouvée hors d'un environnement qui s'avère réagir à ce prélèvement d'une manière qui n'est pas toujours bénéfique. La croissance économique n'est pas l'instrument neutre de l'accroissement du bien-être : c'est aussi l'origine des dégradations environnementales. L'être humain se retrouvait donc réinscrit malgré lui dans la nature de deux manières : du côté des ressources, et du côté des déchets. Or le paradigme industriel était dépourvu d'outils pour penser une telle situation, complètement imprévue.
On vit apparaître différents courants d'éthique de l'environnement, qui s'efforçaient de penser les limites à poser à l'activité artificialisante. On assista aussi à l'émergence de pensées de la technique, qui essayaient d'expliquer pourquoi la course à la puissance ne mène pas nécessairement à l'accroissement de la maîtrise et du bien-être. Devant les échecs successifs à l'invalider, l'argument du Club de Rome, selon lequel le développement s'arrêterait avec l'épuisement des ressources ou l’accumulation de pollutions, gagna peu à peu les consciences. Les dégradations de l'environnement remettaient bel et bien en cause tout un mode de vie, tout un avenir, et pas seulement certains effets secondaires. Tous les scénarios montrent aujourd'hui qu'à moins d'une modification lourde dans les tendances existantes, les accidents majeurs et les dégradations environnementales graves et irréversibles ne feront que croître et s'approfondir, quelles que soient les richesses artificielles produites par ailleurs. L'entretien et l'extension des infrastructures construites par les sociétés industrialisées reposent sur l'usage massif de ressources épuisables, ou sur des taux d'accroissement de la consommation des ressources renouvelables tels que les capacités de charge finiront par être
Ce vers quoi l'on commence à se diriger, c'est finalement l'inverse de l'Eden. Non seulement les générations suivantes ne bénéficieront pas de ces ressources, qui auront été épuisées par les générations antérieures, mais, privées des moyens nécessaires pour vivre comme leurs parents, elles devront trouver des solutions pour reconstruire une autre organisation, basée sur d'autres ressources. Mais... le pourront-elles ? Ces ressources existent-elles ? A-t-on le droit de les y obliger ? Les générations futures et les jeunes générations actuelles seront peut-être plus riches en billet de banque, comme le promettent les scénarios de croissance économique, mais ceci leur permettra-t-il de vivre bien ? Ou devront-elles au contraire utiliser leur énergie à combattre les maux créés par leurs ancêtres : climat instable, rayonnements radioactifs, pollution des rivières, parasites rendus plus virulents par leur résistance croissante aux produits chimiques, désordres génétiques, irréversibilités infrastructurelles etc. ?
La crise environnementale est l'histoire de la collision entre environnement et développement. Par
développement, nous comprendrons principalement la croissance économique, moteur de l'artificialisation
de l'environnement. Le marché déplace, réalloue et redistribue les éléments de l'environnement en ignorant les conséquences écologiques. Le concept de développement, souvent synonyme de modernisation, est central dans les politiques publiques depuis plus d'un siècle. On le mesure au moyen d'indicateurs hétéroclites tels que le Produit Intérieur Brut ou le taux d'alphabétisation. On encense ses réalisations, en glorifiant les progrès de la médecine ou de la conquête de l'espace. Par environnement, on entend l'ensemble des choses et des êtres qui entourent une société, autrement dit, l'ensemble des questions relatives à son milieu de vie et à ses voisins, humains ou animaux. Ce concept reste mal défini. Il peut être mobilisé pour se référer à la qualité de l'air dans un bureau comme au changement climatique ou à la disparition des espèces.
Les négociations internationales elles-mêmes témoignent de cette évolution. De Sommet sur l'Environnement (à Stockholm en 1972) au Sommet sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro 1992) puis au Sommet sur le Développement Durable (Johannesburg 2002), l'accent passe de « l'environnement » au « développement ». Parions qu'en 2012 aura lieu un « Sommet sur le Développement », dont l'objet sera soit de remettre en cause le paradigme industrialiste, dans une hypothèse optimiste, soit, dans l'hypothèse contraire, de dépecer ce qu'il reste de ressources pour maintenir jusqu'au bout la quête utopique de croissance infinie et de retour à l'Eden d'abondance.
C'est ce problème de la rencontre entre environnement et développement qui nous intéresse au plus haut point et qui est le centre de notre réflexion.
Les pressions environnementales ne sont pas seulement dues au mode de vie industriel, mais aussi à la pression d'une population humaine croissante.
Le poids de ce facteur n'est pas négligeable, surtout dans les pays du Tiers-Monde où la croissance démographique n'est pas encore arrêtée. Mais si chacun vivait comme un Indien, la Terre pourrait nourrir assez d'habitants, et même davantage, sans compromettre le niveau de ressources disponibles pour les générations suivantes. Ce n'est donc pas tant la démographie qui pose problème que le mode de vie individuel de chacune des personnes comprise dans le concept statistique de « population », quelle que soit sa nationalité, et la maîtrise collective des effets agrégés de ces modes de vie individuels, dont le nombre de naissances n'est qu'un aspect. Il est plus préoccupant, et beaucoup plus lourd de conséquences pour l'avenir, que les pays du Tiers-Monde veuillent suivre le Premier monde, et connaître le même développement. Les pays du Tiers-Monde veulent accroître leur production et leur consommation, ils veulent s'industrialiser. Pour s'enrichir, ils exportent au maximum, comme le leur conseillent la Banque Mondiale ou du Fonds Monétaire International. Les leçons du Premier monde ont porté : après des décennies, voire des siècles de pédagogie, la grande majorité des peuples s'est rendu aux arguments du monde occidental et aspire à poursuivre le même projet que lui. Et ceci juste au moment ou ce Premier monde entre dans une crise environnementale et doute de la viabilité de son projet.
A l'échelle du monde, la population n'est donc qu'un facteur parmi d'autres, et pas forcément le principal. Localement, il peut être déterminant. On pense à certaines régions du Bangladesh, ou aux régions désertiques dans lesquelles une population pauvre et dispersée exerce une pression déjà excessive par rapport aux capacités du milieu. Mais globalement, c'est davantage une résultante qu'une cause. Comme le montre A. Sen dans le cas du Kérala4, la démographie ne peut être maîtrisée que lorsque le concept de
« population » prend son sens dans le cadre d'une communauté politique qui administre collectivement ses ressources et ses classes d'âge. Les explosions démographiques résultent des désordres sociaux, elles n'en sont pas la cause. On peut regretter certains moyens de contraception tels que l'infanticide, et juger avec raison que la science occidentale a permis de faire d'immenses progrès dans ce domaine, mais on ne peut nier que des moyens de contrôle démographiques ont toujours existé. Le problème n'est donc pas la « population » en elle-même, mais l'organisation sociale qui permet aux personnes de vivre ensemble et de s'approprier les effets collectifs de leur coexistence pour les réguler. La population est donc en général un problème local, et tout au plus un problème national. Elle ne pose pas directement de problème en tant que tel. En particulier, elle ne pose pas de problèmes frontaliers en tant que tel et ne peut donc pas être un problème pour le reste du monde. Les migrations seront certes l'un des problèmes principaux à venir, mais elles sont rarement provoquées par la surpopulation. Les causes en sont plutôt les guerres, les sécheresses etc. Ce n'est donc pas un facteur pertinent en matière de justice à l'échelle internationale.
On pourrait affirmer que rien n'empêche physiquement l'humanité d'achever son épopée dans une destruction massive globale à partir du moment où elle en a le pouvoir, comme l'avait déjà remarqué N. Georgescu-Roegen5. Une telle thèse pose pourtant deux problèmes graves. D'une part, l'humanité n'est pas
une personne - pas plus que « la population ». Celui qui, comme N. Georgescu-Roegen, affirme que l'humanité peut se suicider, parle en réalité de la destruction d'une partie de l'humanité par une autre partie. Et même en l’absence de vote global, on voit mal pourquoi l'ensemble des êtres humains présents sur la Terre pourraient prendre une telle décision. La légitimité de celui qui tient de tels propos doit donc être mise en cause. Une telle parole sera toujours usurpée. Il ne peut y avoir de suicide de l'humanité possible parce que rien de tel que « l'humanité » ne peut prendre cette décision. Et quand bien même le moyen de le savoir existerait, il resterait encore à en répondre devant les jeunes générations qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison. Les destructions écologiques sont donc le fait d'exactions commises par certains êtres humains contre d'autres êtres humains, et non le fait d'un sujet collectif global. Faire comme s’il existait une solidarité organique est une injustice.
Par ailleurs, les êtres humains ne sont pas les seuls habitants de la planète : il existe aussi d'autres êtres vivants, et plus largement il existe un ordre de l'environnement qui a une importance au point de vue moral. Il y a une disposition des éléments naturels qui conduit à maintenir certaines qualités de l'environnement, alors que leur modification les détruit. Il y a unanimité pour condamner la dégradation de la couche d'ozone ou le changement climatique : personne ne juge que de telles modifications sont souhaitables. Tout le monde veut maintenir un climat stable et une couche d'ozone intacte. Le président W. Bush lui-même, s'il se refuse à réduire ses émissions, le fait au nom d'autres priorités : à aucun moment il ne défend une position selon laquelle le changement climatique en soi est défendable comme but légitime d'une politique de développement ou de modernisation.
iii- Pourquoi le changement climatique ?
La crise environnementale est complexe et multiple. Nous avons donc choisi de concentrer notre attention sur l'un aspects : le changement climatique. Pourquoi ce problème et pas un autre ? Trois raisons
4 A. Sen, Un nouveau modèle économique, Paris : Odile Jacob, 2001. Chapitre intitulé Population,
ressources alimentaires et liberté, pp207-229.
principales sont à l'origine de ce choix.
La première est que la crise est mondiale, au sens où elle touche directement ou indirectement l'ensemble des peuples du globe. Le mode de vie industrialisé se répand rapidement à la surface de la planète, et avec lui les pressions sur l'environnement naturel augmentent. Or si la plupart des problèmes d'environnement sont plutôt régionaux ou locaux, le changement climatique, lui, est rigoureusement mondial : aucun pays ne peut s'en exclure. Et tous les pays y contribuent, peu ou prou, et tous en subiront les effets. C'est donc un problème qui est à la même échelle que la crise au point de vue spatial. Mais c'est aussi un problème qui est à la même échelle que la crise au point de vue temporel : ce qui est engagé ici, ce sont des horizons de l'ordre du siècle voire du millier d'années, comme c'est aussi le cas avec la désertification, les déchets radioactifs ou la disparition de la biodiversité. Par rapport aux ordres de grandeur temporelle de l'activité humaine, il y a une irréversibilité, au sens où les moyens pour rétablir la situation antérieure, si on le souhaite, ne sont pas disponibles. Ceci est évident dans le cas du changement climatique : on ne peut pas pomper les gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère, pas plus qu'on ne peut trouver les « thermostats planétaires » qui permettraient de faire baisser la température.
La seconde est que la crise environnementale n'est pas marginale mais structurelle. Cela, notre première partie tentera de la montrer. Cette crise n'est pas un problème technique, au sens où il suffirait de quelques innovations telles que le pot catalytique pour en venir à bout. Le changement climatique le montre à loisir, en venant questionner directement la configuration des infrastructures des pays industrialisés. On reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a aucune manière simple de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, c'est même l'essentiel de l'argumentaire de G.W. Bush pour s'opposer au Protocole de Kyoto. C'est un problème structurel, qui met en cause les orientations profondes de l'organisation industrielle. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de l’énegie. Qu'il s'agisse de biomasse, de nucléaire ou de solaire, aucune énergie n'est gratuite, propre et illimitée. Or l'accroissement de la consommation d'énergie a longtemps été synonyme de progrès : la contradiction entre les deux est flagrante, et on pourrait l'étendre aux autres ressources. Le changement climatique est donc le lieu privilégié de la rencontre violente entre environnement et développement.
Troisième raison : le changement climatique est complexe, au sens où le nombre de paramètres est élevé. Sur le plan purement physico-chimique, les laboratoires ne parviennent pas à en rendre compte. Ils sont confrontés à des incertitudes importantes et semble-t-il irréductibles. La seule expérience dont l’observation est fiable, c’est celle qui a lieu actuellement avec le climat réel. L'expérience n'est donc pas répétable, puisqu'elle a lieu dans le monde. Elle n'est pas non plus confinable. Elle concerne donc l'ensemble des personnes du monde entier dans leurs conditions de vie, et pas seulement les communautés scientifiques à l’abri dans leurs laboratoires. Ce n'est donc pas un problème scientifique, mais un problème social et politique dans lequel la science intervient en tant qu'informatrice du débat. La science témoigne en particulier du comportement du monde naturel physico-chimique, du vivant, et dans une certaine mesure du monde humain. Elle contribue à porter la voix du vivant et des éléments inanimés dans le monde humain.
L'évolution des rapports successifs du Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) témoigne de cette évolution. Le problème a d'abord été porté par les climatologues avant de devenir un enjeu économique, politique, et bientôt géostratégique. Si le climat de la planète est modifié par des êtres humains, alors cette chose qu'est le climat de la planète ne peut plus être étudiée sans prendre en compte les dynamiques des sociétés humaines, ce qui à l'évidence sort de la climatologie en tant que discipline. Il faut avoir recours aux sciences politiques, à l'économie etc. Les efforts sectoriels tels que le changement de comportement personnels, planification urbaine, mesures économiques telles que l'écotaxe ou les permis d'émissions, le verdissement des administrations, l’aménagement du territoire, la législation environnementale etc. sont mis à contribution. Mais aucun n'est à lui seul à la hauteur des enjeux. Et ce n'est pas tout : les problèmes environnementaux sont eux-mêmes liés entre eux. Le climat global modifie les climats locaux qui eux-mêmes sont un facteur important dans l'évolution des espèces et des écosystèmes.
Les CFC6, gaz utilisés comme fluides frigorigènes, sont à la fois des gaz à effet de serre très puissants et la
cause de la réduction de la couche d'ozone. Les rétroactions entre les différentes entités et les processus évoluant dans l'environnement sont multiples et mal connues. Par exemple, on ne sait pas très bien si la réaction de la biosphère terrestre au changement de climat pourrait amortir ou au contraire accélérer le phénomène.
En un mot, nous avons choisi le changement climatique principalement parce qu'il nous a semblé
exemplaire de ce qui a lieu dans la crise environnementale.
iv- La racine de la crise est l'injustice
L'accroissement de la richesse s'est largement appuyé sur la destruction rapide à la fois des ressources fossiles et des ressources renouvelables.
Des biens artificiels ont été produits, mais des biens naturels ont été détruits. On en vient aujourd'hui à essayer de faire la balance entre les deux, mais le fait majeur est là : dans le projet initial, il n'avait jamais été question de détruire les biens naturels pour produire des biens artificiels mais d'accroître la quantité générale de biens. Il s'agissait d'améliorer l'environnement, pas de le dégrader. D'autant qu'on a négligé la différence fondamentale qui existe entre les biens naturels et les biens artificiels. Comme l'attestent toutes les guerres et toutes les situations de grande déstructuration sociale, l'habitat écologique reste la première richesse de l'être humain. Lorsqu'on ne peut pas acheter de quoi assurer ses biens fondamentaux sur le marché voisin ou dans le pays voisin, on ne peut se reposer pour vivre, et vivre bien, que sur la qualité d'un environnement très largement produit et maintenu par des forces non-intentionnelles. Quand un pays est en guerre, les civils ou les résistants se réfugient dans le maquis, qui doit donc être habitable. Il existe donc une asymétrie fondamentale entre les biens artificiels, qu'il faut entretenir pour qu'ils conservent leur forme, et les biens naturels, qui se maintiennent dans le temps sans le concours de l'intention humaine.
On peut donc affirmer avec certitude que les biens naturels détruits seraient définitivement indisponibles pour les générations à venir, alors qu'on ne peut garantir que les biens artificiels, eux, se maintiendront dans le temps. L'artificialisation prend alors un visage nouveau, apparaissant comme une question de justice intertemporelle. Les biens naturels, surexploités, sont appropriés par un petit nombre de générations au détriment des autres, qui ne recevront donc pas la part qui était revenue à leurs ancêtres. Cette injustice vient s'ajouter à l'injustice intragénérationnelle, dénoncée déjà depuis plusieurs siècles sous la figure du colonialisme et de l'accroissement des inégalités au niveau mondial. D'autant que les tendances concernant la répartition des biens artificiels ne sont guère meilleures.
La Terre n'est donc pas finie au sens où l'on pourrait trouver un bord qu'il serait physiquement impossible de dépasser : on peut détruire la biodiversité, on peut disperser le plutonium, on peut couper toutes les forêts, de même qu'on peut exterminer un peuple pour se saisir de son territoire. Ce n'est pas un problème d'étendue du pouvoir, mais une question de légitimité dans l'usage qui est fait de ce pouvoir. Ce n'est pas parce que l'on peut détruire un peuple qu'il est légitime de le faire. Parler de protection des ressources
renouvelables, c'est poser la question de la justice : ces ressources doivent-elles continuer de se renouveler,
pour que les générations à venir en bénéficient elles aussi ? La plupart des ressources renouvelables peuvent être détruites si elles sont surexploitées : elles sont donc toutes épuisables. Et il est rentable à court terme de tout exploiter et de tout détruire. Les ressources ne restent renouvelables que si les êtres humains qui l'exploitent font preuve de retenue. Est-il juste que quelques générations s'en emparent en ne laissant que le désert et la pauvreté derrière elles ? Est-il juste que les êtres humains qui n'habitent pas dans les pays industrialisés exportent massivement leur sol et leur sous-sol pour soutenir le mode de vie d'autres peuples ?
Est-il juste enfin que les autres êtres vivants n'aient pas non plus leur part de ce milieu naturel, et ne puissent pas poursuivre leurs intérêts propres ?
Le cas du changement climatique montre que cette question de la justice se déploie sur deux dimensions. Un aspect intragénérationnel, souvent résumé par le terme « Nord-Sud », qui se traduit dans le Protocole de Kyoto par les engagements des pays industrialisés et la question des engagements à long terme des pays en développement. Et un aspect intergénérationnel avec la question du patrimoine : quel climat et quelles infrastructures voulons-nous ou devons-nous laisser aux jeunes générations présentes et aux générations futures ? Comment prendre en compte le lointain ?
La crise environnementale a donc sa source dans l'injustice, et plus particulièrement dans l'injustice vis-à-vis du lointain, spatialement et temporellement, et l'injustice vis-vis-à-vis des êtres vivants non humains.
Ces deux types de justice en tant que tels n'ont pas fait l'objet d'une réflexion systématique jusqu'ici. Ce travail va s'efforcer de jeter les bases de cette problématique complexe. Il faut donc commencer par essayer d'éclaircir l'arrière-plan conceptuel sur lequel se pose le problème de la justice. Pour tenter d'y mettre un peu de clarté, notre travail s'articule en trois parties.
La première partie de notre travail va donc s'attacher à reconstruire le contexte dans lequel se pose notre problème. Il s'agit là à la fois d'une histoire philosophique et d'une enquête de terrain visant à savoir quel est le problème, c'est-à-dire quelle est la question de la justice dans la crise environnementale, à travers ce qu'en disent les parties prenantes dans les négociations sur le changement climatique. On doit arriver à montrer comment le problème se pose, pourquoi il se pose ainsi et pas autrement, quelles sont les entités et les processus en jeu, quelles sont les causes et quelles sont les raisons. Nous allons ainsi montrer que la question de la justice est au coeur de la crise environnementale : on ne peut parler de crise qu'au regard de la gravité des enjeux moraux présents dans les problématiques de l'environnement.
Montrer que la justice est au cœur de la crise environnementale conduit à se demander quels sont les outils permettant de penser cette crise. Ce sera l'objet de notre seconde partie, qui vise à identifier les ressources existantes en matière de théories de la justice, dans l'espace international et dans le cadre de la crise environnementale. Nous en distinguerons trois : l'anarchie des Etats, l'éthique du droit naturel, et le cosmopolitisme néolibéral. Nous nous attacherons plus particulièrement à l'analyse du dernier courant, car c'est celui qui domine actuellement la recherche en la matière. Il s'agit d'une analyse critique, visant d'une part à établir une typologie parmi les approches existantes et d'autre part à mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses. Cette étude sera menée à partir des problèmes posés par le changement climatique. Nous montrerons que l'une des faiblesses majeures de ces théories est qu'elles ne prennent pas en compte l'environnement. On montrera qu'il se pose aussi d'autres questions, en particulier celle de la nation, qu'il faudra aussi aborder. Mais il existe dans ce domaine davantage d'outils.
Ce sera l'objet de la troisième partie de tenter de proposer un nouveau cadre conceptuel pour comprendre le problème posé. Nous essayerons alors de poser les jalons d'une nouvelle théorie de la justice, qui prenne en compte à la fois la question de la nation et de l'international et surtout la question de la place de l'activité humaine dans la nature. Il s'agit d'arriver à problématiser la question d'une manière plus satisfaisante, c'est-à-dire élaborer le problème de telle façon à ce que les enjeux soient plus clairement indiqués. On verra entre autres qu'il existe une dimension naturelle de la liberté humaine, qui s'inscrit dans un monde naturel habité par d'autres causalités que l'intention humaine, et dont il faut tenir compte. On verra aussi qu'il n'est pas possible pour un théoricien isolé de proposer de théorie de la justice qui soit complète, parce que la justice n'est pas seulement universelle. Toute théorie de la justice comporte une partie qui est particulière, et qui ne peut être établie qu’à travers le débat démocratique. Ceux qui attendent une réponse claire à la question de la justice dans le changement climatique seront donc déçus. Seul le débat entre les parties intéressées peut
permettre d'aboutir à une telle définition, aucun théoricien ne le peut ni n'a la légitimité pour le faire. C’est une connaissance qui n’est accessible au théoricien que post-hoc, après sa construction sociale.
Notre thèse est que la question de la justice se voit remise en cause par la crise environnementale, et ceci à deux titres. Deux éléments nouveaux ne trouvent pas de réponse dans les théories habituelles, que nous aurons examinées dans notre seconde partie. Il s'agit d'une part de l'interdépendance internationale sociale (économique) et écologique, qui génère des effets collectifs néfastes dont les répercussions sont locales et qui cherche une organisation, et d'autre part, de la dégradation d'éléments du patrimoine naturel.
En regard de la question de la justice, la crise environnementale conduit donc :
- d'une part à élargir la question de la définition des biens communs à la dimension naturelle de la liberté, par quoi nous entendons la prise en compte des conséquences de l'activité des êtres humains en tant qu'agents écologiques agissant dans un milieu naturel doté d'une dynamique propre et habité par d'autres agents écologiques, actuels ou à venir, proches ou éloignés;
- et d'autre part à savoir comment réaliser ces biens communs : c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de la gouvernance, à défaut d'utiliser le concept classique de gouvernement, trop lié à la régulation par la seule autorité de l'Etat. La question des critères de la répartition des biens et des maux, c'est-à-dire la question de la répartition et de l'extension des libertés concrètes des personnes, sujet traditionnel de la justice, fait partie de cette question de la mise en œuvre puisqu'elle est le moyen et la fin de la division morale du travail conduisant à la mise en œuvre effective de ces libertés.
2. Aspects méthodologiques i- Méthodologie
Une thèse en philosophie faite par un ingénieur mécanicien sur un sujet qui par de nombreux aspects est très nouveau ne peut manquer de poser un certain nombre de questions.
La première est la compétence du doctorant. Avec un diplôme d'ingénieur, une licence de philosophie et un DEA de sciences cognitives, l'ensemble peut sembler hétéroclite et risque de mener à un résultat qui manque de cohérence. Nous avons essayé de combler au mieux nos lacunes, comme en témoigne l'abondante bibliographie. Bien entendu, cette quête est sans fin et il nous aura toujours manqué de temps pour lire davantage et de capacités cognitives pour mieux synthétiser. Nous espérons néanmoins que l’ensemble n’est pas déséquilibré et qu’il n’y a pas de grosse lacune.
La seconde est le caractère interdisciplinaire du sujet. L'environnement ne relève pas d'une discipline unique. Mais si les problèmes environnementaux ne peuvent être réduits à une approche disciplinaire, ils n'en demandent pas moins des connaissances très spécialisées. Notre double formation, qui peut parfois passer pour un double inachèvement, s'est ici révélée être un atout. N'ayant pas de formation en sciences écologiques mais un cursus d'ingénieur mécanicien, le changement climatique nous apparaissait comme un problème relativement aisé d'accès. Il fait appel à des connaissances que nous possédons, telles que la physique ou la mécanique des fluides. Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance de ce savoir parmi l'ensemble de tous les autres savoirs nécessaires pour comprendre le changement climatique : l'effort que nous avons du fournir a été considérable.
L'interdisciplinarité est en soi un problème qui se pose comme l'un des aspects fondamentaux de la crise environnementale, et nous serons amenés à le thématiser comme tel dans notre analyse. Il faut d'emblée souligner l'importance qu'il y a à ne pas confondre interdisciplinaire et pluridisciplinaire : un travail pluridisciplinaire aurait sans doute été utile mais à notre sens insuffisant. L'interdisciplinarité ne se contente pas de compléter l'éclairage d'un objet par une discipline par l'adjonction d'analyses provenant d'une autre discipline. Dire qu'un problème est interdisciplinaire, c'est dire que sa définition et sa problématisation ne
peuvent être dérivées d'une discipline constituée ni même de plusieurs disciplines simplement ajoutées les unes aux autres. C'est dire que les termes de la définition du problème ne peuvent entrer dans une seule discipline. En quelque sorte, l’étude de l’objet en elle-même comprend comme l’une de ses dimensions constitutives essentielles la construction d’un cadre, d’une discipline appropriée.
L'interdisciplinarité, c'est étudier une chose sans savoir à l'avance quels seront les bons cadres d'analyse. C'est accepter de se laisser mesurer par la chose elle-même, autrement dit accepter de ne pas projeter d'hypothèses a priori sur la chose étudiée. Nous tentons de répondre à un problème tel que les sociétés se le posent, et non tel que les disciplines sont capables de l'appréhender7. L'important n'est donc pas d'avoir
appliqué scrupuleusement le cadre d'analyse propre à une discipline, mais d'avoir éclairé tous les aspects pertinents du problème avec le même niveau de détail et montré comment il se situe dans un espace de référence plus grand que lui. Les disciplines ne sont mobilisées que si elles contribuent à comprendre un aspect du problème qui apparaît comme essentiel. Aborder la question de la justice dans le changement climatique de manière exclusivement économique, par exemple, c'est souscrire aux critères de la discipline « économie » mais ce n'est pas s'attaquer au problème tel qu'il se pose pour les acteurs eux-mêmes. C'est utile, mais partiel.
Les disciplines constituent pourtant un référentiel commun nécessaire à la recherche. En sortir, c’est aussi risquer d’être mal compris, par défaut de références communes. C’est aussi prendre le risque que le travail semble insuffisant aux yeux de chaque spécialiste de chaque discipline mobilisée. Nous espérons qu'ils considéreront l'intérêt qu'il y a à faire dialoguer leur discipline avec d'autres disciplines, et le travail que cela demande en termes d'investissement dans les autres disciplines que la leur. Nous avons essayé de maintenir un niveau suffisant d'analyse dans tous les domaines abordés. Le critère que nous avons retenu ici est le suivant : connaître tous les facteurs susceptibles d'infléchir l'analyse de manière significative, et connaître les grands courants disciplinaires qui ont travaillé sur chacun de ces facteurs. Autrement dit, l'hypothèse est que si nous avions eu la capacité d'approfondir tous les domaines abordés, nous aurions raffiné notre analyse mais nous ne l'aurions pas bouleversée. Nous aurions mieux situé les problèmes dans les traditions disciplinaires, et commis moins d'approximations dans les références mobilisées. Si par contre nous nous en étions tenus à une approche disciplinaire, nous n'aurions eu aucun moyen de savoir si notre analyse pouvait être bouleversée par l'éclairage d'une autre discipline ou non. Nous avons affaire à un problème complexe, au sens ou H. Atlan le définit : « la complexité, c'est le nom donné à l'information qui
manque à l'observateur pour rendre compte du comportement global à partir de ce qu'il sait des relations établies à l'infra-niveau »8.
La troisième question a trait à l'ampleur de l'objet que nous avons choisi. Il n'est sans doute pas très orthodoxe d'avoir voulu tenir jusqu'au bout un sujet aussi vaste. C'était risquer d'être faible sur certains points, voire sur tous. C'est d'autant plus difficile que l'on reconnaît en général que le changement climatique requiert une connaissance assez encyclopédique. Nous avons conscience d'avoir manqué de temps et de capacités de synthèse pour aller davantage au fond des problèmes. Nous voulions répondre au problème tel qu'il est rencontré par les sociétés. A force de penser que nous devions éviter d'être partiel faute de ne répondre qu'à une partie du problème, la tentation permanente a été de vouloir tout reconstruire, ce qui à l'évidence est impossible. L'analyse donnera donc peut-être parfois l'impression de s'éloigner du sujet.
Les motivations qui nous ont conduit à persister sont contenues dans le paragraphe précédent. Ce dont nous avons besoin, plus que jamais, c'est d'une pensée qui soit capable d'appréhender des problèmes
7 M. Jollivet, Pluridisciplinarité, interdisciplinarité et recherche finalisée ou des rapports entre
sciences, techniques et sociétés, in M. Jollivet (dir.), Sciences de la nature, sciences de la société - Les passeurs de frontières, Paris : CNRS Editions, 1992, pp. 519-535.
8 A. Atlan, Entre le cristal et la fumée - Essai sur l'organisation du vivant, Paris : Seuil, 1979, cité in O. Godard, Le concept d'environnement, une hiérarchie enchevêtrée, in C. & R. Larrère, La crise
concrets. Comme le dit J. D'Hondt, la pensée concrète est « celle qui, au-delà d'un aspect particulier mis en évidence par la pratique et par une situation particulière, sait retrouver la totalité concrète, faite d'une multitude de caractères qui se sont développés ensemble »9. L'abstraction est une réduction de la diversité
du réel. Il est inévitable que nous ayons à réduire le monde à quelques idées, le tout est d'arriver à une réduction qui ne manque aucun aspect déterminant du réel. Si l'on manque une dimension fondamentale de l'objet, l'analyse est ruinée. Et les décisions qui seront prises risquent fort de ne pas produire les effets attendus.
Il y a dans l'environnement, comme dans la justice, des aspects structurants dont aucun n'est directement saisie par une discipline en particulier. S'en tenir à une vision disciplinaire, c'est donc s'en tenir à une vision parcellaire. Il faut donc reconstruire un cadre d'analyse unique qui permette d'articuler toutes ces dimensions fondamentales, afin de montrer leurs liens, mais aussi de les situer en référence aux différentes disciplines déjà constituées, qui sont elles aussi des choses du monde. Il est plus facile de rester dans un domaine disciplinaire et d'approfondir une connaissance sûre d'elle-même parce que liée à des problèmes qui sont simplifiés par hypothèse. Comme nous tenterons de le montrer dans l'analyse, nous avons besoin de procédures d'expertise nouvelles, d'approches diversifiées, pas de davantage de scientifiques. La crise environnementale est un problème qui se pose aussi en termes de solidarité des chercheurs avec le reste de la société. Les capacités cognitives humaines sont limitées. Accroître le savoir dans un domaine extrêmement limité ne peut avoir lieu qu'au prix d'une perte du contexte dans lequel se situe ce domaine. Or la crise environnementale est faite de problèmes engendrés par une confiance excessive mise dans la maîtrise locale d'un phénomène dont la généralisation est fondée sur des hypothèses extra-disciplinaires sur le monde qui sont irréalistes et débouchent ensuite sur des effets globaux catastrophiques.
Reconstruire la totalité concrète, est-ce pour autant aboutir à un nouveau paradigme doté des mêmes faiblesses que les précédents ? Nous retrouverons-nous à nouveau dans une vision étroite du monde ? Nous pensons pouvoir affirmer que non. Ce travail n'aboutit pas à une vision étroite du monde, ou en tout cas pas seulement, et ceci pour deux raisons. Premièrement, nous ne sommes pas arrivés à une réponse unique mais à un cadre pour un débat. Le développement durable reste encore à construire, et ceci ne peut avoir lieu que par le débat et la construction d'un nouveau consensus. Les objets que les sciences sociales étudierons le développement durable sera là n'existent donc pas encore. Il y a une indétermination irréductible ici, et nous avons pris soin de la respecter. Deuxièmement, on peut penser que la succession des paradigmes est en quelque sorte la contrepartie de la diversité culturelle, qui n’aboutit pas pour autant à une nouvelle tour de Babel. S'il existe des cultures différentes, c'est parce que l'on ne peut envisager le monde que d'une manière qui est toujours ancrée en partie de particularisme. Ceci ne permet pas pour autant de conclure qu'une vision n'est que particulière et que toute dialogue interculturel est radicalement impossible et voué à l'échec. Il y a de l'universel, il y a du commun dans le monde et nous nous attacherons à le montrer. Mais il n'y a pas de vision complète du monde qui soit unique et vraie.
C'est pour trouver les moyens de répondre aux deux dernières questions posées ci-dessus que nous sommes venus à la philosophie. Si la philosophie tend aujourd'hui elle aussi à être prise dans le mouvement général de spécialisation, elle est pourtant la seule discipline qui ne devrait pas en être réellement une, puisqu'elle est à la racine de toutes les autres. C'est toujours à elle que l'on a fait appel dans le passé lorsque les connaissances établies ne répondaient plus aux problèmes qui se posaient à la société. C'est uniquement en philosophie que l'on peut trouver aujourd'hui un espace de discussion entre les disciplines scientifiques. Il est d'ailleurs regrettable que les philosophes ne contribuent pas davantage à la construction de cet espace, qui reste encore embryonnaire. La philosophie n'a pas réellement de cadre, mais un univers de questions et un corpus de textes provenant d'auteurs qui se sont efforcés d'élaborer ces questions dans différents contextes. Elle est un travail sur les présupposés, sur les préjugés. Ce qui n'était au départ qu'une intuition s'est confirmé au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail.