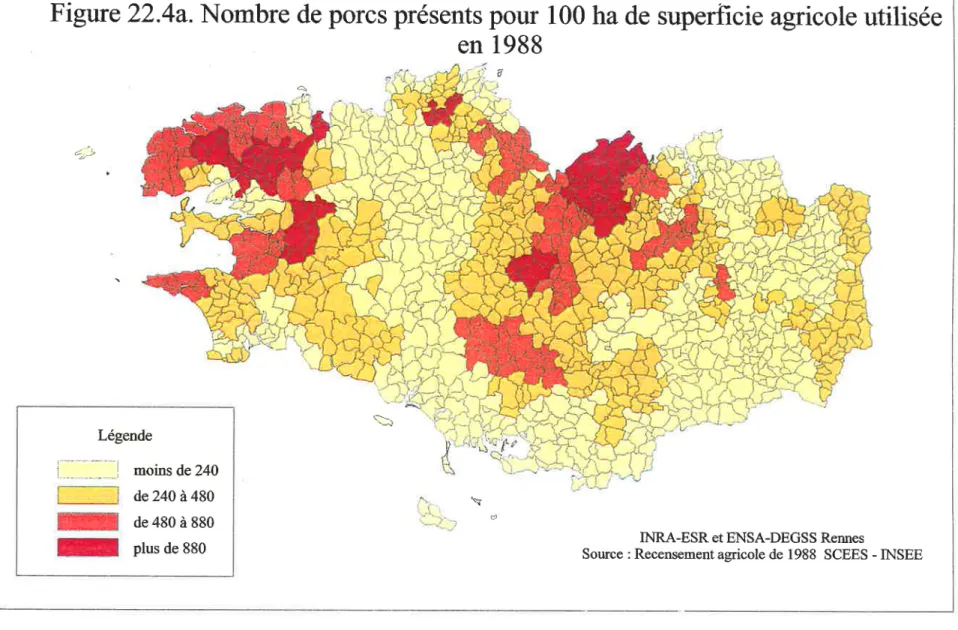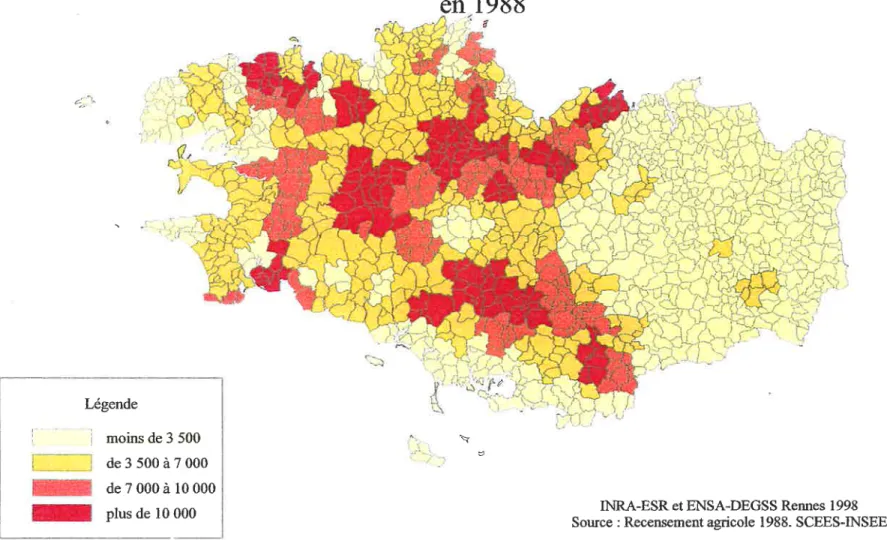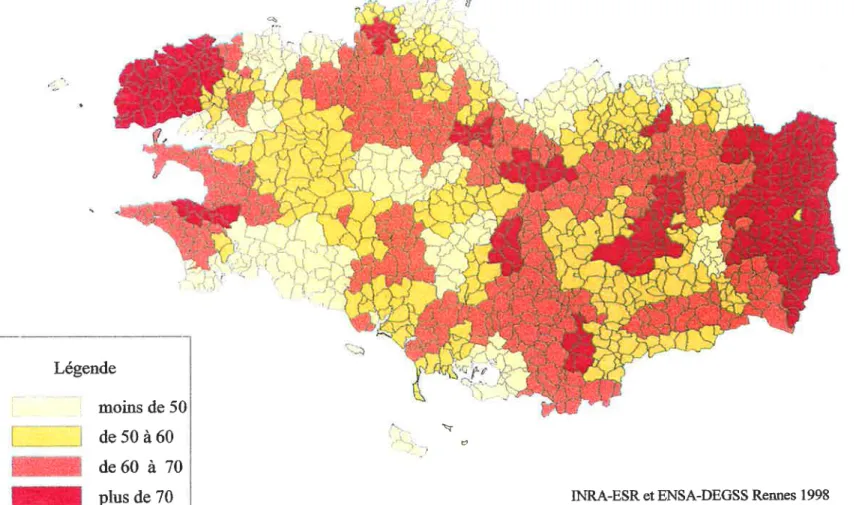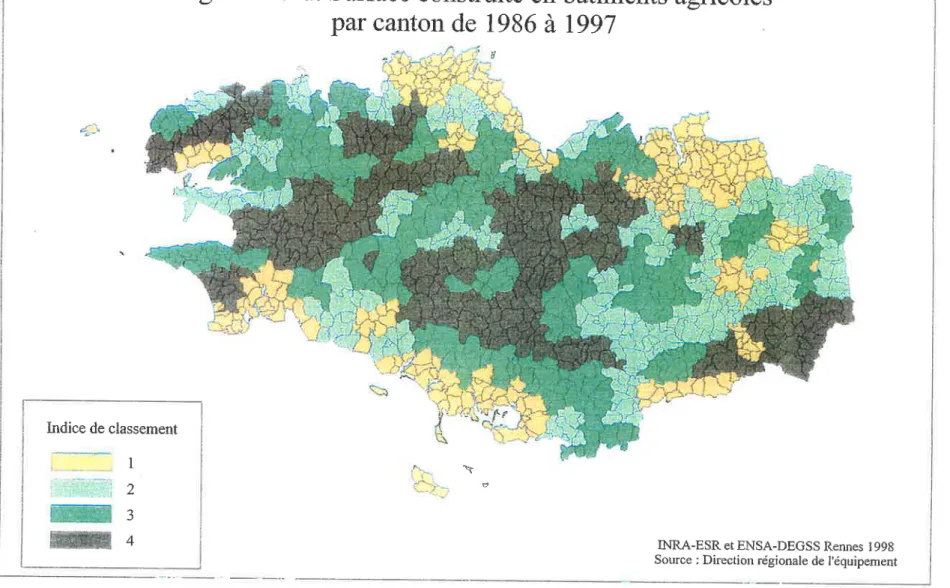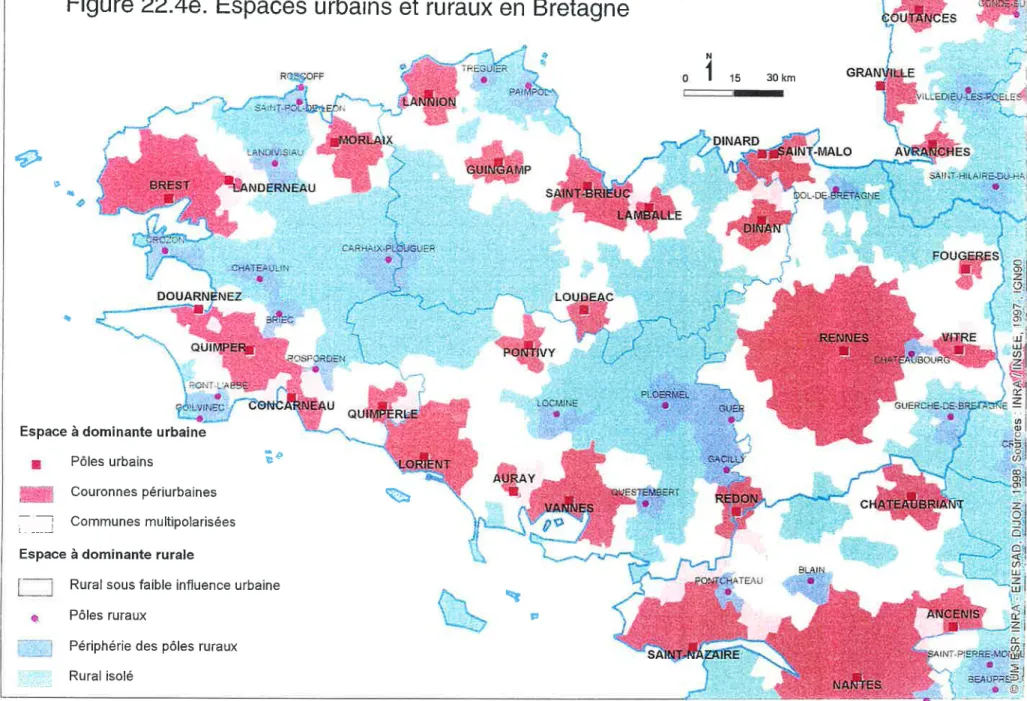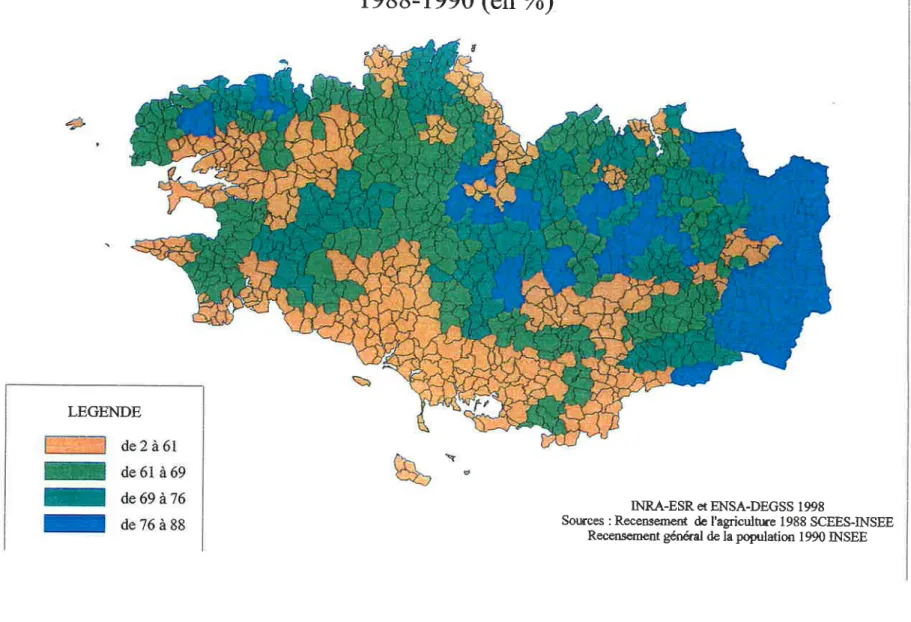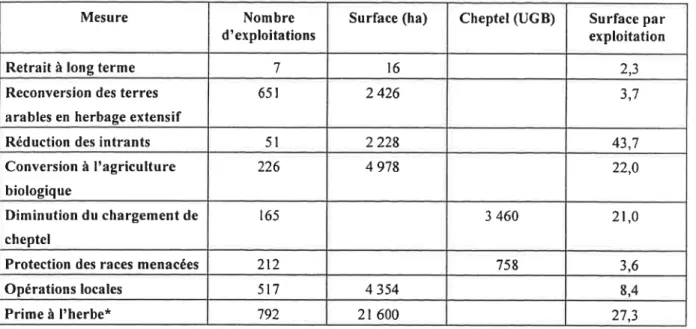HAL Id: hal-02306140
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02306140
Submitted on 4 Oct 2019HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License
Etude prospective sur l’agriculture bretonne
Louis-Pascal Mahé, Pierre Daucé, Philippe Le Goffe, Yves Léon, Maurice
Quinqu, Yves Surry, G. Quéguiner, M. Fayolle, C. Laroche-Dupraz, E.
Samson, et al.
To cite this version:
Louis-Pascal Mahé, Pierre Daucé, Philippe Le Goffe, Yves Léon, Maurice Quinqu, et al.. Etude prospective sur l’agriculture bretonne. [Travaux universitaires] Inconnu. 1998, 124 p. �hal-02306140�
ETUDE PROSPECTIVE
SUR L'AGRICULTURE
BRETONNE
Louis-Pascal
MAHE
(coordination)Pierre
DAUCE,
Philippe Le
GOFFE
(Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes)(Département d'Economie Gestion et Sciences Sociales)
Yves
LEON,
Maurice
QUINQU
et Yves SURRY(Institut National de la Recherche Agronomique) (Unité d'Economie et de Sociologie Rurales, Rennes)
Avec la
collaboration
deMarie-Christine
BACLE,
CathyLAROCHE-DUPRAZ
(Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes)
Anne-Marie
CARDOU, Elisabeth SAMSON(Institut National de la Recherche Agronomique)
Guillaume QUEGUINER, Mathieu
FAYOLLE
(chargés d'étude)Rapport à la Préfecture de Région Bretagne
Novembre
1998
DOCUl\]lEI'ITATO}l ÉCOltO[,lIE RURALE RÉllllES
24.4.
La spécialisation animale de la Bretagne est plus forte que celle des Pays-Bas et du Danemark..L'agriculture bretonne est compétitive
49
5l
24.5. 24.6. 24.7. 24.8.La spécialisation agricole bretonne semble bien portée par l'évolution récente de la demande...
Spécialisation et création de valeur ..
L'analyse comparée des soutiens : ampleur et instrumentation...
25. Les
industries
agro-alimentaires
...51
... 53
...54
... 57
25.1
.
Un secteur massivement spécialisé dans la première transformation des produits animaux et l'alimentation animale... 25.2. Une spécialisation déjà ancienne, sans inflexion notable en longue période 25.3. Un gain de parts de marché dans plusieurs industries 25.4. La compétitivité prix de l'agro-alimentaire breton : une efficacité apparente plus faible bien que Ie secteur gagne des parts du marché national 25.5. Face à une demande nationale de produits alimentaires en moindre croissance, l'industrie agro-alimentaire bretonne dispose de parts de marché encore trop réduites sur les marchés porteurs3.
Les
roruoAMENTAUx
....31.
L'agriculture
dans la
société post-industrielle
:un
nouveau
tournant
32. Le progrès technique et
I'intensification
induite
33. Concurrence
sur
les
ressources
naturelles et
utilisation
de
I'espace
57 58 ....61 64 66 69 69 70 7t 7234. La demande de qualité dans
la
société d'opulence
35.
L'internationalisation
des
questions
agricoles, alimentaires et
environ
nementa1es...36.
Politique
cohérente ou réponses aux
contraintes
?
... 42. 1.
L' environnement institutionnel ... 42.2. Montée de la concuffence internationale43.
Les
risques
internes
43.1.
La concurrence sur les ressources, productives et naturelles .. 43.2 - Les effets d'image...4.
Eru.leux
ET coNTRATNTESsuR
LE
MoDELE AGRo-ALTMENTATRE BREToN ...7641.
Enjeux
pour un développement
régional
durable
42. Les
risques
externes
76 ...77 ...77 79 73 74 80 80 8244.
Anticipation,
stratégie
économique
et
philosophie
de
I'action
publique
...8244.1. Choix de spécialisation et fondamentaux 83 44.2. Les règles de
I'actionpublique...
... 875.
SceruRRtos,
coNsEeuENcES
ETREeoNSES REGtoNALEs....
51. Scénarios
5l.l.
Trois scénarios dans la ligne de la PAC de 1992 et de I'agenda 2000 : << scénariosclassiques
)
...51.2.
Scénarios dans la ligne de Agenda 2000 (avec modulation complète) et des CTE :<< scénarios des CTE ))...
52. Maintien et redéploiement des
actions publiques
régionales et
nationa|es...
53.
lnitiatives
et programmes pilotes
pour
la
8reta9ne...53.1
.
Nouvelle priorité pour lesIAA
: mieux valoriser les produits basiques avant toute nouvelle croissance en volume..IAA et agriculture : soutenir les nouvelles filières... Agriculture, environnement, ressource ... Mise en valeur de I'espace rural...
,88 ,88 ,88 ,93 ,98
t02
t02
s3.2. 53.3. 53.4. ... 104 ... 107 ... r 0954.
((Une
utopie
régionale
>pour
I'agriculture
et I'espace rural en
Bretagne
Conclusion. Bibliographie... Liste des tableaux..
... I I I
Liste des figures... Liste des si4\es...
It3
115 118 120 123 IVRemerciements
L'étude
afait
I'objet
de présentations devant un comité depilotage
composé des personnes suivantes :M.
Bernard Courthial, Chef du Groupe Etudes et Prospective (SGAR)M.
Martin
Gutton, Chargé deMission
auprès du Préfet de RégionM.
JacquesKergoat, Directeur
de
la
Promotion
et
de
la
Prospective (ConseilRégional)
M.
Piene LeFoll,
Chef de laMission
Prospective (CESR)M.
HervéLe Norcy,
Directeurdu
Développement Economique et dela
Recherche(Conseil Régional)
M.
Francis Marty-Mahé,
Chef
du
service Agriculture,
Espacerural
et
Produits alimentaires (Conseil Régional)M.
François Remoué, Chargé d'Etudes au Groupe Etudes et Prospective(SGAR)
M.
PascalRigault,
Chef
du
service des
Etudeset
de
la
Planification
(ConseilRégional)
M.
Yves Trédé, Chef du Service Régional de I'EconomieAgricole (DRAF)
Nous les remercions pour les nombreuses questions posées et
pour
les discussions des analyses et des idées présentées lors de réunions successives.Le
contenu du rapport ne saurait cependant engagerleur
responsabilité et nous assumons seulsle
contenu durapport
final ci
dessous.Cette étude a aussi bénéficié d'entretiens avec les personnes qualifrées ci-dessous, que
nous remercions
pour
ces échangesd'idées.
Leur
responsabilitén'est
pas
impliquéedans le contenu des analyses et des propositions du rapport.
M.
Barbaret, Directeur général Honoraire, CoopagriM.
Kerouédan, Directeur, CréditAgricole
d'Ille-et-Vilaine
M.
Roger, Directeur deNutrinov
M.
Delain, Chef du Service des Industries Agro-alimentaires(DRAF)MM.
Brulé, Cheverry, Cordier, Duchesne, Haury, Leterme, Professeurs àI'ENSAR,
MM
Baglinière,Rainelli,
Directeurs de recherches àI'INRA
MM.
Gouin,Ruffio,
Maîtres de conferences àI'ENSAR
Nous remercions également les services de
I'INSEE, du
SRSA et dela DRAF pour
lamise à disposition de données.
RESUME
Cette étude
a
été conduiteà la
demande des autorités régionales dansle
cadrede
la préparation du contrat de plan Etat-Région.Le
travaila
rassemblé une équipe d'économistes, enseignants-chercheurs et chercheurs du pôle agronomique ENSA-INRA de Rennes. Réalisée dans un délai relativement court et répondant à un objectif synthétique et global, l'étudea
un statut particulier : il ne s'agit pas d'un travail de recherche à proprement parler, mais d'une analyse basée sur les principes économiques qui fondent les politiques publiques et sur I'exploitation des donnéesstatistiques existantes. Le rapport comporte cinq parties.
La première partie présente I'objectif de l'étude qui est de proposer une vue prospective de
I'agriculture bretonne dans un contexte de réexamen de la Politique Agricole Commune, lié aux contraintes actuelles et anticipées de I'Organisation Mondiale du Commerce, à l'élargissement de
l'Europe à l'Est, et aux préoccupations environnementales.
Un
état deslieux
est dressé dansle
deuxième partie.On
met
d'abord I'accent sur l'importance du complexe agro-alimentaire dans l'économie bretonne, ses effets induits et son fortdegré d'ouverture sur I'extérieur de la région. On aborde ensuite les structures de production qui
ont connu une évolution classique (baisse des effectifs, concentration et gains de productivité) accompagnée de la spécialisation et de la simplification des systèmes de production, ainsi que les conséquences en terme de polarisation géographique des productions agricoles. La spécialisation et
I'intensification
de
l'agriculture
bretonneont
égalementdes
conséquences sérieuses sur I'environnement : après en avoir fait le constat, le rapport développe les mécanismes économiques explicatifs ainsi que les qualités et insuffisances des politiques mises en æuvre pour y remédier. La spécialisation et la compétitivité de l'agriculture bretonne sont ensuite rapprochées de celles depays
et
de
zones comparables,en
examinantla
durabilité économique, environnementale et < politique > (évaluée par la faible dépendance des soutiens budgétaires et par les prix). Enfin, un bilan est fait pour I'industrie agro-alimentaire : prédominance des produits de base peu diversifiés, faible taux de valeur ajoutée, mais également progression des produits plus élaborés.La
troisième partiefait le
point sur
les évolutions fondamentalesqui vont
affecter I'agriculture et celle de la Bretagne en particulier. On montre d'une part comment I'agriculture devratenir
compte des préoccupationsdu
consommateur-citoyenqui
recherche des attributs nouveaux, privés ou collectifs, attachés aux biens alimentaires. D'autre part, I'intensification des échanges internationaux(et
l'élargissementde I'Union
Européenne)va
affecter les politiquesagricoles,
les
réglementationssanitaires
et
phytosanitaires,ainsi
que
les
politiques environnementales. L'agriculture régionale sera donc confrontée prochainement à une ouverture commerciale accrue sur les marchés internationaux et à une réorientation prochaine de la politique agricole.La quatrième partie tente de cerner les enjeux de la contribution de I'agriculture bretonne à
un
développement régional durable,face
aux
risques externes (montéede
la
concurrence internationale)et
internes (forte spécialisation, effets d'image négatifs liésà la
dégradation deI'environnement).
Il
donne également des principes pour I'action publique (bienset
services publics non fournis par le marché, promotion de Ia qualité, innovation, diversification, vérité des prix et des coûts).Les aspects prospectifs sont prolongés dans la dernière partie par des projections et des suggestions. On a d'abord réalisé des projections d'impact de la future réforme de la PAC (Agenda 2 000) sur les résultats économiques du secteur agricole breton. Compte tenu des aides nouvelles, le revenu brut d'exploitation par actif en termes réels devrait augmenter entre 1996 et 2005. Enfin, des initiatives régionales sont proposées visant le maintien du système productif du complexe agro-alimentaire breton, la diversification mais aussi la mise au point de produits à vocation universelle attachés
à
l'origine
régionale,la
mise en placed'un
système desuivi
crédible des pratiques environnementales et d'un zonage complet de I'espace rural pour atténuer les conflits d'usage, la mise en valeur du potentiel de I'espace rural.NOTE
DE SYNTHESE
Etude
prospective
de
l'agriculture
bretonne
L'objectif
del'étude
est de proposer une vtre prospective del'agriculture
bretonnedans
un
contextede
réexamende la
Politique
Agricole
Commune,lié
aux
contraintesactuelles
et
anticipéesde
I'Organisation Mondiale
du
Commerce,à
l'élargissement del'Europe à I'Est, et aux préoccupations environnementales.
L'agriculture est d'abord
un
secteur marchanddont
la
fonction
sociale
est
la production de biens et de services destinés aux consommateurs.La
création de valeurqui
en résulte
doit
permettre de rémunérer des emplois. Par sa localisation,l'agriculture
est aussi enforte
interaction avec les ressources et lesmilieux
naturels de I'espacerural.
Ledéveloppement agricole des décennies récentes et la spécialisation actuelle de la Bretagne
doivent donc être évalués à la lumière de sa durabilité liée à trois dimensions: l'économie,
la politique agricole et I'environnement.
L'état des
lieux
La
place
relative
du
complexe
agro-alimentaire (agriculture
et IAA)
dansl'économie bretonne est nettement
plus
marquée que celle observée en France ou dans des pays fortement agricoles comme les Pays-Bas ou le Danemark. Cette place représente en1994
16% desemplois
directsmais
seulement IlYo de
la
valeur
ajoutéede
la
région.Concernant
les effets
induits,
les
effets multiplicateurs
du
complexe agro-alimentaire breton sur la valeur ajoutée de la région apparaissent similaires à ceux des autres secteurs.Le fort
degréd'ouverture
del'économie
bretonne, tantpour
ses approvisionnements que ses débouchés, et I'analyse des multiplicateurs montrent quela
région est sousde
fortesinfluences
extérieures: son
développementest
dépendantde
la
demandevenant
deI'extérieur
de
la
région.
En
outre, l'importance des
consommations intermédiaires importées tant en agriculture que dans lesIAA,
se traduit par un niveau substantiel defuite
des effets d'entraînement vers I'extérieur de la région.
Les
structures
de production agricole
ont
connu une évolution
< classtquel
marquée par la baisse desemplois,
la spécialisation des exploitations, la concentration desproductions,
les
gains
de
productivité.
A
I'avenir,
cette évolution
va
sansdoute
sepoursuivre,
mais
à
un
rythme ralenti, pour
des raisons
à
la
fois
démographiques et économiques,la
phase d'intense modernisation engagée depuis les années60
étant pour partie achevée. Les exploitations agricoles bretonnes sont désormais detaille
économique et de niveau de capitalisation proches de la moyenne française.L'agrandissement et la modernisation des exploitations se sont accompagnés d'une importante
simplification
des systèmesde production,
le plus
souvent organisés autourd'une ou
de
deuxactivités,
et du
recul
prononcéde
systèmesplus diversifiés.
Dans lapériode récente, on notera en
particulier
la très forte régression du nombre d'exploitations laitières et corrélativement un développementrelatif
des systèmes lait-viande, lait-hors sol ou même d'exploitations à dominante céréalière.La
forme
d'organisation
de
I'activité agricole
et
les choix
professionnels desmembres des ménages agricoles
se
sontmodifiés très
sensiblement.Le
développementrapide, depuis
le
début des années80,
desformes
sociétaires està
relier
aux
avantagesqu'elles
procurent en matière de statut réglementaire, de prélèvements fiscaux et sociaux,d'organisation du travail et
desloisirs,
de constitutiondu
capital professionnel,voire
depouvoir
de
négociation avec
les
partenaires économiquesdes
filières.
Parallèlement,I'accroissement
de I'activité non
agricole
des épousesd'agriculteurs participe
de
cettevolonté et de cette capacité à
diversifier
les ressources du ménage qui souvent ne sont plus uniquement, ou même parfois ne sont plus essentiellement,d'origine
agricole.L'agriculture
resteI'activité
majoritaire dans I'espace rural, mais on note plusieursévolutions importantes à cet
égard:
en premierlieu,
des formes de polarisation croissante des productions animales intensives dans certaines zones géographiques (les constructions récentes continuent de se concentrer dans des zones en excédent structurel) et, en secondlieu,
des risques de concurrence accrue en matière d'usage des sols dans les < zones de contact >> entre urbains et ruraux,qui
sont des territoires directement soumis à I'influence desvilles
ou àfort
potentiel touristique.L'adaptation
structurellede l'agriculture
bretonnen'est
sans doute pas achevée, mais elledoit
se poursuivre en cohérence avec les perspectives du développement régional, cequi signifie qu'elle
ne doit pas nécessairement s'opérer dans Ia continuité des tendances passées,qu'elle
doit
prendre en compte les nouvelles missions assignées àI'agriculture
et que lespolitiques
correspondantesont
elles-mêmes à se préoccuper de nouveaux objectifs et de nouveaux instrumentsd'intervention.
L'essentiel des interventions publiques reposeencore
sur des aides à la production, relevant de décisions nationale et communautaire.Il
faut
désormais
envisagerune véritable politique rurale
intégrée,
et
une plus
grandesubsidiarité dans sa conception et son instrumentation.
Les
effets
de l'agriculture
bretonne
sur
l'environnement
suivent
une
tendancepr,loccupante.La
baisse de qualité dela
ressource en eau pour les usages marchands estréelle,
et
se poursuit.La
dégradation desmilieux
naturels, particulièrement des fonds devallées,
qui
ont
plusieurs fonctions d'intérêt
public,
est
égalementeffective
et
semblecontinuer.
Les
émissionsd'effluents
continuent d'augmenter et l'usage d'engrais a reprissa croissance après
un
fléchissementde
1990
à
1994.On
constateque
c'est
dans lesexploitations hors sol et légumières intensives que les excédents de fertilisants et les usages
de
produits
phytosanitaires sont lesplus
élevés. Les pratiques agricolesont
évolué sousdiverses influences
;
elles
sontpour
une
bonnepart
à
I'origine
de
ces
dégradations etpourraient être améliorées.
Le
potentiel de certaines zones de I'espacerural
au regard desfonctions récréatives est menacé.
Il
constifue pourtant une ressource àexploiter
dans unevision
globaledu
développementrural,
comprenant bien entendu I'agriculture, mais aussi les autres usages de I'espace.Les atteintes à I'environnement sont d'abord dues aux évolutions technologiques et
structurelles
de I'agriculture.
On
constateen
Bretagne
une
convergencedes
facteurséconomiques fondamentaux
et
des
incitations
de
politiques
économiques
veru
lasimplification et
la
spécialisationdes
systèmesd'utilisation
dessols.
Deux
groupes de systèmes prédominent associant, pour les uns, les cultures aidées et les élevages hors solsqui ont besoin de surfaces d'épandage et, pour les autres, les herbivores intensifs où le maïs
fourrage est important. Dans les deux cas, les usages des sols comme les prairies (dont les
surfaces
ont
été
à
peu
près diviséespar
deux en trente
ans),qui ne
reçoivent
aucunesubvention
spécifique ciblée de niveau
comparable,sont
rendusmoins attractifs,
alorsqu'ils sont
générateurs d'effets externespositifs
parleur fonction
épuratriceet
récréative.Les atteintes
à
I'environnement sont aussi duesà
la
PAC
carle
soutien desprix
nourrit
I'intensification. Les comparaisons intemationales le démontrent. Cela conceme d'abord et
surtout les
grandescultures
mais
aussiles
élevagesbovins
intensifs
(
viande
et
lait).
L'usage
accru desfertilisants et
des pesticides, etle
mouvement de régression en longuepériode des prairies permanentes y trouvent une bonne part d'explication.
Le
dispositif d'intervention sur les pollutions d'origine agricole
apparaît commeimportant. On peut le caractériser d'abord par I'ampleur du volet curatif et la mise en place
progressive mais récente de mesures préventives de
limitation
des rejets. D'autre part, audelà
des programmesde
sensibilisation,le
recoursà
des mesures réglementaireset
auxsubventions a été
privilégié par
rapportà
des mesures reposantsur le
principepollueur-payeur
et
son
pendant,
le
principe
non
pollueur-non payeur. L'une des
questionsimportantes
est
d'évaluerle
rôle incitatif de
ces mesuressur
l'évolution
des pratiquesindividuelles
et
leur rapport
coût-efficacité.
Il
faut en
effet
rechercher,en plus
desinterventions basées sur les contrôles qui sont souvent peu efficaces, des systèmes
incitatifs
qui
canalisent les comportements économiquesindividuels.
Autrementdit,
il
faut que les bonnes pratiques, plutôt que les mauvaises, aient un impactpositif
sur le revenu.Les effets des mesures mises en place tardent à se traduire dans I'amélioration des
indicateurs environnementaux.
L'application
plus stricte des normes, à défaut de mise en æuvre du principe pollueur-payeur, est nécessaire pour faire évoluer les pratiques.Il
fallait
peut-être
accorderdes
subventionsà la
mise
aux
normespour
régler
en
urgence dessituations que
les
processusde
décision
collective
avaient laissé
échapper,mais
uneparticipation publique
aux
investissementsforfaitaire
et
non
proportionnelle
eût
évitécertains effets
pervers.En outre,
il
faudrait
éviter de
subventionnerle
traitement
deseffluents et de légitimer les
agrandissementsnon
autorisés.A
défaut, celareviendrait
àdonner
un
messageincitant à la
croissanceet à
l'augmentation de
la
densité sans, parailleurs,
apporter lesincitations
concrètes àmodifier
les pratiques et sans transmettre auxagents
concemésI'information sur leurs
coûts
réels
de
production, résorption
de
lapollution
comprise.Quant au
rôle
deI'agriculture
dansla
production d'aménités,il
y
a unvrai défi
à relever pourdéfinir
des critèresd'attribution
et donc de ciblage des aides bénéficiant auxagriculteurs
pour
les
lier
davantageà la
préservationde
I'espacerural
et la
fournitured'aménités.
De
plus,
I'ampleur relative des
enveloppes
agri-environnementales est actuellement faible par rapport à celle des instruments traditionnels de la PAC qui donnent en outre des incitations concernant I'usage des solsallant
en sens inverse. La participationaux
mesures agri-environnementales estfaible
en
Bretagne(2%
de
la
SAU
et
l%
desUGB). Une
réforme
des
instruments
d'intervention
est
devenue nécessaire,la
Loi
d'Orientation
Agricole ouvre des possibilités en ce sens.L'agriculture
bretonne,
en
tant
que
secteur
productif, apparaît
comme
très spécialisée.La
spécialisation vers les productions animales (86%
de la production finale), et plus précisément vers le hors sol, est nettement plus accentuée que celle observée dansdeux pays d'élevage
intensif,
commele
Danemarket
les Pays-Bas.La
particularité de la Bretagne estl'addition d'un
important
secteuravicole
aux
autres productions animalesdont la place est du même ordre de grandeur dans les
trois
zones. Cette spécialisation s'estpoursuivie
récemmentpar rapport
à
celle de
la
France entière.
On peut
souligner
ledéveloppement
aux
Pays-Bas desproductions
légumièreset
surtout horticoles
qui
ontensemble gagné en
dix
ans une dizaine de points de pourcentage de la production finale, cequi montre qu'une diversification vers d'autres productions agricoles est possible.
L'adéquation
de
la
spécialisationagricole
bretonneà
l'évolution
récentede
lademande de
produits
agricolesest
convenable. Cette spécialisation seraittoutefois
pluscohérente
avec
l'évolution de
la
demande internationalequ'avec
celle de
la
demande française et européenne.Elle
serait dans uneposition
proche de celle des.Pays-Bas et duDanêmark,
poui
I'udéquation
à la
demandenationale
ou
européennel.L'agriculture
bretonne semble donc, dans la ligne du passé récent, dépendre des marchés mondiaux pour
la
poursuitede son
développement.L'agriculture
bretonne apparaîtpar ailleurs
commecompétitive, sans avantage de
productivité
notable par rapport àla
France,y
compris enhors
sol.
L'avantage
concurrentielviendrait de l'organisation
desfilières. Les
résultats économiques en terme de revenus sont proches de la référence moyenne française.L'agriculture
bretonne est moins soutenue que celle d'autres régions par les moyensbudgétaires
mais
autantsinon
plus
que
la
moyenne françaisepar
les
prix
garantis. Sa dépendance à l'égard de la PAC n'est que légèrement inferieure à celle de la France pour la part de I'ensemble du soutien dans la productionfinale.
Sa dépendance du soutien passant par les aides directes est inférieure à la moyenne française. Cette dépendance est toutefois plus marquée quand on considère le soutien au regard de la valeur ajoutée agricole qéée.Les deux raisons essentielles de cette situation sont structurelles et liées à
la
spécialisationrégionale:
importancede l'élevage
bovin et laitier, et faible
taux de valeur
ajoutée en général et dans les productions hors sol en particulier. Ces mêmes indicateurs apparaissenttous
plus
favorables aux Pays-Bas,car
ce paysa
les mêmes atoutsliés
aux productionshors sol compétitives que la Bretagne,
il
a en outre peu de cultures fortement aidées et sonagriculture est
plus
diversifiée,
notamment
vers
l'horticulture,
particulièrement
peu représentée en Bretagne. Par rapport aux évolutions envisagées pour laPAC,
lepoint
fort
de
I'agriculture
bretonne est de dépendre peu des aides budgétaires, unpoint
partagé avec les Pays-Bas. Sa situation relative à ladurabilité
<politique
)) est donc favorable, mais sadurabilité
économique est cependantmoins
favorable,et le défi qu'elle doit
relever
estcelui de la durabilité environnementale.
L'industrie
agro-alimentaire
bretonne, àpartir
d'une
spécialisation traditionnelleet
massive dansles
produits
de
premièretransformation, évolue vers
une
gamme
deproduits
alimentairesplus
élaborésà
la
fois
pour les
produits
d'origines
végétale
etanimale.
La
région
gagne desparts de
marché dansla
deuxièmetransformation.
Cetteorientation
estnette
depuis quelques années;
toutefois
les
changementsse
font
encorelentement,
en
particulier
dansI'industrie
laitière
et ne modifient
pasen
profondeur
lastructure de production du secteur, qui reste peu diversifiée et axée sur les produits de base.
Les
taux
devaleur
ajoutée dansle chiffre d'affaires
estplus faible qu'en
France,pour
laplupart
des sous branches desIAA.
Le
handicap deI'industrie
agro-alimentaire bretonneen
matière
de
performances économiques semblestructurel
et
il
s'est même
aggravé concernant laproductivité
apparente dutravail
et le taux de marge, malgré une croissance de la valeur ajoutée globale plus rapide en Bretagne qu'en France.L'examen
de
la
situation
de I'industrie
agro-alimentaire bretonneconduit à
un double constat .D'une
part, ce secteurfait
preuved'trn
dynamisme réel en se réorientantvers des produits plus élaborés et en augmentant ses parts de marché sur ceux-ci, mais cette
évolution récente ne touche pas encore une part suffisante du secteur pour se traduire dans
les
performances globalesde
celui-ci.
En
outre,
sa spécialisation defond n'est
pas enI
Rappelons que I'horticulture n'a pu être incluse dans l'étude de la demande , ce qui défavorise les Pays-Bas.
complète harmonie avec
l'évolution
des marchés porteurs nationaux.L'évolution
récentedes indicateurs
de
performanceen
matière
de
création
de valeur
de I'industrie
agro-alimentaire bretonne est moins favorable que
celle
des indicateurs nationaux. Ce secteurcontinue certes à embaucher, mais surtout dans I'abattage des animaux .
Les
fondamentaux
La place de
I'agriculture
dans la société post-industrielle est à un nouveau tournant.Le
contexte historique et économique des années 1990 est radicalementdiffrrent
de celuiqui
prévalait lors
dela
mise en place dela
Politique Agricole
Commune. Les Européenssont
pour
la
plupart
aiséset
bien nourris. Temps
libre et
préoccupations éthiques se renforcent avecla
croissance des revenus.La
demande de "nature" se développe. Dans ce nouveau contexte, un secteurmultifonctionel
commeI'agriculture,
secteur qui produit à lafois
des denrées de base et des produits de haute qualité et occupe la majorité du territoire,voit
son rôle dans la société renouvelé.En
dépit de
la
conjoncture récente,les
revenusmoyens
en
pays
industrialisés restent élevés et continuent d'augmenter. Cette situation a pour conséquence d'accroître la valeur économique du temps, de la santé et de lavie,
et plus spécifiquement, de stimuler lademande de qualité, de variété, de différence,
voire
d'éthique. Ces critères de qualité sontpour certains définis de manière absolue selon des bases objectives, pour d'autres, comme le bien-être animal et la biodiversité, ils émanent de préférences subjectives.
Le
progrès technique a pris unetelle
ampleurqu'il
peut exercer une réelle menacesur
l'occupation
de
I'espace
rural
et
sur
la
préservation
des
ressources naturelles.L'évolution
combinée des structures deproduction
agricolevers
la
spécialisation,et
destechniques
vers
I'intensification
de
I'usage
d'intrants industriels,
exerce
une
menacecroissante
sur
la
qualité de
I'environnementrural
et
donc sur les
ressourcesqui
enproviennent. Les changements techniques
qui
économisent la main d'oeuvre ont pour effetde
rendre clairsemée I'occupation de I'espacerural
et
parfoisde
compromettrela
survied'une société
rurale
animée.En
même temps,la
demande d'aménités procuréespar
lesqualités
esthétiqueset
récréativesd'un
espacerural
domestiqué s'est renforcéepour
lesraisons indiquées plus haut. Les politiques de développement
rural
et régional ne peuventplus être
seulementagricoles. Ces questions
sont
centralesdans
les
discussions surl'évolution de
la
nouvelle
PAC
en cours
dansle
cadrede
I'Agenda 2000,
la
nouvelle instrumentation de la réforme de 1992 n'ayant pas réellementpris
en compte les questions environnementales.L'internationalisation des questions agricoles, alimentaires et environnementales est
un
fait
depuisles
accordsde Manakech. Les
nouvelles règles imposéesaux
politiquesagricoles, douanières et intérieures,
vont
se faire de plus en plus prégnantes sur la marge demanæuvre
des Etats nationaux
en
ces matières.
Des
interactions nouvelles entre
lespolitiques
agricoles,
les
réglementations sanitaireset
phytosanitaireset
les
politiquesenvironnementales par le biais des échanges
vont
également prendre de I'ampleur au coursdes prochaines années.
L'adhésion
prochainede
plusieurspays
de
I'Europe de I'Est
àl'Union
Européenne pose un problèmeréel
àla
PAC.
L'entrée de paysà forts
potentiels agricoles rend improbable à terme le respect de certaines contraintes deI'OMC
et alourdirala
contribution des
actuels membresde I'Union.
L'élargissementrécent vers les
paysnordiques a renforcé le poids des objectifs liés à I'espace rural au détriment de ceux liés à
la promotion
des exportations. Les Etats Membres contributeurs nets au budget européen,comme
l'Allemagne
enparticulier,
expriment une(
fatigue
politique),
et
remettent en causele
financement communautaire dela
PAC.
Les exportations subventionnées serontles plus
directement menacéeslors de la
prochainenégociation
de I'OMC. Les
aides couplées aux productions sont également menacées à terme, car les critèresd'éligibilité
à laboîte verte seront vraisemblablement renforcés.
L'agriculture bretonne, comme d'ailleurs I'agriculture nationale,
sera
doncconfrontée
prochainement
à
une
ouverture commerciale accrue
sur les
marchésintemationaux
et
à
des
prix
des produits
basiquesqui
seront
moins
stabilisés
parI'intervention. Compte tenu de I'orientation de la région, ce n'est pas, sauf pour
le
lait
et Iaviande bovine, une totale
nouveauté puisqueles
productions hors
sol et les
légumes,fortement
représentésen
Bretagne, releventd'OCM plutôt
< molles >>au
sensoù
elles n'assurent pas une grande stabilité desprix.
Ces contraintes peuvent inciter à suivre une stratégie de modifications minimales en
donnant la
priorité
à des acquis. Les consommateurs, les agriculteurs, les contribuables et les usagers de I'espace rural méritent mieux, c'est à dire une politique régionale agricole etrurale
conçuede
manière cohérenteet
mobilisant
des instrumentsmieux ciblés
sur
les nouveaux objectifs.Enjeux et
contraintes sur
le modèle
agricole
et agro-alimentaire breton
Faceaux
trois
durabilités
(économique,politique
agricole
et
environnement) le modèle agricole breton est aujourd'hui fragilisé, tout en gardant des points forts. Les enjeuxprincipaux nous semblent être les suivants :
-
faut-il
se maintenir surle
sentier actuel dela
croissance et de la spécialisation enprolongeant les tendances passées ou
faut-il
favoriser le redéploiement ?-
vers quelle direction
orienterun
tel
redéploiement, comptetenu
des avantagescomparatifs régionaux ?
-
faut-il
maintenir
des
contraintes légères
et
des
noffnes
bassesen
matièred'environnement de façon à maintenir et renforcer la
compétitivité
?-
les
collectivités publiques
doivent-elles
participer
au
financement
de
ladépollution pour rendre les productions plus compétitives ?
-
les
collectivités doivent-elles concenher
leurs
moyens fînanciers
sur
lerenforcement de la compétitivité du coeur de I'appareil
productif
en place ou doivent-ellesprivilégier
les actions de prises de risque et dediversification
? - peuvent-elles faire les deux en même temps?- peuvent-elles renforcer leurs moyens d'action alors que I'essentiel des instruments sont déterminés au niveau national ou européen ?
Ces
différentes
options
sont
à
apprécier
dans
un
contexte
où
la
région
est confrontée à des risques internes et externes. Les premiers viennent, au delà des contraintesde
I'OMC,
dela
montéede
la
concuffence internationalequi
seraforte
surles
produitsbasiques, venant de pays
bien
dotés en ressources naturelles(USA,
Amériquedu
Sud) et capables de mobiliser les techniques disponibles. Les risques internes sont d'abord liés à latrès
forte
spécialisation qui rend la prospérité deI'agriculture
régionale sensible aux chocs économiques conjoncturels, fréquents sur les marchés des produits de base, ou àl'érosion
des débouchés.
Ils
sont aussiliés
aux conflits
d'usage des ressources naturelles commeI'eau ou l'espace,
qui
émergent dans certaines zones, et aux effets d'image négatifs pour larégion
dela
perception parle
public
de I'existence de nuisances environnementales, quipeuvent obérer son attractivité ou la promotion des produits de qualité.
Anticipations, stratégies
économiques
et
philosophie
de
I'action
publique
En ce qui concerne les produits standards, dont la technologie est arrivée à maturité,
toute économie ouverte (et c'est le cas d'une région comme celui
d'un petit
pays) tirera laplus
grande prospéritéd'une
spécialisation dansles
activités
où
résident ses avantagescomparatifs.
C'est
la
stratégiequi
permetd'atteindre
un
bon niveau
de
<< compétitivité-corîtv. Mais la
concurrence est très fortepour
les produits de base, etelle
le restera. Cesproduits sont exposés aux fluctuations de la demande internationale et des
prix,
ainsi qu'au risque de change,tout
au moins pour les marchés extérieurs à la zone Euro.Ils
sont aussi sensibles aux distorsions de concurrencequi
peuvent menacer cette compétitivité-coût. La PolitiqueAgricole
Commune peut engendrer de telles distorsions, comme elleI'a fait
dansle
passé pourl'alimentation
animale.
Les intérêts régionauxdoivent
êtrevigilants
sur cepoint,
dans les arbitrages nationaux ou européens, faits par les pouvoirs publics et par les organi sati ons profe s sionnel I es.La
politique
agricole peut
apporterune
< compétitivité-aidée)), en
assurant des débouchés garantis, desprix
favorables, voire des aides à la production. Cette stratégie, quia
été longtemps cellede
la
France en Europe en défendant une <politique
dynamique à I'exportation >>, est possible et même habile. Son problème estqu'elle
ne dure que le tempsdu
consensuspolitique qui la
valide.
Il
en est de
mêmepour
unepolitique
de
normes basses concernant, par exemple, I'environnement. Une telle stratégie trouve salimite
dans sa durabilité qui est limitée.La
stratégie basée surla
< compétitivité-valorisation > estla
seulequi
échappe en grande partie àl'érosion
des marges entre lesprix
et les coûts.Elle
consiste àcultiver
lepouvoir
de marché par la différenciation des produits par rapport à Ia concurrence, vers lesbiens
supérieurs
à
demande
en
expansion.
La
differenciation passe d'abord
parI'innovation,
qui bénéficie d'une protection temporaire par les brevets mais qui est soumiseà la
loi
du cycle du produit. Elle
passe aussipar les
marques commercialesdont
laprotection peut être durable mais dont les coûts de lancement et d'entretien
impliquent
lagrande dimension et,
pour
une région, sans doute des coopérations entre entreprises.Elle
passe encore par la
typicité
et I'attachement de I'image o,,à.
ladéfinition
duproduit
à sonorigine
régionale.La
protection des produits typiques peut également être durablepar
lebiais de
l'indication
géographique de provenance (IGP).Il
paraîtclair
que la troisième stratégie est la plus féconde pour fonder durablementla
prospérité
et
assurer
la
résilience
de
l'économie
régionale
face aux
évolutionséconomiques.
Elle
va bien au delà de la recherche de la valeur ajoutéequi
trouve salimite
dans
l'imitation par les
concurrents.Elle
est diffrcile et riche en esprit
d'entreprise,d'innovation
et d'organisation économique.Elle
ne peut se faire que dansla
durée. C'est,nous
semble-t-il, l'étape
quele
complexe agro-alimentaire breton ajuste
abordéet
qu'il
doit poursuivre.Les
pouvoirs
publics sont dans
leur
rôle,
lorsqu'ils facilitent
le
démarraged'industries naissantes qui comportent toujours un risque pour les entreprises individuelles.
Ils
sont
aussi dans
leur
domaine
en
fournissant
les
infrastructures
physiques,informationnelles
et
intellectuelles,
qui
soutiennent
I'innovation
et
I'organisationéconomique.
L'usage
des fonds publics est beaucoup plusdifficile
àjustifier,
sur un pland'efficacité
économique,pour
la
prise
en
chargedes
coûts
externes,en
particulier
environnementaux, des
activités
existantes anivéesà maturité. En effet
cetteprise
en charge publique peut alors contribuer à masquer les coûts totaux de la production et donnerles
mauvais signaux quant
aux
avantagescomparatifs dans
une
perspective
de développement durable.Celui-ci
exigela
prise en compte par les agents économiques descoûts vrais. Les
pouvoirs
publics doivent,
dansleur
action
économique,plutôt
queconforter I'existant,
(
semer des graines d'avenir >. Cela est beaucoup plusdifficile
et plus aléatoire.Scénarios, et réponses régionales
Deux
types de projectiondu
compte dela
bancheagricole
dela
Bretagneont
été réalisés.Le
premier type de scénario vise àcomparer
l'évolution
des comptesde
1996 à 2005 dans un régime où I'actuellePAC
est maintenue (scénario de baseI),
à celle résultantde
I'application
des propositions deI'Agenda
2000 (avec une variante optimiste, scénarioII,
et
une variante
pessimiste, scénarioIII).
Dansle
secondtype de
scénario,un
peufuturiste et
schématique,le
soutienglobal
àI'agriculture
en France serait maintenu maisréparti de façon
selon des critères differents
de
ceux
d'aujourd'hui
et
découplés desproductions.
La
valeur ajoutée globale nominale stagne ou même baisse àla
suite de la mise en æuvre de I'Agenda 2000, ce qui est dû à la baisse desprix
garantis. En centrantI'attention
sur deux
des indicateurs calculés,le
revenubrut
d'exploitation (RBE)
global en
valeur nominale et surle
RBE parUTA
en valeur conigée del'inflation,
on trouve les résultatssuivants:
il
apparaît quele RBE
global
nominal progresse danstous
les scénarios mais davantage dansla
varianteoptimiste
(II)
d'une répercussionpartielle
des baisses deprix
institutionnels à la suite deI'application
d'agenda 2000. Quant auRBE
en termes réels paractif
il
progresse de façon notable dans lestrois
scénarios, les deux scénarios de mise en æuvre deI'Agenda2000
encadrant celui de la projection tendancielle.Le
scénario futuriste correspond à la logique del'Agenda
2000 poussée à son termeet à celle
desCTE
dela
loi
d'orientation,
sans prétendres'y
identifier
complètement.Il
consiste à
répartir
I'enveloppe nationale du soutien enfonction d'une
clé régionale basée sur une combinaison des actifs agricoles, de la surface en prairies et du linéaire de haies.Il
montre que, dans une telle éventualité, la Bretagne continuerait de capter le même montant de soutien global que dans la situation actuelle des aides couplées aux productions.
Les programmes régionaux menés, dans le passé récent et en cours, nous paraissent dans I'ensemble reposer sur des fondements économiques sains.
Il
en est ainsi des actionsde
promotion
dela
qualité, dela
sécurité des aliments, dela
certification,
des aidesà
la recherche-développement dans les entreprises, de lapromotion
des exportationset
de lavalorisation
de
l'image
régionale.
Les
aides
visant
à
I'externalisation des coûts
detraitement nous semblent moins fondées à cause du risque d'encouragement à la croissance
d'activités
potentiellement polluantes sans apporter uneréelle incitation
aux changements de pratiques.Une série de suggestions sont formulées sous formes
d'initiatives
et de prograûrmespilotes pour la Bretagne. Elles s'articulent autour de quatre thèmes :
-
valorisation
des
produits
des
IAA par
la
promotion
de
la
recherche-développement, la mise au point de produits à image régionale et à vocation universelle, etla mise
en place
d'un
instrument financier
de
capital risque
pour
financer
des projets potentiellement rentables mais aventureux ;-
soutiensaux
nouvellesfilières
dansles
IAA
mais
aussi dansl'agriculture
;
lescandidates
possibles étant,
la
transformationde produits
végétaux,I'horticulture,
des programmes pilotesAOC,
des produits à label vert etI'agriculture
biologique, les réseaux de produits fermiers qui sont des éventuelles pépinières pour des produits à fortetypicité
;-
prograrnme
visant
à
une
amélioration
de
l'impact
de
I'agriculture
surI'environnement
comprenantun
moratoireà
la
croissance dansles
zonesen
excédentsstructurels
jusqu'à
amélioration
des indicateurs environnementaux,la
mise en place
de clausesd'éco-conditionnalité
liées aux aides dela PAC, la
mise en Guvreffictive
d'un
cahier
de
fertilisation
joignant I'incitation au contrôle,
et
l'établissementd'un
zonagecomplet de I'espace rural
afin
de minimiser lesconflits
d'usage dans les zones de contact ;- programme de mise en valeur de l'espace
rural
comprenant, entre autres, la remiseen état du
patrimoine architectural
et
paysagerde
I'espacerural
et
la
mise en
placeeffective
de I'accès aux aménités rurales par la mise en valeur des chemins ruraux commela
créationd'un
grand réseau régional de cheminsruraux
cyclables et ouverts aux autresamateurs
d'activités de
plein air. Le
potentieltouristique
d'un
tel
réseauparaît être
unvéritable gisement.
On peut
envisager une utopie régionaleoù
I'essentieldu
soutien passeraitpar
des
instruments
dérivés
des
Contrats
Territoriaux d'Exploitation, donnant
auxagriculteurs des compléments de revenus
tout
enévitant
les incitationsà I'intensification
contradictoires
à
la
préservation du patrimoine naturel.Les
aides seraient basées sur despoints verts attribuées en fonction de < trois bases > d'aménités rurales :
-
la tenue des sièges d'exploitation,-
la campagne et les champs-
les communs ruraux.Conclusion
Après avoir réussi dans le défi de la modernisation d'une agriculture traditionnelle, les agriculteurs bretons,
et
leurs partenaires desfilières,
sontaujourd'hui
faceà
celui
deprolonger
uneagriculture
industrielle modernepar
la
diversification
etla
recherche de laqualité
dans ses diverses dimensions,celle
desproduits et
celle de
I'espacerural.
Les ressources en hommesont
fait
leur preuve lors de la phase industrielle du développement,elles
sont à même de réaliserla
deuxième étape,celle du
développementqualitatif
et du développement durable.La
Bretagne peut ainsi devenir lefer
de lance de la mise en placedu
modèle
européend'agriculture
ou,
mieux
encore,ùt
modèle européende
I'espacerural.
000
1. OBJecflFS
ET GHAMP DE
L,ETUDE
L'objectif
de l'étude est de proposer une vue prospective surI'agriculture
bretonne.L'agriculture
est
I'un
des
secteurs
de
l'économie régionale.
Elle
contribue
audéveloppement économique
global
de
la
région.
Un
objectif
raisonnable
dudéveloppement régional est d'assurer
la
prospérité,le
bien-êtreet
la
qualité
devie
deI'ensemble de la population résidant en Bretagne. Compte tenu de l'importance relative
du
secteuragricole, I'enjeu
estd'évaluer
la
durabilité de
cettecontribution
face auxévolutions
fondamentalesen
cours.
Le
contexte général
est celui
d'une
sociétéindustrielle, arrivée
à
maturité,
confrontée
à
une nouvelle
étape
du
changementtechnologique et de plus en plus ouverte aux influences européennes et internationales.
Face
aux
évolutions
fondamentales,il
s'agit
d'éclairer les pouvoirs publics
surI'avenir
du modèle breton de développement agricole et agro-alimentaire qui est encore marquépar la
prépondérance desproduits
de baseet
le
niveau modestede
la
valeurajoutée.
Les
fondamentaux
à
prendre
en
compte sont
la
mondialisation
et
sesconséquences
en
termes d'échangeset
de
compétitivité, l'émergence
de
nouveaux modes devie
et de consommation, les pressions sur I'environnement.L'enjeu
essentielpour la région
est d'évaluer
la
compatibilité
du
modèlebreton
avecla
nécessité depromouvoir un développement durable.
L'agriculture participe
au
développementrégional,
directement
par
sa
proprecréation de valeur qui rémunère
I'emploi
agricole et, indirectement, par la valeur créée dans les activités économiques induites. En premier lieu,il
s'agit
des secteurs deI'agro-alimentaire et de l'agro-industrie. Le champ de l'étude porte donc principalement sur les
deux
secteurs
de
I'agriculture
et
des
IAA
qui
composent
le
<complexe
agro-alimentaire
)
(CAA).
Les liaisons avec les autres secteurs sont prises en compte àl'aide
d'un
tableau
des
échangesinterindustriels.
Partantd'un
constat des liaisons
de
cecomplexe
avec
le
restede
l'économie
bretonne,l'étude
proposeune
évaluation deseffets multiplicateurs induits par
le
secteuragricole.
L'ampleur de
ceseffets
induits potentiels est comparée à celle d'autres secteurs del'économie
régionale.De
plus, les effets induits de la croissance observée deI'agriculture
et desIAA
sur le développementrégional au cours de la période récente sont comparés à ceux d'autres secteurs.
L'agriculture fournit
des emplois, elle crée de la valeur et elle occupe l'espace.Elle
connaît une évolution structurelle séculaire sous I'influence des changements techniques
qui
la touchent directement et des effets indirects de la uoissance économique globale.Ce
secteur
d'activité
a
la
particularité
d'utiliser
la
terre,
de ne
pas
bénéficier d'économiesd'échelle
notables,et d'être
par suite
composé d'entreprises petites parrapport au marché.
Sonévolution structurelle mérite
un
examenapprofondi car
elleinflue
fortement sur la combinaison productive et donc sur les revenus des agriculteurs.Utilisatrice
par nature de terre et d'espace,I'agriculture
est au cæur dela
question du développementrural
et de la répartition de la population sur leterritoire. La
répartitionspatiale des productions agricoles dans la région fera donc
l'objet
d'un
examen attentif.Activité
économique également fondée sur des processus biologiques, I'agriculture esten
intenseinteraction
avecles
ressourceset
les
milieux
naturels.L'agriculture
aforgé les
paysagesqui
composent
notre
imaginaire
et
constituent
un
patrimoine considérable de valeur récréative.L'agriculture
est aussi consommatrice de ressourcesnaturelles et
la
formidable puissance de la technologie dontelle
disposeaujourd'hui
larend
capable demodifier
notablement lesmilieux
naturelsoù elle
opère. Cesmilieux
supportent et nourrissent des ressources renouvelables, comme
par
exempleI'eau,
quiont
une
valeur
d'usagedans d'autres
activités économiques productiveset
dans laconsommation humaine. Ces ressources
ont
aussi unevaleur
récréativeet
même unevaleur
d'existenceliée aux
questionsd'irréversibilité.
La
durabilité
environnementaledu
modèle breton
de
développementagricole
sera
donc
examinée
ainsi que
les déterminants économiques et institutionnels del'équilibre
observé à l'égard desmilieux
naturels.
Soumise à des changements structurels et confrontée à la nécessaire harmonie avec les ressources naturelles,
I'agriculture
reste avant tout un secteur marchand, confronté àla
logique
économique fondamentalequi
est de créer dela
valeur
pour rémunérer desemplois en
produisantdes biens
et
des
servicespour
des
consommateurs ultimes, prochesou
lointains.Elle
est doncliée à
la
logique des marchéset
à l'évolution
despolitiques
économiquesqui I'aident
à affronter ces marchés ouqui
la protègent de leursdysfonctionnements éventuels.
La
prospéritéd'une région,
ou d'un
secteurd'activité,
est fondée soit sur des avantages comparatifs fondamentaux, soit sur des soutiens et des
protections liées aux
politiques
économiques. Ces deux stratégies de spécialisation sontenvisageables
à
condition qu'elles
soient
viables
et
durables,
et
que
le
contexteéconomique
soit
stable.
La
spécialisationet
les
performancesdu
complexe
agro-alimentaire breton seront donc analysées sous ces deux angles d'observation.
L'histoire
montre quele
contexte économique est changeant.Les
entreprises, lesnations
et
les
régions,
qui
n'ont
pas
anticipé
les évolutions,
qui
ont
retardé
les ajustements et qui ont des spécialisations très marquées, ont connu des crises profondeslors
des
changementsrapides
de
I'environnement
économique.L'anticipation
et
laprospective
sontpar ailleurs
un
exercicedifficile et
I'on
ne
peut
s'y
livrer
qu'avec prudence et modestie. Cet exercice, toujours délicat, est d'autant pluspérilleux
que lesconditions de délai de la présente étude ont conduit à fonder les analyses principalement
sur une
élaboration
de
l'information
disponible
et,
pour une faible part, sur
des recherches spécifiques approfondies. On examinera néanmoins les tendances profondesqui,
à
un
horizon incertain
mais
proche,
semblentdevoir
affecter
l'environnementéconomique de
I'agriculture
bretonne. L'ouverture accrue des échanges extérieurs et, enparticulier, de
produits agricoles
est
déjà
en
cours
et
continuera
de s'affirmer.
Lapoursuite
dela
construction européenne va peser surla
Politique Agricole
Commune.La
reprise et la poursuite dela
croissance économique,l'évolution
des modes devie
etde
consommation,
I'accélération des
changementstechniques,
vont
exercer
leurinfluence
surI'interface
entreI'agriculture,
ses clients consommateurs etle
reste de lasociété. L'importance
relative du
complexe agro-alimentaireen
Bretagneconduit
à souligner la portée de ces évolutions pour l'économie régionale dans son ensemble.2.
Le
coMPLEXE
AGRo-ALIMENTAIRE BREToN
:
ETAT
DEs
LIEUX
21.Le complexe agro-alimentaire dans l'économie
bretonne
21'1. La place du complexe
agro-alimentaire (CAA)
est nettement plus
marquée
en Bretagne que dans d'autres ensembles économiques
La
Bretagne
est
nettementplus agricole
et
agro-alimentaire
que
la
moyennefrançaise
et
que
desrégions
ou
nations considérées comme des grandes puissancesagricoles.
En
France,elle
partage cette caractéristique avecla
Basse-Normandie et lesPays-de-la-Loire,
mais
elle
resteplus
spécialiséeen
agricultureet
dansles
industries agroalimentaires que ces régions.Par comparaison avec
la
France, le Danemark ou les Pays-Bas,le
complexeagro-alimentaire occupe en Bretagne une place presque deux fois plus élevée dans le produit intérieur brut. La place du secteur tertiaire
y
est comparable à cellequ'il
occupe dans les autres zones,c'est
le reste des industriesqui
y
est plusfaible
en proportion.Le
secteur des services est également très important, en termesrelatifs,
aux Pays-Bas maisil
estsûrement
d'une
autre
composition
en terme
de
valeur
ajoutée
au
vu
des
écartsimportants de
PIB
par habitant entre ce pays et la Bretagne.Le
retard de notre région à cet égard est important.Tableau 2.l.1
Part du complexe agro-alimentaire dans le PIB : Bretagne, France, Pays Bas, Danemark en 1gg4
Source : INSEE et OCDE ; (l) le CAA conrprend I'agriailhre et les IAA
J