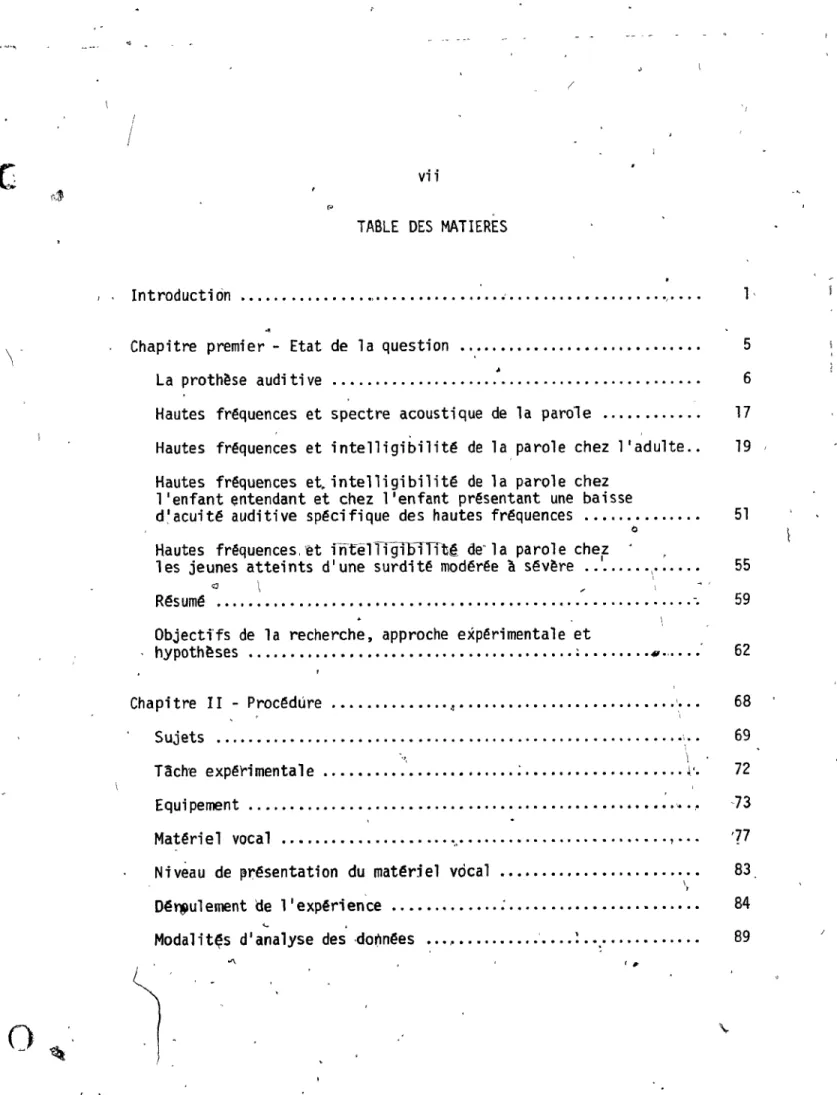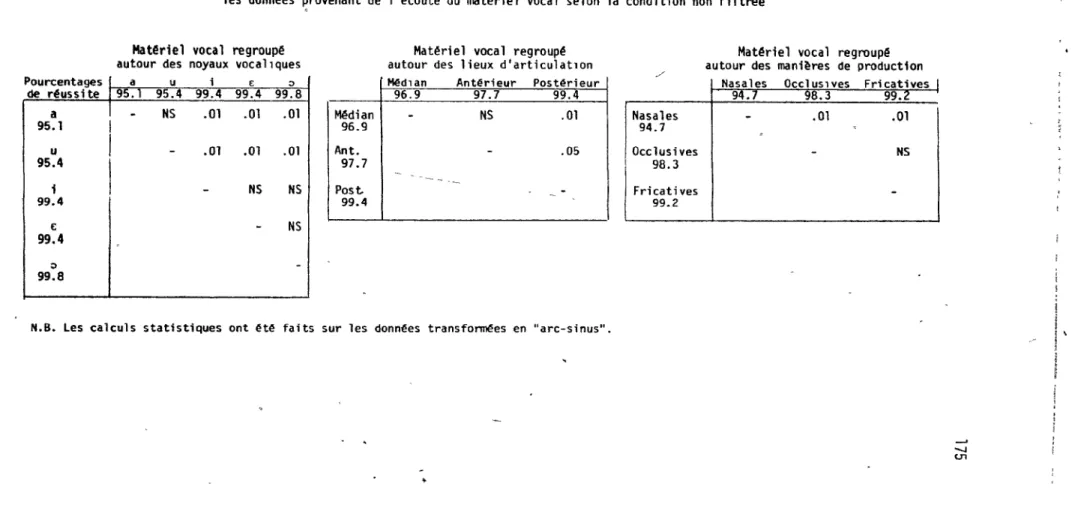-0
. - - - -
----;---'",
EFFET 0 1 UN FILTRAGE LEGER DES FREQUENCES AIGUES SUR
LA
DISCRIMINATION AUDITIVE'OE LA PAROLE DE JEUNES
ENTENDANTS (ÂGE
~. MOYEN 6 ANS)ET DE JEUNES
DE FICIENTS, AUDITI FS (AGE MOYEN 7 ANS)
par
/ /~
Josette LeFrançojs
-j,
..
,..
.Thèse de
doctorat soumise
~la
Faculté
des Etudes
'Supêri eures
1
.
School.of Human Communication Disorders
McG; 11 Un; ve rs ityf
1
..
, , ~fontrt1a'• Décembre 1979
1
, ,1
.
, 1d
\
!
, f .1.
, 1 1 ,.
, 1 \ • 1 11·
,<'
o
/
\;;
RESUME
Josette leFrançoi s
Effet d'un
fil~r~e
léger' desf~quehces
aigues sur la discrimination audl--tive de la parole ae jeunes entenda!'ts (age moyen 6 ans) et de !leUneS
dêfi-cients auditifs
(âge moye~7'ans)
Ph. D. degree
School of Human Communication Disorders
Mc
.Gil1 University
.,
)l'effet du filtrage 1é'ger des hautes fr!quences fut
~tudiêauprês
\ '
de -trois grotlpes de dix sujets chacun.
Des adultes entendants, des jeunes
P I '
entendants
~tdes jeunes d!ficients auditifs
furen~soumis
a
"êcoute
de ~aparole naturelle filtrée passe-bas
a
3 kHz èt non filtrêe. Une hypothêse
6)
fut !mise sur chaque groupe
desujets. Soumis l un test de
discrimi~auditive spécialement é1
abo~
dans le cadre de cette 'reoherche pour le
mil)
eu .
franco-québécois, les svjets devaient pointer dans un ensemble
de
S?Ximages,
"/
ce lle qui
~orrespondait ,au mot émfs.
<
les données expérimentales fur:ent
sou-..
mises l des analyses
devariance et furent inscrttes en matrices de confusions.
l ,
l'ensemle
~esrêsu1tats Jndique l'apport
~e1,signifipàtif et spécifique
de,
ces hautes frêquences dans la discrimination auditive de la parole des trois
groupes
desujets. ,Alors q!Je ces hautes fréquences jouent un r61e similaire
, , 1
i
1
l
j
! 1 , , 1 1L " .. ">-~'"
.
"i
•..
-Hiauprès des deux populations entendantes, elles assument un rôle mo.i-ns 'dêfi'ni
\
mais aussi rêel auprès des jeunes dêficients,auditifs. Appliquês A la pro-thèse auditive ces rêsultats appellent avec grand discernement cependant une meilleure fidêlit~ spectrale de ces ampli,ficateurs portatifs vers les hautes
"'"
fr~quences. les deux groupes de jeunes sujets semblent constituer deu\
nou-1
1
velles populations pdur lJ,.esque11es il devient' important dl ouvrir les ~tudes
, - . ,
de l'intelligibilité de la parole, compte tenu qulils se distinguent Ete la population adulte soit par leur expêrience linguistique limitée chez les jeunes entendants!t soit par leur e.xPêrie!"ce auditive et, linguistique
fort-1 • " \
restreinte dans le éas des jeunes dHicients audit~fs.
1
-/
.
"--'-ê ~J ~ '\ 1 \ ' , , 1./
/ '
.ft ....
,
~
~'.t(
'
{o
\
/
/\
..
iv , , ABSTRACT 0 ' ~-'r-' 'l' , , \ Josette LeFrançoi~. )Effe~~
of a light filterin
high frequeticies on the hearingdiscrimina~ion
1')1 . ' ...--.. ..
of speech in young hearing etH ldren -'average age 6 years) and in youn9 , '
hearing-irnpaired children (average agé'7 years)
Ph. D degree ,
Schéol of Human Conmuni cation Disord~rs
Mc Gill' University" 1 1 \ tJ J : , 1 1
The effect of a light filtering in high frequencies was studied 1 ,1 in three groups of ten subjects : hearing adults, young hearing .children and
\
.young hearing-impaired children. Each group wa~ submitted to 'a sample of
\ , ,
natural speech~ fi,ltered low-pass at 3 kHz and a nQn-fi'l~ered speech. An - hypothesis was formul ated for each group of
Subjec~~
submi tted~o
a\est C!f, \ \
discrimination sp~cially elaborated for this research in the "franco-quebecois milieu". The supjects had to point out from a group of six pictures which one
( , ,
corrésponded to
t.he
word spoken. The experimèntal data was submitted to several analyses ofvarià~ce
and was registered on confusion matrices. The overall ., ' \
, results showed an
,
actu~l, significant and specifie contribu.:tion éf-these high , frequenCies in the s\peech difccrimination of a11 three groups of, subje-cts. ,Wh il e ,these
hi gh frequencie~~, ~
1
,~~.'
simil.
r ,
l'O,le
i;, thetwo
he.~~g
POP" 1. ti
ons. theY,assume a less clearly define 101et though as r.eal in the youn~ hearingimpaired. With respe.ct to hearing aids these results call for a judicious ,
.
;, - - -
---_._--/
. . ' .' , , .. "f' ~_~"""'u~ .... ~"'~ .... _.~~_ .. ~ .. ... _ _ t", ... ,~...,~.r-... -'~--
~-.---"I.. --- -..
-~----
--;....-...----~---\ ' 1G
.
-Ilo
adjustment of high frequency fidelity. The two groups of young subjects seem to form two new populations for\WhiCh it becames important to pursue studies in"speech intellig·ibility. 'Fhese groups distinguish themsel'les
1
d • • , 'from the adult population by their
li"~ited
languageJxperi.ence in the case\ ,L,
of young hearing children and by their very limited hearing and language
-& • '
experience in the case of the young hearing impai red.
'
.
.
' '. 1 ~ j i1
!
1
, \'.
..
o
I l \' , ',. , , , l"',J..
.} , ( vi . REMERe! EMENTS \Je dési re remercier le Dr Daniel Ling, directeur de thèse et le Dr Donald Doehrin9, directeur de la recherche de ml avoir soutenu de leurs conseils tout au cours de la r~alisation ële cette recher:che. Mes remerciements ~ont également au Dr C. -o150n du département de psychologie pour ses conseils statistiques et au Dr R. H~tu de l'Ecole d'Orthôphonie
.
et d' Audio-logie de l'Université de Montréal pour sa précieuse collaboration lors de la rédaction finale de ce document.
, '\ . ) 1
t
1
l ~ il
1 ! 1 \ ! ,1tlI
t
~t'"
~J
~ ~ ?C
~'It
~ ",'SI 1 l, :. " ~\
t t. , ~ [ , ; },
f , io~
'" /1
vi iTABLE DES MATIERES
Introducti on • • • • • • • • • • • • • • • 1 ) ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' , ' • • •
Chapitre premier - Etat de 1 a question ... 5
La proth~se auditive 6
Hautes fréquences et spectre acoustique de la parole ... 17 Hautes fréquences et intelligibi1;t~ de la parole chez l'adulte.. 19 Hautes fréquences et. intel1igibil;t~ de la parole chez
l'enfant entendant et chez l'enfant prêsentant une baisse
d~acuité auditive spécifique des hautes fréquences ...•...
Il
Hautes fréquences. et fntel1igibi';t~ de" la parole chez
les jeunes atteints d'une surdité mod~rée à st:!vhe .. ' ... l • • • • • •
~ ~ , Il
R~sume •••.•••••••.••.•••••••••••••.••••.•••.••.•...•...•••.•..• -.
Objecti'fs de la recherche, approche expérimentale et
hypoth~ses •...•••..••• III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • : • • • • • • •• g., •• • " Chapitre II - Procédure l • • • • • • • • • • • • • • .! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • Sujets ... \ .. "'. \ . rê1ch'e expérimentale ....•...•...•... ; .•... ~'. Equi pell"JE!nt ... ~ Mat~ri el vocal ..•...•...•... , .. . Nivëau de ~~~sentation du mat~rjel vocal ... ..
\ Détfulement de l'exPêrien'ce ... : ... .
<- •
Modalit~s d'analyse des do~n~es \
• • • If • • • • • • • • Il • • • • • • •• • e • • • • • • • • • • • r, 51 55 59 62 68 69 72 -73 ,?7 83 84 89 \. / , 1 1 1 i 1
l '
1i
.
,
l
'.
o
...
' - - - -1 / i vi i i \Chapitre III - Analyse des données expérimentales
- -
~"'---"--93
Matêriel vocal non filtrê ... : .... :... 94
Matêriel vocal f;ltr~ ... '... 97
Chapitre IV - Interprêtation des rêsu1tats ... " .. ~ .. .. Outil de mesure de la discrimination auditive .•.... r • • • • • • r • • • •
Fil trage léger des hautes fréquences ·.n ... ... .
111 113 117
R~surnê et conel us i on" •••••••••••••••.•. -•••• ... ~.. • • .• 158
Annexe A - Tableaux ..•....•...•...•...•.. / ...•...•..
164
Annexe B - Graphiques ...••... e.:> • • • • • • • • • • • ~.... • • • • • • • • • • 222
Références bibliographiques
...
• / 1 1 249 1 ~! l , 1 1 : J!
1 1 l ,.
l
. - - - - ---~
-:. ... p
..
-i10
1
( -'. ~1
i'
1 1 Introducti on•
o
i
1.
;
t
(j
La prothèse auditiv~ constitue la "béquillell
de tout défie; ent a,udi tif. Pour l'adulte dêficient auditif la prothèse auditive facilite et
mêm~ permet
'1
entrée dans un monde sonore nêcessai re à toute communicati on humàine. Pour le jeune déficient: auditif atteint de surditê congênitale sévère et profonde la prothèse auditive devient l'instrument indispensable à l'apprentissage de la parole 'et du langage oral. De la qualité sonore del '
.
1
1
; i , Il 1====='-'=11f>f-a-==pffr'l1 omtttêsl'tfî>c:.e~audit5ve et de sa fidélité ,acoustique dépendent la quaHté. et
'la---.,==~-=--o·
précision des acquisitions pho'nologiques~ et même·,linguistiques du jeune
- ~
défi ci ent audi ti f.
-G Ma l 9rê nos attentes" 1 a prothèse audi ti ve demeure un système d' am-p1ification électro-acoustique de très faible quaH,té sonore. Le,message
o
sonore d'entrée subit de multiples distorsions acoustiques qui en altèrent la· configuroation, à la sortie du réseau d'amp1ific.ation : distorsions spèctrales., distorsions intennodulaires, distorsions de tra'nsitoirès, dist.orsions dlhar- . ,moniques.' Dans le contexte de la prêsente êtude nous*" étions davantage
préoc-cupée par le faible degré de fidé1itê s'pectra1e ae la prothèsE! dans la zone
\
des hautes fréquences, Cl es t-à-di re des fréquences. supêri eur,es '11 3000 Hz.
L 'impact d'~ne telle pauvretê spectrale des hautes fréquences sur \
l' i ntell i gi bi l ité de la parol e est abondall1llent documentê pour la popul ~ti on
\
-
.
*
les acquis,iMons phonologiques réfèrent .aux acquisi tians des divers sons de la langue pà'rlêe.**
Tout aulong
dé ce travail~e "II~OUS.II
est util hé pour fins de poli tesse et signifie de fa.it_ "je" uti1isê pour dêsigner l'auteur de cette rebherche·,.C" 1
1
l
i
"\
1 1 , 1 1 ,.
' 1t
i , ... ""C
";
! ;--t~( )
\ ,..
~..
f 3 . " ,entendants et dêfi ci ents audi ti fs .
N;
nmoi ns très peu dl étudesnt
abord~
ja question aupn!s de'populatlons
d'~nts
tant
enten~nts
que
êficients auditifs._
If
nous appara'i'ssait important dl'aborder cette questionrès de"ces nouvelles populations
Puisq~lelles
ser
distt~~~t
de celle desa ultes, soit par leur expérience linguistique limitée dans le cas des Jeunes
e fants, soit par leurs expêriences
~udit7ve
et linguistique fortr~treintés
ns le cas des jeunes dêficients ~uditifs.
1
.
Dans ce travai 1 nous nous êti ons fi xêe conme pre'mi er objeéti f, d:êtudi er l'effet ~.'un filtrage léger des 'hautes fréquences sur la
discrimi-natiQn a~ditive de la parole de jeunes entendants et de jeunes dêficients
'1 . '"
aJditifs. L'objéctif second du travail était d'êlaborer un nouvel instrument
1
1 •
d~ mesure de la dfscriminatjon auditive de ~a parole, adaptê aux jeunes
enten-dalnts et aux jeunes dêfi'cients
QUditif~
de notre' mi,lieu franco-quêbécois.III n'existait dans notre milieu qUébêcois qu'un seul test français de
discri-mihation auditive adapté aux jeunes entendantsl conme il, n'e rêpondait pas
en-~.
tièrement aux exigences que nous nous étions fixêe~ nous avons prêféré en
é1aborer'un nouveau.
'Dans le mouvement scientifique actuel, cette recherche offre une
.
double contribution.
/
Celle d'ouvrir les êtudès de l'intelligibilité de la
parole filtrêe"sur les hautes frêquen,ces à deux nouvelles populations en
"
pleine maturadon,lihgu;sti'que et cel1,e de doter le milieu scientifique
.franco-• <P
québécois d'un second test de discrimination auditive de la ,parole, adaptê
~ux
"
jeunes entendants et 'aux jeunes déficients auditifs.
).
/
1
1
, f l , ~ ( t ;
t
.'o
4Tout au long de ce travail nous avons associ é le tenne hautes fréql,lences aux frt'quences ~gales ou supérieur~s à 3000 Hz. Le terme discri-\ mination auditive de la parole se dHinit cOJlll1e la capacité d'i'dentifier des
;,fmots placés en e,nsembles f~nnês. Le tenne entendant qu'il soi t rattachê à
, ,
adulte ou jeune, réfère à ces adultes ou enfants prêsentant une acuité audi-tive qualifiêe de 'rormale~ Il s'agit donc de ces sujef's dont les s,eulls au-ditifs à la rêception de sons purs* se situent dans/la zone s'êtendant de
. a
à 26 dB HL Cre: 'ANSI S3.6 1969) (Goodman, 1965 dans Katz, 1978)**. Leterme jeune dHitient audi~if réfère ~ un enfant a~teint d'une s~rdité congé-nitale neuro-sensorielle*** de degrê modéré, sévè're ou profond****. Nous
r;; "'tl1..':p1 , 0:
avons' pt-êfére le tenne défi ci ent auditi f aux termes sourd ou demi -sourd trop taxés d'un fort préjugé social. Le terme adulte dêficient auditif réfère ~
.1
tout adulte prêsenta-nt une suraitê de quelque nature que ce sott (conducti-ve ou-reu,ro-sensorielle) et" de quelque degré que ce soit ,(légère, modA-rée. sév,ère
o~ pro~onde).
le
te~
jeune qu'il soit raitaché~
entendant ou d;fi-ci ent ,audi ti f fait opposi ti on au terme adulte etr~fèr(
aux, ènfants âgês deJ
1
1
6 à 12 ans.
~ i ~
*. L'American National Standar,ds l'nstitute dans son standard ANS! 53.21-1978 recomnande l a mes ure des seui l s audi ti fs pour 1 es Isons purs de fréquence J125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 2 kHz, 4 kHz et 8 kHz). 1
1* La ... notation HL accolée à dB signifie Hearing Jevel et s'emp)oie dans la II,Iesure'des se,ui1s auditifs. ~~'" .'
i 1
*** Le terme neuro-sensorié1 caractérise la surdité reliée au/fonctionnement .~". pathologique de l'oreille intel(ne. Ce type de surdité se disti~gue de la sur-;., dité conductive, caractérisée par le fonctionnement pathologique de l'oreille
moYlmne. ~ Q ' .
~ **** Selon l'êchelle de Goodm,an (1965., dans Katz, 1978 p.10S) les degrés " léger, modéré, modêrément sévère, sêvère et profond de surdité correspondent ., A de~ pertes"'auditives s'êtendant respectivement de 27 dB Hl à 40 dB HL, de
41 à 55 dB HL, de 56 ~ 70 dB HL, de" 71; à 90 dB et de 91 dB et plus.
#.~ ,
, i
1
1
l
t1
r
J
i
1
1
f
f
i
t
f
11 \
11
1
()
1 11
/
'1o
r' Chapitreprem~r
Etat de la question
v ' ' " 1 1 ~ 1 f 1 1,
i!
- 1!
1
()
\
-,
LA PROTHESE AUDITIVE Distorsions du message sonore
La prothèse auditive constitue un système d'amplification po~tatif. Elle est destin~e à l'usage des d~ficients auditifs. Son rôle principal est de hausser le niveau'-CI'intensitê du message sonore pour lui permettre de re-joindre l'oreille dêficiente. Dépendant des divers degrés de surdité, la
-
~prothèse auditive offre une amplification faible (30 dB) ou forte (60 dB). Tout comme n'importe quel système d'amplification la prothèse auditive est
l ,
'constitu~e d'un mfcrophone, d'un amplificateur, d'une sourc~ d'énergie êlec-trique (piles), d'un petit haut-parleur,,\e réceptFur) (Berger', 1974; Carver,
1978)·t
e
moule s'ajoute à ce système d'amplification'pour conduire le sonampl if é à l' orei lle (Lybarger, 1978). L'interaction de toutes ces' composan-tes mod,èle l'image sonore d'entrêe et produit une image sonor,e qui à la sortie, diffère plus ou moins substantiellement ,de son image originale (Lybarger,
-
,1978). Nous disons alors que l'image sonore subit diverses formes de distor-sion qui en a1t~rent les caractéristiques spectrales. temporelles et d'ampli-tude du message sonore (Pollack M., 1975; Carver, 1978)..
/
Quatre dfffêrentes formes de distorsion sont actuellementréperto-riées il s'agit des distors'ions d'harmoniques, dis distorsions intermodu-1aires, des distorsions de transitoires et des di~rsions ;pectrales (Pollack M., 1975; Carver, 1978). L'équipement moderne
dl
mesure électro-acoustique et/
1
l
!
·
,-~ 1
()
1
~.:
.
..
J"
7 : "lès standards qui
r~gissent s~utilisation
aupr~sdes prothèses auditives
permettent 'de
~isualiseret de quantifier de façon plus sOre chacune de ces
"
diverse~
fonnes de
di~torston
(IÀmerican Nationall Standards Institute. 1971,
1976; Pollack M., 1975; Kasten, 1978). L.es multiples distorsions qu'impose'
l , .)la
proth~seauditive
àl'image sonoré
.
d'entr~esituent la prothèse auditive
..
-dans la catégorie des systèmes
d'a~lificationde faible
qualit~sonore
(Ling
, 1975; Pollack M., 1975; Ross, 1975).
Distorsions et
intel1igibilit~de la parole
1 \Ces divers types 'de
dist~sion inh~rJnt,es
àla".prothèse auditive
sont hautement
su~ceptib1es
de
r~duire l'in~~ibilit~
de la
p~role
trans-I •
mise
àtravers un tel système, en affectant la netteté du message reçu. Depuis
plus de vingt ans, plusieurs
cherlhe~rsont
an~lYSêl'effet
d~têriorantsur
l'intelligibilité de la parole, de l'une ou plusieurs de ces distorsions
sono-res. 'Pour Harris J.O., Haines, Kélsey et Clack (l96l), Jerger, Speaks et
Malmquist (1966), Bode et Kasten (1971) les distorsions d'harmoniques
affec-tent le plus la nettetê du message sonore. Pour Jerger (1967) ce sont les
,
.
'~., distor.sion~
intennodulaires qui
d~têriorentdavantage
l'intel1igibi1it~de la
parole. Alors que pour Witter et Goldstein (1971)' ce sont
~storsions
de
1 ~ _ _ ,, _ _ _
1
transitoires qui suscitent' les p1us- grands problèmes
d'inte1ligibi1,it~de la
parole.
01s~net Wilber (1967, 1968), Carhart et Olsen (1971) affirment
cepen-//1
dant que la largeur spectrale influence l'intelligibilité de la parole. Pour
l'un (Del Polito, 1967) la limite
inf~rieurede la bande passante devient un
facteur important, pour les autres la limite
sup~rieur,erevêt une importance
jusqu'alors méconnue (Olsen et Carhart, 1967; Bode et Kasten, 1971; Witter et
Goldstein, 1971;
Pasco~,1975). le consensus des chercheurs nlest donc pas
11 1 1
j
11
, r ! 1 l 1 1 , 1 r t , ' l 1 i
1
f
1
/
.
'o
, 1•
8encore atteint sur la primauté de l'un ou l'autre facteur pour une mei11e4re
inte1ligibilitê de la parole transmise
.
àtravers la
. " proth~seauditive (Kasten,
1978). Les chercheurs interrogent actuellement l'effet de l'interaction
de ces diverses formes de distorsion sur l'inte11igibHitê de la" parole
(Smaldino, 1975; Kasten, 1978).
Extension sur les sons aigus, du spectre d'amplification de la
proth~seauditive
Dans un effort pour améliorer le rendement acoustique des.prothèses
auditives les chercheurs
t~ntentde rêduiré l'effet
d~t~riorantsur la netteté
""
du message,de l'une ou
~'autreforme de ces distorsions. ,C'est ainsi que
" \
depuis quelques années les chercheurs, entre
autres,a~liorationsproposent
et même rêalisent techniquement l'extension de l'amplification de la prothèse
auditive sur les hautes fréquences.
Pendant près de
30ans
J
es chercheurs ont accepté, les
recorrmanda-tions des Rapport'd'Harvard (1947, dans
Pasco~,1975) et de $rande Bretagne
(1947, dans Pascoê, 1975) qui suggéraient de limiter
à4
kHi~la
limite
supê-"
rieure d'ampl1fièation de la prothèse auditive. "L'avantage fort limité
pour les dêficients auditifs ,adultes de ces frêquences supérieures
à4
kHzne valait pàs
l~coût de l'amélioration de la prothèse auditive" (Pascoê,
-.. 1975'; Harford
et
Fox, 1978). C'est ain
que la bande passante type de la
pro-thèse auditive s'êtendait gênêra1ement
300 à 3000 Hz (Ling. D.
l' 1971; 1975)D
ou
3500Hz (Carver, 1978; Vi11chur, 19780. Cette bande passante comparable
à
celle du têlêphone fournit
àl'auditeu e ,endant, p1acê en condition
•
presqu'idêale
d'~coute,une relative nettetê du message sonore transmis et
ainsi favorise une bonne intelligibilitê de la parole. L'entendant affiche une
, ,
r
9
/
\ très 'bonne rêsistance aux distorsions du message
parl~{licklider et Miller,
1951; Blesser, 1972}.
Il en est autrement du dêficient auditif beaucoup plus sensible
aux distorsions du message parlé et aux conditio'ns difficiles d'êcoute. Dès"
1953, Simonton et Hedgecock et dès 1955, Pa1va attirent l'attention sur
l'ef-fet plus dêtêriorant du bruit sur la discrimination auditive des d!ficients
'~
a,uditifs atteints de surditê neuro-sensoriel1e que sur la discrimination
audi-..
tive des entendants ou des d!ficients auditifs atteints de
surdit~conductive.
,
"
En 1960, Harris
~.D.,Haynes et Myers- dêmontrent que les dHicients auditifs
~
1ratteints d'une surdité neuro-sensorielle voient'leur disc'?mination auditive
, "
/
()
beaucoup plus affectée par la parole
, acc~lérêeque ne l'est celle des enten-
.
dants. En 1969,· Thompson et Lassman démontrent que les déficients a,uditifs
~/pr!sentent une discrimination auditive significativement plus
affect~een
con-dition bruyante d'écoute qu'en concon-dition d'écoute silencieuse. Ces mêmes auteurs
prouvent que
l'é~outed'un message sans
Tens
est significativement plus
diffi-cile que ne 11est l'écoute des traditionnels monosyllabes familiers. Pour leur
part,Carhart et Ti11man (1970) démontrent clairement que les
d~ficientstifs atteint$ d'une surdité neuro-sensorielle voient leur discrimination
audi-tive significaaudi-tivement plus
affect~een présence d'un message compétitif que
ne peut l'être celle des entendants. Le bruit exerce un effet plus néfaste
chez le déficient auditif que chez q'entendant (Tillman, Carhart et Olsen,
1970).
•
Il n'y a pas de doute, le déficient auditif
p~senteune plus grande
\ 1l,difficulté que l'entendant
àtoutes distorsions du message parlé. Cette
dif-ficu1tê s'accroît sensiblement lorsque plusieurs distorsions du message parlê
- 1 , , 1 1 ;
1
/()
10
-'
'cumul~nt leurs' effet?détériora~nts. C'est ainsi que ~s hauteso fréquences
retrol:.'vent leur importance auprès du d~ficient audi,tif. les premiers,"'Harris
'"
,~
J.!t..ll..
en 1956 réhjbilitent le rôle des frêquence~ s~périeures ~ 3kHz
pour le dê,\icient auditif soumis à, l'écoute de la parole accélérée. Ces auteurs, /
furent les ptemiers à proposer que la prothèse auditive étendè sa bande
d'am-l , '
plification ~ur les hautes frequences. En 1967! Olsen et Carhart démontrent
r~ /} ~
auprès des déficients auditifs l'avantage significatif. d'étendre le spectre ' :.
, ,
fréquentiel de la prothèse auditive de 2.8 kHz' à. S' kHz.' Tri antos\ et McCat)dless (1974) démontrent q1u'en situation bruyante d'écoute, les dHicients auditifs
~ .:
'bénéficient
Significative~nt a~
1
:e~tension. fr~quentielle
de318
kHz~ 5,~;
kHz. Pascoê (1975) démontre la supénonté dl'un S'lmulateur d'aides uditives
(master hearing aid) avec extension du ~pèctre des hautes fréquences à 6.3 ~z "'1
sur la traditionnelle bande passantE! des proth~ses èonventionnelles. Et même Ski nner (1979) rapPorte une exp~ri ence étendant 1 a 1 i mi te supéri èur;e .
"
d'amplification à 10 kHz.
Grâce à la technologie moderne,
certai~~s p~~hèses
auditives peuvent désormais offrir une ~elle amplification dU,message sonore sur les hautesfrê-_ \ . J';
~ <juences. C'est ainsi que Preves et Griffing (19?6), Griffing et Preves, (1976) ,
par le triple ajustement de la longueur et du diamètre d'ouverture de la partie .
.
.
tubaire du moule et de l'emplacement du microphone de_ la.
proth~se auditive obtiennent l'extension de l_a-fourbe de réponse fréquentielle jusqu'~15kHz
avec pic secondaire de rêsonance à 6kHz.
Kil1ion en 1976 et en 1979, par 1e'jeu de l'élargissement progressif de la partie tubalPe du moule obtient de la proth~se auditive, une 'extension frêquentielTe de l'amplification jusqu'à,
6
kHz
pour son moule à double élargissement du tube et une extension fréquentiellel '
\
,
•
,Cl
()
j .
\,
-~_._-~ .. ~--... --... --\'0 • 1 11jusqu'à 9 kHz pour son moule à
~largissemeritprogressif de la portion tubaire.
Harford et'Fox (1978)
~tudient,auprès de,d~ficientsauditifs atteints d'une
surdité neuro-sensorielle sévère avec perte uniforme sur toutes les
fr~quences,le double
b~néficede l'extension spectrale jusqu'à 6.5 kHz et de la coupure
des fréquences
inf~'~ieures ~
800 Hz gra'èe
~
la prothèse expérimentale E, 11
He
de
la compagnie OJicon. Pour les pa{ients attein'ts de problèmes d'hypersonie*
'" , _ i
-Vi]lchur (1973, 1978)-expérimente la possibilité d'une
èompre~siond'amplitude,
pondérée selon les bandes fréquentielles et active dans la zone des fréquences
jusqu'à 5.4 kHz.
L'enfant et la prothèse auditive
La presque totalité des, études
expéri~n-talessur la prothèse
audi-tive a été exécutée
àmême la population d'adultes entendants et d'adultes
\
i
ayant acquis une
surd~'talors qu'ils avaient atteint leur maturité
linguis-tique et après avoir l guement baigné dans un monde jntègre. Seules quelques
, , .- \
études de Ling D. (1964, 1969), de Briskey et Sinclair (1966) sur l'extension
,,«
du spectre fréquentiel vers les basses fréquences et quelques études-de la
parole transposée (Johansson"1966; Ling D. et Druz, '1967; Ling D., 196!ù
./
Guttman, Levitt et Bellef1eur, 1970) ont
é~éfaites aurrèS des jeunes déficients
auditifs
att,int~d'une
surdit~neuro-sensorielle
tcongénitale.
i' /
Et pourtant le jeune déficient auditif diffère doublement de l'adulte
.entendant. D'une part parce qu'enfant, il est en pleine maturation
phonolo-gique et linguistique et d'autre part
parc~que déficient auditif depuis sa
, ~ #
*
L
1hypersonie est une
hypersensibilit~aux stimuli sonores de forte
intensité.
"
. i 1 i _-1
• • l '1
,
"~-I 1'li.
1:
---'---~._-
------,
,---~,
Cj
, 1
: 0
()
/
. na
~
s~a~i
1 es tpriv~
de tous modl! 1 es 1 i ngu 1 s tiques 1 ntl!gres qui 1 u i per-,
-mettraient éventuellement de compenser pour l'absence de telle ou telle
in-formation.
Il baigne dans un monde sonore fort-imparfait qui ne lui permet
pas d'acquérir un modèle sonore complet qu'il
pourrai~emmagasiner dans sa
mémoire
~titre
~eréférence, en cas de situations difficiles d'écoute. Son
monde perceptuel
di~fèrede celui de T'entendant (Danhauer
e~ Singh~1975b
-~~, r ,et 1975c). Il,ne sait où diriger son attention auditive (Picket et Gengel,
.~
.
1973). Il
l~dirige- parfois sur
de~indices secondaires; il ne
s~itqu .
,,"
écouter
el
'ilhêsite souvent entre les indi-ces acoustiques d'où une/rande in- -
<st ab 1
il
t~
dans son compbrte", nt" a u91 ti f etun~
grande va ri abilit~
d'un j eune~
dêficient auditif
àl'autre
(Picke~t
et Gengel, 1973).
\,
le jeune dêficient 'auditif se distingue certainement de l'adulte
•
déficient auditif (Ling D., 1971; Ling A.H., 1975a et 1975b). Spn insertion
dans le monde sonore s'avère être un véritable exploit puisqu'il
n~accèdeen
réalité qu'à très peu d'informations acoustiques. Pour lui, 'la rèdondance dans
le message sonore n'existe presqu'e pa,s (Ross, 1975). Sa surdip dépouille le
message sonore de toute la richesse d'informations qu'y troule l'entendant et
tqu'y a déjà trouvêel'adulte avant d'acquérir sa surdité. le jeune déficient
/
auditif fait face
àune extrême pauvretê d'expériences auditives ce qui ralen·
tira et rendra extrêmement difficiie ltacquisition des règles
propre~au
dêve-\loppement
de
la parole et du'langage (Sanders
t1976). Sa capacité de prédire
adéquatement
l'oc~trrence d'un événement sonore li~guistique est très faible
• 1
' .
,ce~qui
ralentit son
développ~ntphonologique et en conséquence son
dévelop-pement linguistique (Sanders. 1976).
1
r'
1
()
13
Le jeune
d~ficientauditif diffère donc substantiealement de l'adulte
dans son mode d'utilisation de la prothèse auditive. Pour lui, la prothèse
auditive ne vise pas
àrestaurer
l';ntelligibilit~d'une parole autrefois bien
~ntendue
comme pour l'adulte ayant
acqui~
sa
surdit~.
La prothèse auditive
1 . ' \ ,
dèvient son preJ;er agent de liaïson avec le monde sonore. Cette aide auditive
1#fa'çonnera son monde sonore et lui pennettra
d'acqu~rirles diver,s phl1mèmes* de
la langue, lui donnant ainsi accès au langage (Blesser dans Pollack l., 1974;
,,~Ross. 1975). Une pauvre
fid~lit~acoustique de' sa
prothè?~.auditive est suscep-
,.
... tible d'entraver
l'acquisi~ionde
p1usieur~pholJèmes affectant ainsi s'on
déve-,
10ppement phonologique,
morphologique~*et même linguistique (Ross, 1975).
Alors
quel'adulte ayant acquis sa
surdit~peut puiser dans sa mêmoire et
com-penser intellectuellement pour la non audibilité d'un phonème non transmis par
sa prothèse auditive. le jeune
d~ficientauditif voit san développement
phono-logique et linguistique entravé
jusqu'~ce qu'un meilleur système
d'amplifica-tion ou une autre modalitê de communicad'amplifica-tion lui donne accès aux informatibns
manquantes. De la qualitê de sa prothèse auditive dépendront vraisemblablement
r.
la richesse, de son monde perceptuel et la qualité de ses acquisitions
linguis-tiques.
La prothèse auditive revêt par conséquent une mission différente
dé-pendant du bénéficiaire enfant-ou adulte. Destinées
àl'un ou
àl'autre de ces
*
Les phonèmes constituent les divers sons parlés de la langue; les voyelles
et consonnes constituent deux grands regroupements
phonêmiqu~sde
lalarrgue.
**
ledéveloppement morphologique s'inscrit dans
leprocessus d'acquisition
de 1angue et se manifeste dans l'acquisition de phonèmes porteurs de sens.
Ainsi en langue anglaise le
/sl constitue
undes véhicules
dela notion du
pluriel.
~'>-J_~~~---1
\
1i
C)
l
7
..
14groupes, les questions sur la prothèse auditive sont depuis quelques années
poslles' di ffêre"""nt (Mi 11 er
J.·0..
1ï..2;
81esser
~ans
Pollack
t..
1974;Ross.
1975; Sanders, 1976). La nécessitê d'orienter la
recherc~edans le dQmaine
des bênéfices réels qu'apporte la prothèse auditive
àl'enfant se fait
ma;n-tenant senti r.
Extension sur les hautes frêquences du spectre d'amplification de la prothèse
auditive de "enfant
Watson est le premier
~avoir dêmontré en 1960, auprès de deux
~-o
pes de jeunes dHicients atteints d'une surditê neuro-sensori.elle congênitale,
la supêrioritê de rendement d'une prothèse auditive avec extension du spectre
d'amplification jusqu'à
B
kHz, sur le-rendement d'une.même prothèse avec
ex-tension du spectre d'amplification jusqu'à 3 kHz. >A un test d'identification
çle ph ra s,es • douze des vi ngt-quat re en fants attei nts d'une surd i té accentuêe
,sur les hautes frêquences-bênéfic.ient davantage de i'amplification jusqu'à
8 kHz et quatre de ces vingt-quatre enfants bênêficient mieux de l'amplification
jusqu'! 3 kHz. A ce mêmè'test
~tif;cat;on
de phrases. neuf des seize
enfants atteints
d'~~~e-Uniforrne àtoutes les
fré~uen:esprêsentent une
meilleure rêussite avec l'extension de l'amplification jusqu'à
8kHz alors que
,
trois autres de ces seize enfants fonctionnent mieux avec l'amplification
\ \
jusqu'à 3 kHz. Au test d'identification des monosyllabes, dix des jeunes
dêfi-;
cients auditifs de l'un et 1 'autre groupe bênêfident davantage de l'extension
spectrale sur les hautes frêquencés alors que huit de ces jeunes atteints d'une'
Pé~
àtoutes les fréquences fonctionnent mieux avec l'amplification
restreinte
à3 kHz.
\ I~
()
/
( 15Cet auteur senble aVO,ir été le seul chercheur à avoir réalisé une
recherche investiguant les bénéfices
po~sib1es
da l'extension spectrale surles hautes fréquences des prothèses auditives destinées aux jeunes déficients
auditi~. En 1973, Ling D. et en 1974, Northem et Dowris", probablement sur 1 a foi des résul tats des recherches entrepri ses auprès d'adultes entendants,
"
recommandent ~ l'usage des Jeunes dêficients auditifs, l'extension du spectre
. '.
d'amplification de leur prothèse auditive sur les hautes fréquences. En
lit
1975, Ling D. \fait valoir les .avantages du moins théoriques
~'urte
te11ee~ten-\ /~
sion spectrale\ pour une meilleure audibilité du \
!TI
et duIs/*.
En eff..et', !\
l'analyse d'un ~onogramme** et par le jeu de règle couvrant le spectrè
,
supêrieura3 kHz, Ling D. affinne que;, le
Isl
perd son identité puisque cepho-1
nème couvre la ba~de spectrale' de'3.5' kHz ~ 8 kHz., Ainsi en est-il du
II!
qui se trouve séri\
u~ement
amputé de sa zonespect~a
l eq~s
hautes fréquences."Ling
D.
recommande lors une plus grande extension de la'courbe d'amplifiéationdes prothèses auditlVes sur les hautes fréquences. Une extension spectrale
jusqu'~ 5 kHz pè~t rait cie conserver en partie du moins l'identitê'du
II!
et'':--du /s/ et faciljt.e.rat la trartsmission acoustique de ces phonèmes.Pour Ross 1975), l'extension spectrale vers les .fréquences
supéHèu-res ~ 4 kHz susciter lt vr~isemblablement une meilleure audibilité des-phonèmes
, ,
~ composition spect ale aiguê
Is,f,a,I,t/.
Pour le jeune déficient auditif,l'audibilité de ces phonèmes prêsent~rait un double avantage: celui de permettre
1 .
·
~
* Tout.au· lOng -d~
..ce
travaU -nous· avons adopté les synboles phoné't'Îq-ues preposéspar l'Association !internationale de phonétique (International Phonetic
Associa-tion, 1 9 4 9 ) . · 1 .
.
-~
** Le sonogramme\est la représentation graDhique
des
caractérist~ques
acous-tiques des phon~mès en termes d'intensité, de frêque~ce et de durée.
, , ' \
,
.
"
1 , , ,l'
\ 1 i 1 ; -' i , ' \1
1
~1
An electroacoustic system that filters poténtially
valuable acoustic information simply does not make
sense.
in
this instance, one cannot generalize
from adults to children. Ah adult who knows the
language can function quite well with the
elimina-~
tion of a certain degree of the redundancy in the
\'speech signal. Not so with a congenitally
hepring-... ~ _ .~~~_...'" J~.,. \P
~
.mpaired
child. He is attempting to learn speech
nd language through an impaired auditory system
nd a low fidelity amplification
d~vic~.Hence
t e additional acoustic information provided by ,
" t'e high frequencies is likely not to be redundant
at all, but the minimal cues necessary
fo~devel-oping certain speech and language skills. (p.234)·
,En somme, selon toute logique, l'audition des hautes
fr~quencesjouerait un rôle fort imp?rtant auprès du jeune
d~ficientauditif
~~ntpour
le dêv.eloppement
desa parole 'que de Son langage. Mais une
seul~recherche,
celle de Watson (1960), explore effectivement la question
aupr~s'desjeunes
. ,
d~ficients
auditifs. Plusieurs
h~poth~sessont
~misessur la valeur possible
de ces hàutes
fr~quences.auprèsdes jeunes
d~ficients a~d1tifs, àpartir
d'extrapolations faites auprès'
d~sadultes I}"tendal'lts (li,rtp'D., 1975; Ross,
1975).
Cefut
don~l'objet principal de
cet~erècherche qùe d'apporter un
êclairage
àcette question,
en-~tudiantle rôte des hautes
fr~quencesdans la
r " •
--;;:,."
disc~iminatlon
auditive de jeunes dêficients auditifs et de jeunes entendants.
*
Le morphème est un phonème porteur de
sens,~1
o
17
HAUTES FREQUENCES ET SPECTRE ACOUSTIÇUE' DE LA pAROLE
/ /
, <t
, La phonétique acoustique, par ses études spectographlques* et sonogra-phiques nous renseigne sur la 'présence des hautes frêquence's dans le spectre acous-tique de la parole, que ce'soit pour la langue anglaise (French et Steinberg,
ft,! 1
.-1947), la langue française (Lehmann, 1962) ou finlandaise (Palva, 1965). Ce
spec-~.
-tre s'étend généralement de 100 Hz à 9 kHz avec possibilité d'extension jusqu'~
12 kHz (Palva. 1965). Une bande de 200 Hz ~ 7 kHz offre en situation
ordi-, 1 '
. n'aire d'écoute, une intellegibilitê de la parole qui atteint le niveau d'ex-cellence pources'&-rois différents cadres linguistiques soit l'anglais (French et SteinQ~rg, 1947), le fr,ançais (Lehmann, 1962) et le finlandais (Palva, 1965).
Puisqu'une part très importante des études de phonétique acoustique
"
a été exê,cutêe pour la langue anglaise (amêricaine~ et puisque Oelat'tre (1968)
r of
a souligné, par le biais des études utilisant la parole synthétique, la simi-
.
, laritéd~S
indices acouftiquespropre~
aux phonèmes de la langue anglaise et française, .nous puiserons nos 'informaOtions à même la littérature anglaise, tout en nous réservant l~ pri~il~ge de puiser dans la littérature française lorsque jugé nécessaire.Un spectr~ de fréquences sup~rieures à 3 kHz se retrouve à la fois auprès des voyel.1es et des consonnes (Fletcher, 1953). Dans son étude
des-li
criptive des phonèmes de là langue anglaise, Fletcher (1953) repère une
*
Le spectrographe dêcompose les stimuli sonores en leurs spectres acousti-ques, isolant Iles paramètres acoustiques dqntensité et de fréquence.i
\
1 i 1 , 1 1l
t \
C)
' , ' 18 Clprésence diluêe de hautes frêquences auprès de toutes les voyelles qu'elles
soi ent êmi ses par des felTl11es ou des hOlll11es. Cependant, il note une presence
4>eaucoup plus ; mpdrtante de hautes fréquences auprès des phonèmes vocaliques
<0'
la~i,e/, prononcés par un hommè' ou une femme. Même si les voyelles sont con-si dêrêes comne phonèmes de basses fréquences s 1 e spectre des hautes frêquences
-peut en constituer le deux,ièmè formant*(F2) et le troisième fonnant (F3) selon
qu'elles sont prononcées par une fenme ou un enfant., Dans leur étude des-
..
/
criptive des voyelles émises par des locuteurs masculins, féminins et enfants, Peterson et Barney (1952) situent autour de 3.2 kHz le F
2 du
IiI
émis par un, >
enfants autour de 3 kHz le F3 du
IiI
émis par une fenme, entre 2.9 kHz et 3.3kHz ,le F3 des voyelles
/isI,el
émisespardesfemmes,~ntre 3.1et3.7!<kHz le F3des voyelles (i,I,e,œ,u,~,v,u,
1
émises ,par un enfant.Les consonpes consti tuent un groupè de phonèmes caractéri sés par
les hautes fréquences. Ces hautes fréquences se retrouvent tant au niveau des
bruits d'explosion des consonnes pcclusives*7p,t,k,b,d,g/, qu'au niveau des
bruits de friction des consonnes -fricatives
/f,s,f,v,z,,1
et qu'au niveau destransitions consonne-voyelle, voyelle-consonne de l'un ou l'autre de ces
sous-- ;
groupes de consonnes (Fl etcher, 1953). Nêanmgi ns certai nes de ces, consonnes se caractêri sent davantage par leur spectre des hautes frêquences. Pour la 1 angue
1
anglaise il s'agit par ordre spectral croissant de 3 kHz à 6.4 kHz., des
con-sonnes /n,m,d~t,f,v,f,z,s,al (Fletcher. 1953)~ Pour la langue suêdoise, il
s'agit,par ordr:e spectral croi,ssant de 3 kHz ~ 8 kHz des consonnes Ih,t,nl,j,
d.l,v,r,k,s,I;)/ (Fant, 1948, citê dans palva, 1965).
*
les formants constituent des zones fr~quentielles de forte concentration~nergêtique~ ,ils sont caractéristiques des voyelles et des consonnes nasales.
**
Pour une dêfin1tion des caractères "fricati fil et "occlus; fil des consonnesvoir chapitre III, p. 101.
, ,
1
1
o
'\
19
Dans leur étude des caractères acoustiques d~s consonnes occ1usi--ves, Halley, Hughes et Radley (1957) situent au-dessus de 4 kHz la zone spectrale pr~dominante du bruit d'explosion du
Itl
et· duIdl
et entre 2 kHz et 4 kHz ,la zon,'e spectrale prédominante des consonnesIkl
et/gl
placées devant une voyelle antérieureli
,e,e!. Dans son étude spectrale du bruit \; de friction<:é1es éonsonnes"·fricatives, Strevens (1960) précise leslimites~~"
inférieures et supérieures du ~pectre des fric.atives assourdies*: leIfl
.. '
couvre le spectre s'étendant de 1.5 à 7.5 kHz. lej61 s'étend d'environ 1.5 kHz à 7.2 kHz: le
Is/
couvre l'étendue spectrale de 3.5 kHz ~ 8 kHz, le,
1
JI,
s'étend d'env; ron 2 kHz à 7 kHz, 1 eIhl
s'étend d'envi ran 550 Hz à 6.5 kHz. Strevens s' attend ~ retrouver les mêmes caractéristiques spectrales de hautes fréquences pour lesfr~at;ves
sOllOr;séesIv,é,z"I.
Ainsi les caractéristi-q~~\ du/vI
se compa~ient à,ce.Jl~s dÏJIfl,
celles dul'àl
à celles dulei,
celles du/z/
à celles au/s/,
celles du;-7;/
à celles dulU ..
Seule s'ajoute-rait pour ces consonnes sonorisées une zone de basses fréquences aux environs de 125-250 Hz. Cette zone spectrale cpractérise la sonorisation produite parl ,
la vibration des cordes vocales.
HAUTES FREQUENCES ET INTELLIGIBILITE
DE
LA PAROLE CHEZ L'ADULTEIl Y a donc présence de hautes· ... fréquences dans le spectre de la parolè et de plusieurs de ces unités constituantes. Le rôle spécifique de ce
spe~treJ
des hautes fréquences n'est cependant pas évident. Il nousest'
principale-".
ment révélé par
il
les études dJinte1ligibilitê de la parol~ naturelle f;ltr~eauxquelles furent soumis des adultes entendants et dêficients 'auditifs, i1) les études de 1
a
parole synthétique auxquell es furent soumi S des adultes entendants,*
Pour une définition des caractères "assourdi" et "sonorisé" des 'conSOnnes voir chapitre III, p. 100.(
\
20
ii;) et les ~tudes d',ntelligibilit~ de la parole naturelle auxquelles furent
'--;rJ
soumis des a~ultes soufiJ)'ànt d'une surdit~ neuro-sensoriel1e, acquise, ~pêci
/
fique des hautes fr~quences*. Pratiquement aucune étude êquiva1ente n'a été
1 -'1 '
entreprise auprès des jeurie~ entendants et des jeunes d~ficients auditifs;
,
--clest pourquoi nous avons consacré une bonne partie de cette revue de 1ittê-j
rature aux êtudes faites auprès des adultes entendants et dêficients auditifs.
~) ::1
Adultes entendants et l'ritel1igibilitê de la parole naturelle filtrée
; J
Une des
tè~hni.ques
expérimentales les mieux connues et 'les plusex-p1oit~es pour ~tudier là contribution d'un spectre acoustique consiste à l'éli'" ...
miner partiellement ou totalement au moyen· du filtrage. l'élimination du
spectre des hautes fréquence~ se r~a1ise au moyen du fi1tragE passe-bas,
rê-.
glable ~ diff~r~ntes fréquences de coupure (3 kHz,
4
kHz, &. kHz ••• ) etajusta-ble dans son attênuation par octave (12 dB, 24 dB, 48 dB ou 60 dB/oct.).
Ainsi un filtre passe-bas r~91ê à 3 kHz avec 12 dB d'attén1,Jation par octave,
laisse passer intêgra1ement le spectre inf~rieur ~ 3 kHz et att~nue
progressive-ment l'intensitê du spectre supérieur à 3 kHz au rythme de 12 dB/oct. Les fr~
quences autour .de 6 kHz seront att~nuées de 12 dB et celles autour de 12 kHz
seront atténuées de _24 dB. Puisque nous sommes parti cul ièrement intéressée 'à
l'effet filtrant des prothèses auditiyes sur les fr~quences sup~rieures à
3
kHz,
nous limiterons notre investigation aux études touchantl'intell\igibi-1
S lité de la parole filtrée s.e1on les passe-bas à 3000 Hz .. 500 Hz. Ces -diverses
études de la parole naturelle filtrée nousfenseigneront sur i) l'atteinte.
globale de l'intelligibilité de la parole,' H) l'atteinte spécifique de'" certains
pl!ionèmes, 11i) l'atteinte spécifique de certains éléments tonstituant les phonèmes.
-* les- surdités spécifiques des hautes fréquences peuvent !tre associées entre
autre 'li une exposition aux bruits, 'li l'ingestion de médicaments ototoxiques ou
au vieil1issement.~
i
r~
\...i •
r
--~ --
-21
Atteinte,globaJe de l'intelligibi1it~ de la parole., Fletcher et S'ts\nberg (1929), French et Steinberg (1947) furent panni les premiers à
uti1is~'r
exten-~ivement les filtrages de la parole naturelle. Ils utilisèrent divers fil-trages passe -bas, passe -haut et passe -bande L'intelligibilité de mono-syllabes sans sens, soumis au filtre passe-bas à 3 kHz se situe aux env; rons de 89%
pour des auditeurs anglophones adultes entendants. Chavasse (1962) rapporte des études selTÎJlables. reprises en France auprès d'adultes français. L'int~l1igibilitê de ces monosyllabes sans-sens, f;..ltrês passe-bas ~ 3 kHz sel '
situe aux environs de 88 %.
, \
Hirsh, Reynolds et Joseph (,1954) aux Etats-Unis, Lehmann (1962) en France reprennent les études de leurs prédécesseurs en variant le matériel
.
vocal. Ils uti lisèrent successivement des syllabes sans sens, des monosylla-/ biques porteurs de'sens et des 'phrases porteuses de sens. A l'usage d'un même filtre,ils obtinrent pour l'une et l'autre langue une intelligibilité crois-sante de l,a parole lorsque les syllabes revêtaient un sens et s' accroissai ent
/ 1
en nombre~ Alors que l';nte11i9Th~itê des syllabes sans sens, filtrées
\
passe-bas ~ 3 kHz (60 dB/oct.) se situait aux environs de 80 %, celle des mono-syllabes anglophones et porteurs de sens s,e situait aux environ~ de 97 % et
\
celle des dissyllabiques porteurs de sens· atteignait lé niveau de l'excellence soit 100 % (Hirsh et al. 1954). Des résultats similaires s,e retrouvent à l'écoute du matériel vocal français filtrêl passe-ba,;
l';ntelligib;lit~ de~
syllabes sans sens se situe aux environs de 88 %. cklle des dis'sy1abiques (torteurs de sen~ atteint...environ 95 % et celle des phrases porteuses de sens/ 1
atteint 100
%
(Lehmann, 1962). Pour la langue finlandaise, P~lva (1965) obtient/
1l,
i ! " ' 1 ,i
1 ~22
C.'
~
une
int~lligibilitéde 92·%
~l'écoute de monosyllabes
por~ursde sens et
(~,
J
fi ltrés pas se-bas
~.2.8
kHz.
li
L'intelligibilité de la parole, qu'elle soit d'expression
anglaise.~française ou finlandaise se trouve donc affectée par le filtrage des fréquences
supérieures
~3
kHz.
L'importance de l'atteinte variera de 20
%
~0
%
dépen-dans du matériel vocal utilisé.: l'atteinte se faisant davantage ressentir
lorsque le matériel vocal est dépouillé de sens'et réduit en phonèmes.
Atteinte spécifique de certains
phon~mes.En 1953, Fletcher rapporte les
ré-.
~sultats d'études
con~acrées ~l'intelligibilité de
phon~mes voca'iq~eset,
con-sonantiques soumis
~divers filtres passe -bas et passe -haut. L'analyse
des graphi-ques propres
~chaque phonème révèle que le fil
tr~gedes fréquences
supérieures
~,3
kHz
affecte différemment les
dive~sphonèmes de la langue
\ '
anglaise. Alo,:,s que les voyelles :prises
~l"état isolé rêsistent
~ufiltrage
des hautes fréquences. les consonnes présentent une
a~tein~variant de 60
%
\
~ 0
%.
-Dans le groupe des voyelles, seule l'intelligibilité du
101.
luI, et
1
se trouve affectée. Elle atteint environ
98
%, alors que
l'intelligibi-te de. autre. voyelle.
tran~mises
!tr.vers un
llli!mesystème de filtrage se )
Hue
~lOO%.
'L'intelligibilité des diverses consonnes offre cependant une
1/
pl s grande variation d'atteintes en présentarat divers pourcentages
d'iJ:ttelli-1
,
.
gibilitê. Les 1 iqu.ides
Ir.ll
résistfRYbien au filtrage
d~shautes fréquences,
leur i'ntelHgibiÙté dEfP1E!ur-e excellente (100
%).Dans le
group~des
semi-consonn'es*/w.j,yl seul l'intellig,ibilité du
Ij/
est réduite
197
%.A part
1 "
*
Selon la terminologie de l'Association internationale de phonétique les
pho-nèmes
/w.j
.YI
appartiennent au groupe des sem-voyelles; cependant les
caracté-ristiques articulatoires
·et\~oustiques deces phonl!mes leur E:onftrent une
similarite avec les oonsonnes. C'est ainsi que les phonéticiens actuels qualifient
ces phonèmes
~la fois
de
semi-tonsonnes ,et de semi-voyelles
(Cl~s.Demers,
'
Charbonnel.V,.
1968). / \,
/
/
.,
()
- - - - ; : - - ,
23
/t,n,k/ les/oéclusives
Ip.b,d,g,m,~,conservent une excellente
intelligi-/
bili~ê.
L'intelligibilité
~esocclusives /t,n,kl se trouve
abaiss~e'a80 %,96
%,
98
%
respectivemènt. Comme groupe, les consonnes fricatives se trouvent
le plus affectêes par l'absence des hautes fréquences.
Parmi les fricativés
1
seul
IJI
résiste au filtrage des sons aigus, les autres consonnes de ce
groupe voient leur
intelligibilit~varier de
~O%
~ 95%.
Cette
intelligi-bilité se situe
~ 40 %pour
Isl,
65
%pour
/al,
80 %pour
IzI,
85 %pour /f!,
192 '%
pour
'/tU
et 65
%pour Iv/.
1)
/
En
d'autresterrœs~
nousremarquons
que parmi les consonnes
attein-tes dans leur intelligibllitê
1)les consonnes -fricatives sont plus atteintes
que les consonrfés occlusives, li} les consonnes assourdies Ip,t,k,f,e,s,J/
sont plus atteintes que les consonnes
sonoris~esIb,d,g,v,s,z'J/' iii) les
consonnes au lieu
dl articu1ation médian
/t,d,n~e,s,zlsont plus atteintes que
les consonnes au
lieu d' articul ation
antérieur~-_-tp,b,m,f,
vI
ou postéri eur'**
Ik
,g,J
'JI,
i v) les
liqui des
Ir, 11,
les semi-.consonnes /w,y,jl et les nasàles
Im,n,
QI offrent une bonn'e resi stance
l 11absence progressive des hautes
fré-~-.
/
'quences.
De
tels résultats se retro4vent dans l'étude de Miller
J.A.et
Nicely_(1955). Ges auteurs cumulent l'utilisation du filtre passe-bas
l2.5 kHz
(24dB/oct.) et dl un bruit blanc prêsent da,9s un rapport signal/bruit
de
+
12
08*. 1l'effet cUIIlJ1atif du bruit et du filtrage se fait sentir ..
/
*
Le rapport s/b indique la différence
e~dêcibel
qui sépare le niveau
(Pintens'ftê du
si-gnaljdü
lf'IVefU ,d~intensi
du bruit.-Cette- d:i.ff4nmce peut
revêtir une valeur positive ou négative se on que le niveau d'intensité du
signal est supérieur ou inférieur au niveau d'intensité du bru,it. Dans ce
cas
prêc;sle niveau d'intensité du s1gna1 surpasse de 12 dB- celui du bruit
et peut s'exprimer ainsi en fOnllJle abrêgêe ts/b
+
12dB).
~~·Pour·une
définition-des lieux d'articulation
ant~rieur.medianet postérieur
voi~
chapitre
III,pp.
99
et 100.
. \
•
,
~
1
1
!
()
\
/
24
11 intelligibi lité des syll abes sans, sens sien trouve pl us rêduite.· LI ana-lyse de la matrice de confusiol')sdes diverses consonnes accJusives et
frica-l " , . . '
tives nous a permis de calculer le taux de rêussite A 11 identification des
consonnes. Les occlusives assourdies
Ip,
t,kl
sont identifiées 1l 60%,
62 %,72 % respectivement. Les occlusives sonorisées
Ib,d,gl
le sont 1l 78 X, 13 %.,
62 % respectivement. les nasales rêsistent bien au filtrage des aigus. leur
i ntell i gibi li té demeure très bonne : 98 % pour
lm!
et 93 % pourln!.
Lesfricatives sant cependant plus, affectêes que les occlusives, les'.assQUrdies
/f.e,s,I/ voient leur intel11gibilitf abaissée à (56
%.
39
%,
71%,
92
%)
respectivement et les sonorisées
Iv,s,z,,1
voient la leur abaissée 1l(69 X,
'64
~,
,
64 % et 89 %) respecti vement.\Atteinte spêci fi que de certains éléments constituant les phonèmes. Dans
l'ana-\
lyse de leurs données Miller et Nicely (1955) isolent pour chacune
des conditions d'écoute (divers filtrages et divers rapports s/b) le pource
-1
tage de transmission de cinq éléments constituant les phonèmes consonantiqu s.
---~ .. ~
11 slagit des traits suivants : ~ savoir le lieu dlarticulation, la sonorit',
.
,la nasalité, l'affrication et la durêe. En C,ondition d'êcoute passe-bas
a
2.5·kH~, associl~e au rapport
sIl>
(+ 12 dB). 70.7 % des informations sonttrans-mises. Le trait de nasalitê est transmis à 100 %, il est donc le plus
résis-tant l cette double distorsion pu message parlé. Les traits de sonorisation
,
et de fri cati on sont transmis à 83.4 % et 70.2 %. les' t ra i ts . de durée et· de
, - (
lieu sont transmis
l
51.6 % et 46.6X.
De tels rêsu1tats sont compréhensibles 1 <1 l
compte ten~ du fait, que le bruit assourdit les caractères acoustiques de la
sonorisation, _s)tuês en zone de basses fréquences et compte tenu du fai t que
llatténuation de l'intensitê des fréquentes supérieures} 2.5 kHz atteint(l'es
transitions de F2 porteuses de l'information quant au lieu,(Delattre"